Dans une interview pour le numéro de septembre de la Revue des Deux Mondes, Dominique de Villepin dénonce à nouveau l’esprit de cour qui sévit trop souvent dans la vie politique.
Pour y remédier, il défend à nouveau l’idée de placer le retour à la citoyenneté au coeur de toute démarche politique: « Revenir aux sources humanistes de la politique, c’est d’abord faire des citoyens, ou plus exactement renouer avec la tâche jamais achevée qui consiste à promouvoir l’apparition de ce type de Français : un citoyen éduqué, actif, ardent, fort de son statut. »
*****
Revue des Deux Mondes: Dans votre dernier ouvrage, De l’esprit de cour, vous décrivez un rapport français au pouvoir dans lequel le courtisan accorde une légitimité absolue au bon plaisir du monarque, qu’il soit d’Ancien Régime ou républicain. La cause de l’humanisme en politique est-elle mise en danger par l’esprit courtisan ?
Dominique de Villepin: Il faut d’abord bien voir que les hommes de la cour d’Ancien Régime sont profondément marqués par l’idéal courtois, précisément, mais aussi par l’idéal de service. Là est leur véritable référence personnelle. Le paradoxe, qui trouve bien sûr son expression la plus achevée sous le règne de Louis XIV, c’est que la cour se constitue en un lieu d’asservissement, de domestication de ces hommes qui ont souvent de grandes qualités, voire de grandes âmes. La cour est un instrument dans la main du roi, qui peut y jouer des divisions, des intérêts, et flatter, ou au contraire disgracier.
Elle a donc pris une forme ambivalente, dont la classe politique reste encore profondément marquée de nos jours : l’esprit de sujétion cohabite avec l’idéal de service. Au bout d’un certain temps, l’idéal de service se corrompt dans la docilité. À tout le moins, les courtisans sont écartelés entre cette légitimité qu’ils accordent au bon plaisir du monarque – ou du président de la République aujourd’hui – et cet idéal de service qui les rassemble. La synthèse, dans un esprit parfaitement courtisan, c’est l’idée que servir le monarque d’une part, se mettre en situation d’être servi par lui d’autre part, et enfin servir la France constituent une seule et même vocation. Or, c’est faux : il n’y a pas de place pour l’apparition d’un De Gaulle dans ce raisonnement. Lui a desservi ses intérêts personnels immédiats, a desservi le pouvoir qui s’établissait dans la défaite, et pourtant il a servi la France.
En profondeur, si la cour a été possible dans ce pays, c’est parce qu’il y a un besoin français d’un pouvoir fort. Il ressent donc la nécessité de se renforcer, de se transcender en permanence pour se perpétuer, se relégitimer. Pour répondre à cette demande constante de notre peuple, l’État accroît ses pouvoirs, le roi accroît son pouvoir, et l’organisation de la cité tournera de plus en plus autour de lui au fil du temps.
Les choses étaient plus claires tant que la cour était visible, contenue dans les murs des palais royaux. Le phénomène était cerné, observable en vase clos.
Mais depuis la mort du roi, dans notre République, la cour n’est plus une structure physique et institutionnelle, elle s’est métamorphosée en un virus, qui s’est propagé dans les lieux de pouvoir, et qui a imprégné les esprits dans leur rapport avec lui. La cour veut tout le pouvoir, et elle l’aime pour lui-même. La cour est une passion du pouvoir. Comme toute passion, elle est exclusive, irrationnelle, sans autre finalité réelle qu’elle-même.
La République, pourtant, est censée se configurer autour de règles tout autres, sur de nouvelles bases : elle veut établir un rapport beaucoup plus clair et beaucoup plus sain entre le citoyen et ses dirigeants que ne l’était le tête-à-tête du courtisan avec le monarque, ce vertige mimétique, ce mélange improbable de splendeur et de frivolité. Splendeur car toute la gloire est concentrée à la cour, et frivolité parce que le pouvoir y est sa propre fin, et que le service y devient une idée morte.
Avec la montée en puissance des pouvoirs d’argent à partir du XIXe siècle, d’autres cours sont nées, en dehors des enceintes du pouvoir politique, et elles se sont mises en réseau ou en situation de rivalité. Dès lors, la question qui se pose est de savoir comment éviter que la cour, qui stérilise tout ce qui n’est pas elle, dont le génie étrange est d’ignorer ce qu’elle gouverne, se reconstitue dans les différentes enceintes de pouvoir. Le risque absolu étant que les différentes cours convergent, et bloquent toute évolution ; et en effet, la France est caractérisée par des tentatives permanentes de reconstitution de cour dissoute !
Alors, bien sûr, il faut trouver les règles qui nous épargnent cette évolution. Ce sont d’abord les vieilles règles de la séparation et de la responsabilité des pouvoirs. Notamment entre le pouvoir politique et l’autorité judiciaire, c’est-à-dire entre le président de la République et le ministère public. Mais c’est aussi la séparation du pouvoir médiatique et du pouvoir politique qui doit introduire une coupure stricte entre ceux qui sont à la tête de l’exécutif et les propriétaires des médias. Il faut que les groupes industriels et de services qui vivent de la commande et de la régulation publiques ne puissent pas être propriétaire de médias.
Mais le garde-fou ultime, celui qui garantirait que la cour ne gèlerait jamais l’évolution de la société, ne contrarierait plus l’intérêt général, c’est le citoyen. C’est à ce point qu’il faut faire le lien entre le problème de la cour et celui de l’humanisme, car l’idée républicaine du citoyen est, bien sûr, un point d’application de l’humanisme en matière politique. C’est l’idée d’un citoyen éduqué, engagé, qui a confiance en le pouvoir parce qu’il sait qu’il est capable de se renouveler pour mieux servir l’intérêt général.
Or le drame français, c’est la reproduction des élites, c’est leur enfermement, leur surdité à l’intérêt général. Elles ne sont pas suffisamment irriguées, parce que le principe d’égalité n’est pas vivant dans notre pays, contrairement à ce qu’on pense et dit çà et là. L’égalité est plutôt chez nous une obsédante passion morte qu’un principe actif et fécond.
Les quelques « cas » de promotion sociale issus des classes moyennes ou populaires n’ont en général d’autre urgence que de donner des gages, dès qu’ils se sont hissés au pouvoir, pour se faire accepter des héritiers. Ils y entrent promus, ils s’y maintiennent comme agents les plus zélés de la cour. Ils ne renouvellent pas le pouvoir, ils se font adouber au compte-gouttes. En un mot, il n’y a pas assez de puissance citoyenne pour contenir l’esprit de cour. La cause de l’humanisme n’y trouve pas son compte.
Nous sommes donc en face de la nécessité de faire vivre nos principes, nos valeurs, si nous ne voulons pas que le pouvoir cède définitivement aux nouvelles cours. L’exigence citoyenne et la République offrent des contenus, je veux dire un type d’homme et un type de communauté capables de transcender l’addition des intérêts particuliers : à nous de les faire vivre, pour que la politique soit porteuse d’une certaine vision du progrès moral de l’homme.
Mais dans l’ambiance de crise de nos valeurs et de crise de l’avenir que nous connaissons, particulièrement en France, les principes, les références, les perspectives sont épuisés. C’est vrai pour toutes les grandes notions qui font le lexique de la politique : l’État, la nation, le peuple, et bien sûr, la République et le citoyen. Revenir aux sources humanistes de la politique, c’est d’abord faire des citoyens, ou plus exactement renouer avec la tâche jamais achevée qui consiste à promouvoir l’apparition de ce type de Français : un citoyen éduqué, actif, ardent, fort de son statut.
En principe, les hommes politiques sont de « grands citoyens », héritiers d’une tradition humaniste par leur culture scolaire, qu’ils frottent à leur expérience du pouvoir. Pouvez-vous faire une sorte de bilan de la culture humaniste chez les hommes politiques actuels, en pointant ses conséquences sur leur pratique de la politique ?
Les hommes politiques français ont brillé jadis, d’une certaine façon, par leur exigence, leur originalité, la richesse de leurs analyses. Il y a une singularité française de ce point de vue : l’idée que le « bagage propédeutique » était nécessaire pour s’emparer des questions politiques, et au-delà, que la connaissance du monde était un préalable pour servir le pays.
Mais les postulants aux plus hautes fonctions n’avaient pas seulement ce parti pris intellectuel humaniste, ils avaient aussi, sur le plan moral, une discipline citoyenne, c’est-à-dire l’exigence de rechercher un intérêt général au-dessus de leurs intérêts particuliers. La morale et la culture se rejoignaient pour dégager, au-delà de son cadre et de son expérience personnelle, des vérités plus larges, des lois plus générales, qui permettaient d’énoncer des nécessités collectives.
Même aujourd’hui, il existe encore une certaine foi dans le rôle de la parole. La légitimité intellectuelle reste convoitée, certes, mais partout on observe un repli de la grande parole politique originelle. J’ai été l’un des rares Premiers ministres à faire une conférence de presse mensuelle. C’est très significatif, car se soumettre aux questions, c’est accepter de rendre des comptes.
L’homme de parole s’engage, rend compte, car la parole politique est un acte. Ce que l’on constate, c’est que l’homme de parole s’efface désormais derrière la communication. La prérogative de la parole et des idées, il la délègue à d’autres. Il se retire de la scène, et laisse sa place à des spécialistes qui fabriquent des dispositifs de communication dans des usines sophistiquées, lesquelles envoient des messages subliminaux à la société par les canaux complexes des médias contemporains. On infuse des images, on distille des concepts, on multiplie les chemins d’approche, en utilisant les outils de ce qui est devenu une véritable science de la communication.
La conséquence de cette disparition progressive de l’homme de parole en politique, c’est sa perte vertigineuse de crédibilité. Perte de crédibilité s’il parle, car dire, c’est s’engager, et notamment à tenir ses promesses. Or, nous savons ce qu’il en est des promesses de campagne. Et perte de crédibilité aussi s’il ne « parle » pas, car ne pas s’engager, c’est disparaître du champ politique. Il faut, face à cette situation, renouer avec une culture du risque et de la responsabilité. Risque de parler, et donc risque d’être contredit par les faits. Responsabilité de dire ce que l’on peut et doit dire, et non ce qu’il est payant de dire. Le jour venu, il faudra pouvoir rendre compte de ses paroles, plutôt que de s’en remettre à des fabricants d’écrans de fumée et de halos émotionnels pour masquer un bilan concret.
L’unité de la parole est la promesse d’une maîtrise humaine du monde et de ses enjeux. C’est un défi à relever pour l’humanisme : les savoirs étant de plus en plus nombreux et plus vastes, un seul homme ne peut les maîtriser. L’âge est révolu où savoir « un peu de tout » suffisait à embrasser la connaissance universelle. La tentation est forte, dès lors, de ne pas maîtriser le moindre savoir, de déclarer forclose la période où le bagage propédeutique était une condition sine qua non pour accéder aux plus hautes charges, voire aux charges tout court. De là un certain mépris de l’instruction, une fierté nouvelle à « être comme tout le monde », c’est-à-dire supposément ignorant.
Les attaques très violentes du président de la République contre la Princesse de Clèves, ou de tel secrétaire d’État faisant référence à la leçon de vie décisive qu’il avait trouvée dans la lecture de ce chef-d’œuvre inconnu, Zadig et Voltaire, qui est en réalité une marque de vêtements, sont les signes d’une époque où les hommes politiques prennent la complexité du monde comme un passeport pour l’ignorance volontaire, et notamment l’ignorance de notre propre culture. C’est en un sens la logique de la politique de favoriser une identification de l’homme politique avec un « homme moyen » supposé.
On voit bien que le langage politique a évolué, certains responsables s’ingéniant à tordre la langue pour parler comme « tout le monde », c’est-à-dire personne. Il y a là une opération de transfert vers le vide, d’identification à une abstraction – l’homme moyen –, qui tue selon moi l’idée même de la politique, car si un « n’importe qui » introuvable, un Monsieur Tout-le-monde inexistant peut être président ou ministre, toute la force morale de la politique disparaît. Ceux-là estiment avoir le droit de ressembler à tout le monde, comme si « tout le monde » était dénué d’idées et de culture. Allons à la conséquence morale : celui qui veut ressembler à tout le monde méprise tout le monde, et lui-même en passant.
À certains égards, l’humanisme est aussi un aristocratisme étendu à tous, une exigence humaine universelle d’aller vers le haut. En matière politique, la conséquence en est que le responsable doit être un exemple, s’afficher à la hauteur humaine la plus élevée possible, s’il veut convaincre et donc entraîner. Nous autres Français sommes convaincus qu’il existe une sorte de nécessité charismatique de l’homme politique, si l’on veut que la politique ait de la force, de l’élan.
Le désir de distinction, c’est-à-dire la recherche permanente du meilleur en soi et chez les autres, doit rester la loi intérieure des hommes politiques et des citoyens. Il faut dire fermement ceci : la distinction, c’est exactement le contraire du mépris. C’est l’exigence du meilleur pour soi et pour les autres. Les élites politiques feraient bien de remettre cette exigence à l’honneur.
Et puis l’humaniste se construit par des rencontres, par une relation directe, d’homme à homme. Dans cette tradition, le souci philosophique de l’homme doit partir d’une curiosité pour les personnes en chair et en os, afin de faire la part de la sensibilité, des émotions, avant d’aboutir sur le terrain intellectuel et faire la part de la raison. En politique, la marque de cette idée, c’est le détour par le peuple. Par la poignée de main, par la rencontre dans les cages d’escalier… C’est l’idée de l’expérience partagée, de la rencontre avec des hommes et des femmes en situation.
Cette relation directe tend à s’effacer, au profit d’une logique d’intermédiation, de sous-traitance aux partis politiques de la relation avec les personnes. La présence sur le « terrain », pourtant considérée comme la source de toutes les bonnes idées, on ne l’envisage qu’après avoir pris un luxe de précautions incroyable, et on ne la réalise qu’en déployant un de ces dispositifs de communication – et de sécurité – que j’ai évoqués. Tout est préparé, minuté, aseptisé et le « bon peuple » est tenu à distance derrière les barrières pour éviter tout incident. Donc, la relation directe s’efface, au profit des sondages, et de la fameuse « opinion ».
De là, une certaine abstraction de la vie politique : on joue sur des photos, des éléments de langage, des story tellings, des concepts… Et on ne va plus sur le terrain comme François Mitterrand ou Jacques Chirac, qui y trouvaient une sorte de baptême laïque, de régénération. On y va pour donner le spectacle de cette alliance profonde du peuple et de ses dirigeants, car on sait que le mythe est vivant, mais désormais pour toute sortie du président on vide le centre de la ville, en remplaçant les citoyens par des militants de son parti. C’est un spectacle, une véritable construction cinématographique, avec ses figurants. C’est de la proximité Potemkine.
Enfin, nous avons un autre défi : le règne de l’individu roi, qui est le contraire du citoyen roi. Le citoyen est une personne maîtresse d’elle-même, qui avance en conscience, dotée d’une forte exigence intérieure. Au contraire, l’individu dont je parle ici est centré sur ce qu’il croit être sa satisfaction, sur ses opinions, sur ses passions. Dans l’organisation du paysage politique actuel, la primauté faite aux passions individuelles affaiblit le rôle de la raison et de l’esprit critique.
Une des conséquences de cette défaite de la raison est bien sûr la tyrannie de l’instant, l’intimidante injonction de l’urgence dans le champ politique. La réflexion, le sain réflexe de remettre les événements en situation, en perspective, passent au second plan, et le « coup par coup » sans cohérence devient la marque de l’action politique, ou plutôt de son apparence.
Source: Revue des Deux Mondes – Septembre 2011 – Entretien avec Marin de Viry
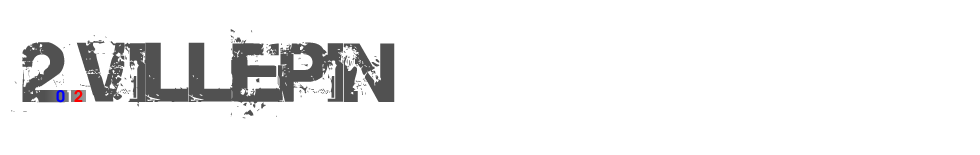


Sommes nous de véritables citoyens, des courtisans, ou des citoyens en devenir ? Si la séparation des pouvoirs est une condition pour le devenir, nous sommes en bonne voie.
« Revenir aux sources humanistes de la politique, c’est d’abord faire des citoyens, ou plus exactement renouer avec la tâche jamais achevée qui consiste à promouvoir l’apparition de ce type de Français : un citoyen éduqué, actif, ardent, fort de son statut. »
- Car.. c’était la France.
Elle est tombée depuis le Non de l’égo, centriste Giscard lors d’un référendum, puis fracassée avec l’égo, centriste rose plein de rancune gaulliste, puis entretenue à terre pendant deux mandats par le gentil centriste et chef du RPR, et ridiculisé par un petit homme de droite, centre droit et maladroit.
- DDV, donnez nous « à boire », nous avons si « soif d’idéal », de travail et de justice.
Car après le « d’abord » dit par DDV, il faut faire de l’ensuite, et à long terme.
Pour faire les deux, il faut un Homme -sens générique- Un grand Président.
Afin de refaire enfin un pays, une France. C’est d’elle qu’il s’agit en fait.
Car les français passent.. hélas.
Ils se regandent trop au présent, pas assez au futur.
Les politiques sont donc ainsi, aussi.
Hors ceux.. sur les doigts d’une main, ils se comptent.