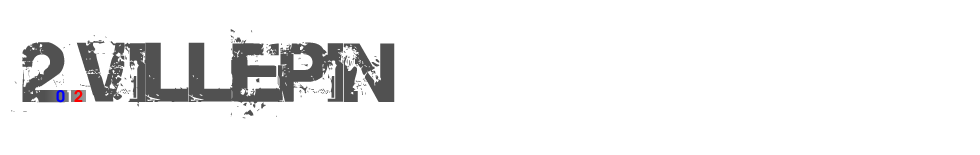Depuis janvier, Dominique de Villepin multiplie les visites dans les quartiers populaires. Perçu comme l’anti-Sarkozy, il est souvent bien accueilli par les jeunes issus de l’immigration qui n’ont pas oublié son non à la guerre d’Irak, porté en 2003 aux Nations unies.
Cinq ans après le drame de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le Premier Ministre à l’époque des faits analyse la situation dans les cités.
Libération: Vous avez été confronté, en 2005, à une révolte des banlieues. Quelle était votre priorité?
Dominique de Villepin: Le double souci de la cohésion nationale et de l’ordre républicain. Les violences étaient inacceptables et la fermeté s’imposait. Mais il fallait aussi rechercher le dialogue. C’est pourquoi j’avais jugé nécessaire de faire des gestes forts: recevoir à Matignon les familles des deux victimes de Clichy-sous-Bois et multiplier les concertations avec tous les acteurs des banlieues. Sous l’autorité du Président de la République, je me suis efforcé de coordonner l’action du ministre de l’Intérieur et des ministres chargés des questions économiques et sociales.
Vous aviez décrété l’état d’urgence contre l’avis de Nicolas Sarkozy…
Il avait des réticences. Mais des mineurs des quartiers étaient exposés, et j’estimais que nous ne pouvions pas prendre le risque de voir l’autorité de l’Etat davantage mise en cause. D’ailleurs, dès qu’il a été en place, on a assisté à un reflux.
Que retenez-vous de vos visites en banlieue?
Il y a toujours le même manque de reconnaissance et l’absence d’avenir. Les violences de 2005, c’était un cri d’alarme. Ces quartiers s’interrogent sur leur place dans la République: près de la moitié des mineurs y sont dans une situation de pauvreté. Partout, j’entends la demande d’une parole politique forte. Je vois des quartiers qui ont des difficultés, mais aussi beaucoup d’énergies, avec des enjeux concrets, loin du bruit médiatique.
Trente ans de politique de la ville, cela n’a-t-il servi à rien?
On ne peut changer les choses sans changer notre regard et notre méthode. Le pilotage doit être local, autour du maire, avec les associations. Car l’échec, c’est avant tout celui des plans imposés d’en haut. En 2007, un énième plan a été lancé, essentiellement financé par des redéploiements de crédits. Pour quels résultats? Au fond, la politique reste marquée par la méconnaissance et la peur des banlieues. A quoi s’ajoutent des amalgames, sur les citoyens d’origine étrangère, la loi sur la burqa ou encore le débat sur l’identité nationale. C’est dommage car, au lendemain de l’automne 2005, mon gouvernement avait fait un grand pas pour renouveler l’approche, en mettant l’humain au coeur de la question des quartiers, avec le service civl, le CV anonyme, les contrats de responsabilité parentale. Malheureusement, beaucoup de ces chantiers ont été abandonnés ou profondément altérés.
Que faut-il faire, selon vous?
Il faut dépasser les visions partisanes. La gauche a longtemps cédé à la tentation de la victimisation, et la droite à celle de la stigmatisation. Remettons la question sociale au coeur de nos préoccupations. Pour donner une place à chacun, le premier pilier c’est une réforme d’ampleur de l’éducation. Je propose qu’on reconnaisse d’abord un droit individuel à l’enseignement prioritaire. Les élèves recevraient une dotation allouée à leur classe, ainsi qu’un accompagnement personnalisé et une ouverture culturelle extrascolaire. Constituons ensuite un corps d’enseignants spécialisés, de plus de dix ans d’expérience, mieux rémunérés. Enfin, les élèves des quartiers sont victimes d’un collège unique tourné vers l’imitation du lycée général. Il faut imaginer des transitions plus souples, des méthodes plus proches de l’école élémentaire. Second pilier, l’emploi et surtout celui des jeunes, notamment à travers la mise en oeuvre de pourcentages de jeunes en emploi, en alternance ou en formation au sein des grandes entreprises.
Ouvrir à la diversité, aider les plus méritants, n’est-ce pas un progrès?
Internat d’excellence, accession à la propriété pour les classes moyennes émergentes, assouplissement de la carte scolaire… très bien, mais que fait-on de tous les autres? En donnant l’impression de vouloir « sauver » les plus méritants, on reste dans une logique de relégation tout en se donnant bonne conscience. Quoi qu’on dise des facteurs culturels, la vérité, c’est que l’égalité des chances n’est pas au rendez-vous. On est dans des schémas de reproduction. Les élites restent les élites; les plus défavorisés restent les plus défavorisés. Et le fossé se creuse.
Des jeunes issus de l’immigration ont rejoint votre parti. Vous êtes aussi membre de l’UMP. Comment s’articulent ces deux engagements?
Ils sont une chance pour la France. Comme gaulliste, je ne me résigne pas à appartenir à une famille politique qui serait celle du rejet et se droitiserait sans état d’âme. L’excès, la surenchère, le discours de Grenoble, je veux croire que ce n’est qu’une parenthèse. Au sein de la majorité, je le sais, beaucoup sont prête à me soutenir et le feront savoir le moment venu. République Solidaire est un mouvement indépendant qui a une grande ambition: définir les enjeux majeurs pour les dix prochaines années et faciliter les compromis entre les formations politiques, tout en restant ferme sur les principes républicains. Sans un accord sur la lutte contre les déficits, le pacte éducatif, l’innovation et la compétitivité ou la politique étrangère, la France décroche, s’abaisse et disparaît des écrans radars du monde.
Source: Propos recueillis par Alain Auffray et Thomas Hofnung (Libération)