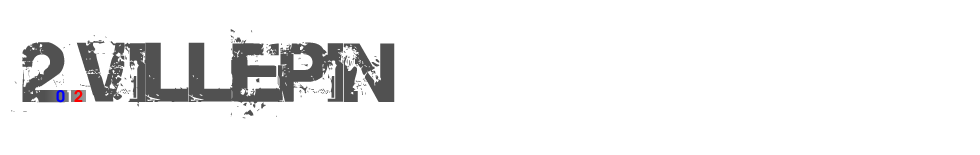De l’Afghanistan aux retraites, l’ancien premier ministre aligne critiques et contre-propositions. En assumant l’échec du CPE : “La stratégie du seul contre tous n’est pas une solution. »
Le remaniement, qui devrait intervenir dans les jours ou les semaines qui viennent, marquera incontestablement un tournant dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Le président vient de revenir sur son annonce, faite avant les régionales de mars, de faire une «pause» en 2011 : le 13 octobre, il a annoncé son intention de continuer sur la voie des réformes jusqu’à la fin de son mandat, en recevant les députés du Nouveau Centre. Le nouveau gouvernement sera de toute façon celui d’un président qui s’apprête à engager sa campagne de 2012.
Période charnière qui offre l’occasion de dresser un premier bilan de l’action menée depuis mai 2007 par le chef de l’État. Dominique de Villepin, le premier, s’est prêté à l’exercice. Place de la France dans le monde, politique intérieure, choix économiques, son jugement est sans concession : pour lui, ce quinquennat risque de discréditer l’idée même de réforme dans l’esprit des Français.
Jamais un ancien premier ministre n’avait jugé aussi sévèrement un président de la République appartenant à sa famille politique.
Comment analysez-vous la place de la France sur la scène internationale aujourd’hui ?
Je vois malheureusement se dessiner un double mouvement : une perte d’initiative et, partant, un rétrécissement de son rôle sur la scène mondiale. C’est particulièrement inquiétant en un temps où la mondialisation accélère le rythme de la vie internationale et exacerbe les compétitions. Nous avons un défi à relever : celui du basculement de la richesse au bénéfice des pays émergents, dont la Chine qui produit à elle seule 50 % de la croissance mondiale. Et nous voyons, dans le même temps, la France passer à côté d’occasions formidables, à Abou Dhabi ou en Chine, et accumuler les retards en Afrique, en Asie ou en Amérique latine…
Pour quelles raisons ?
Autant il serait injuste de rendre le gouvernement actuel seul responsable de ces échecs – la crise est là, et nos concurrents ne sont pas manchots –, autant il faut voir les choses comme elles sont : notre stratégie globale n’est pas à la hauteur des enjeux.
Prenons un exemple concret : où est la décision forte susceptible de remettre de l’ordre dans notre filière nucléaire ? La France a laissé Siemens se détacher de nous et les Allemands traiter avec les Russes.
Où en est notre réflexion sur les secteurs d’excellence qui peuvent permettre à la France de concurrencer la Chine ? Pour avoir cru trop longtemps que celle-ci se contenterait d’être l’atelier du monde, nous avons négligé de voir les choses en face et la voici aujourd’hui capable de réaliser des produits de haute technologie parfaitement compétitifs…
Bref, où en est notre politique industrielle ? Nous nous contentons de défendre ce que nous avons – et l’histoire est là pour démontrer l’échec de toutes les politiques défensives – au lieu de contre-attaquer là où nous sommes les meilleurs. Hiérarchisons les priorités et admettons que nous ne sommes pas les plus forts partout afin d’emporter la décision quand la première place est à notre portée.
C’est une bonne chose d’avoir lancé le grand emprunt et d’avoir créé un fonds stratégique d’investissement. Mais pour quoi faire ? Pour retarder l’inéluctable ou pour partir à la conquête de nouveaux marchés ?
Idem pour l’autonomie des universités. J’en soutiens ardemment le principe. Mais que prévoyons-nous pour qu’elles soient plus performantes et mieux reconnues dans la compétition mondiale ? Que fait-on pour mobiliser, comme aux États-Unis, les meilleurs cerveaux vers la recherche, plutôt que d’en laisser partir tant vers le management ? Comment unir les forces des universités et des grandes écoles ?
Ce qui nous manque plus que jamais, c’est une vision stratégique à cinq, dix, vingt ans. Le tourbillon des mots ne parvient plus à masquer l’étrange frilosité dont nous faisons preuve pour relever les défis de la crise : nous sommes dans l’attitude passive du rentier qui consiste à défendre ce qu’on possède plutôt qu’à se battre pour ce qu’on pourrait avoir. C’est une conception d’autant plus dangereuse qu’elle ne nous met pas à l’abri, paradoxalement, de perdre ce que nous possédons ! Sachons redéfinir notre modèle économique en pariant sur la formation et la qualification.
Voyez l’industrie du luxe, l’agroalimentaire, le tourisme, qui sont des secteurs traditionnels de rayonnement de notre pays : ils ne prospéreront que si nous investissons encore et toujours pour les moderniser.
Je vous le dis franchement : la situation du tourisme français m’inquiète. Là où d’autres pays font un travail extraordinaire de mise en réseau de leurs infrastructures et diversifient leur offre pour couvrir des publics extrêmement différents, nous manquons, une fois encore, d’une stratégie globale.
Voilà pour la toile de fond économique de notre rayonnement. Et du point de vue diplomatique ?
On ne peut nier, de fait, que Nicolas Sarkozy soit présent sur tous les fronts… Je vous ferai la même réponse : certes, mais pour quoi faire ? Revenons un instant aux fondamentaux : quelle est la valeur ajoutée de la France dans la gestion des crises ? Sa capacité à proposer des solutions de bon sens sortant des sentiers battus – qui ne mènent nulle part, on l’a vu, sous Jacques Chirac, pour le conflit israélo-palestinien et la guerre d’Irak –, tout en rappelant certains principes intangibles de paix et de justice. Force est de constater aujourd’hui que cette capacité et cette volonté se sont fortement émoussées…
Prenons l’exemple de l’Afghanistan. Nous sommes engagés là-bas depuis bientôt dix ans sur la base d’une décision tout à fait légitime du Conseil de sécurité de l’Onu, consécutive aux attentats du 11-Septembre. Il n’est pas inutile, à l’épreuve des faits, de s’interroger sur le bilan de cet engagement qui a coûté tant de vies.
Le résultat est clair : cette intervention, conçue théoriquement pour défendre les intérêts du peuple afghan face à l’implantation, sur son sol, de réseaux terroristes, est désormais perçue par les intéressés comme une occupation étrangère, renforçant les talibans sur le terrain. Au point que le président Karzaï, soutenu par l’Occident, se dit prêt à négocier avec ces mêmes talibans…
Face à cette situation, on entend la voix de l’Amérique, celle de ses alliés qui, les uns après les autres, envisagent de se désengager… Quant à la France, elle se tait ! Elle se tait alors que son histoire, depuis deux siècles, a fait d’elle le pays le plus à même de tirer les conséquences géopolitiques et militaires de ce type de conflit.
Vous pensez à la guerre d’Algérie ?
Mais pas seulement ! Je pense à l’Espagne, occupée par l’armée napoléonienne entre 1808 et 1814, mais aussi à l’Indochine, entre 1946 et 1954 ! Les guerres de partisans, nous savons y faire face. Mais nous savons aussi ce qu’elles coûtent, comment elles se terminent, et ce qu’elles font perdre de crédit aux puissances qui s’y enlisent. Un crédit que la France a retrouvé en s’opposant, en 2003, à l’intervention américaine en Irak et que la guerre d’Afghanistan met, je le crains, à rude épreuve…
Vous admettez cependant que partir sans préavis serait interprété comme une victoire pour les talibans…
C’est parce que je l’admets que je propose tout le contraire d’un départ brusqué ! La diplomatie, comme la vie, consiste à créer et à exploiter les circonstances. Ce qu’il faut éviter à tout prix, c’est de créer un vide en Afghanistan. Et ce vide peut tout aussi bien provenir d’un enlisement qui déboucherait sur un drame que d’une décision politique irréfléchie. Entre les deux, la seule voie qui vaille passe par un calendrier concerté de retrait, seul moyen de préparer l’avenir en associant les États de la région à un règlement pacifique du conflit.
Quand une intervention militaire n’est pas souhaitée par ceux qui sont censés en bénéficier, elle doit cesser. Mais elle ne peut cesser dans de bonnes conditions qu’en laissant après elle une situation meilleure que celle qui prévalait auparavant.
Comment ? En responsabilisant, non seulement le gouvernement afghan, mais les grands États voisins, sur lesquels repose, en dernier ressort, la stabilité de la région.
Que se passe-t-il en ce moment ? Le choix du tout-militaire, qui ne résout rien sur le terrain, déresponsabilise le gouvernement afghan qui, doté d’un filet de sécurité somme toute commode, peut jouer double ou triple jeu. Il est, en quelque sorte, en apesanteur. Si le calendrier d’un retrait lui est soumis, cela le place à nouveau dans la pesanteur. Il est forcé
de prendre ses responsabilités.
Deuxième vertu de ce calendrier : réintroduire dans le jeu les puissances régionales que sont le Pakistan, l’Inde, l’Iran, la Chine et la Russie. Leur rôle, pour l’heure, est parfaitement passif : ils regardent, avec plus ou moins d’inquiétude ou de satisfaction, l’Occident s’enliser…
Si la France prenait l’initiative de proposer un calendrier de retrait, assorti d’une conférence régionale sur l’Afghanistan, elle créerait un électrochoc qui aurait pour vertu de rebattre instantanément les cartes : elle démontrerait qu’à ses yeux, la sécurité de ce pays n’est plus seulement l’affaire de l’Otan, mais bien celle des États de la région, qui n’ont pas plus intérêt que nous à voir s’installer le chaos.
Puisque nous parlons de chaos, il y a aussi la question du nucléaire iranien…
Et dans ce dossier aussi, je dois dire que l’absence de la France me stupéfait… Nous avons décrété des sanctions. Parfait. Mais nous constatons que ces sanctions ne règlent rien. Si demain l’Iran annonce fièrement qu’il possède l’arme nucléaire, vous imaginez l’humiliation et le risque pour l’Occident ? La sagesse ne serait-elle pas, parallèlement aux sanctions, d’indiquer une porte de sortie honorable à l’Iran qui, de fait, aurait beaucoup à gagner économiquement à la levée de l’embargo ? Sachons manier la carotte et le bâton pour obtenir la suspension du programme d’enrichissement d’uranium.
Pourquoi la France ne prend-elle pas, à votre avis, la responsabilité d’initiatives, tant en ce qui concerne l’Afghanistan que le nucléaire iranien ?
Pour la simple raison qu’en décidant de réintégrer le commandement intégré de l’Otan, nous avons sacrifié notre carte maîtresse : celle de notre indépendance. Notre indépendance militaire, bien sûr, mais beaucoup plus largement, notre indépendance d’esprit. Celle qui rend audible quand on ouvre la bouche parce qu’on a soi-même montré l’exemple du non-alignement.
Nicolas Sarkozy avait “vendu” à l’opinion l’idée selon laquelle la France, en réintégrant l’Otan, serait mieux à même de peser sur les choix de nos alliés et d’oeuvrer en faveur de l’Europe de la Défense. Je constate que sur le chapitre de ses intérêts stratégiques, la France se tait comme jamais elle ne s’est tue depuis 1958…
Quand la France a présidé le Conseil européen, au second semestre 2008, elle s’est fait entendre sur la gestion de la crise économique…
J’ai salué, à l’époque, les initiatives de Nicolas Sarkozy en faveur d’une meilleure régulation financière. Mais que s’est-il passé depuis ? Non seulement on a peu avancé sur les sujets clés que sont le renforcement du G20, la lutte contre les paradis fiscaux, les garanties à apporter à la solvabilité des banques, mais malheureusement des divergences se sont creusées entre les États et, notamment, ce qui m’inquiète le plus, entre la France et l’Allemagne…
Je souhaite de tout coeur que la présidence du G20 assumée à partir du mois prochain par la France nous permette d’en aplanir certaines, mais là comme ailleurs, notre position s’est affaiblie : notre rôle dans la dynamique franco-allemande n’est plus ce qu’il était.
Vous faites allusion aux difficultés relationnelles notoires entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ?
Elles ne sont que l’écume d’une question plus vaste : nos intérêts nationaux fondamentaux ont recommencé à diverger.
Et vous trouvez que la France ne fait pas assez d’efforts pour y remédier ?
J’ai un souvenir très précis de mon baptême du feu comme ministre des Affaires étrangères, lors du dîner de Blaesheim qui, traditionnellement, réunit le président français et le chancelier allemand à la veille des sommets bilatéraux. C’était en 2002 et nos deux pays connaissaient un lourd contentieux agricole. Il était urgent de crever l’abcès. Je me souviens encore de Jacques Chirac interrompant la conversation et, regardant Gerhard Schröder droit dans les yeux après un long silence, lui lançant textuellement ceci : « Je reconnais mes torts lors de la négociation du traité de Nice en 1999- 2000. J’ai voulu forcer la main de l’Allemagne et le résultat de notre affrontement a été un mauvais traité dont nous payons vous et nous les conséquences. Eh bien, à partir de maintenant, plus jamais cela : nous allons mettre tous les sujets sur la table et en parler franchement afin qu’à chaque divergence, chacun puisse faire la moitié du chemin. »
Ce parti pris d’ouverture reste pour moi une grande leçon de politique internationale et de politique tout court.
Comment, aujourd’hui, faire avancer l’Europe sans avoir dégagé des zones d’intérêts convergents, solides et durables ? Faute d’avoir examiné franchement nos contentieux, nous nous sommes mis d’accord sur le plus petit dénominateur commun. Par exemple, MmeCatherine Ashton, pour incarner l’Europe sur la scène internationale…
De sorte que nous mettons en place, ces jours-ci, un service diplomatique européen de plusieurs milliers de fonctionnaires sans disposer du plus petit embryon d’accord sur les dossiers chauds du moment. Je ne parle même pas de politique étrangère commune : je pense à la définition d’une position cohérente sur l’Afghanistan, sur le Moyen-Orient ou sur les relations entre l’Europe et les États-Unis…
Ajoutez à cela la démobilisation de la diplomatie française, malgré l’un des réseaux les plus performants du monde, et vous comprendrez l’inquiétude qui est la mienne quant à la défense effective de nos intérêts…
Revenons sur la scène intérieure, où nous avons connu une crise économique sans précédent.
Le gouvernement a mal évalué les conséquences de la crise économique et financière. Des promesses avaient été faites en 2007 mais la crise financière internationale a profondément modifié la donne. Le courage, ce n’était pas de vouloir honorer à tout prix des promesses qui n’avaient plus de raison d’être. C’était de reconnaître la nécessité de s’adapter à une nouvelle conjoncture, pour défendre l’intérêt national.
Reconnaissons que Nicolas Sarkozy n’a pas été aidé par cette crise…
Certes, mais une partie importante de nos déficits est structurelle, indépendante de la crise. Là où nous attendions modernisation, adaptation à la mondialisation, nous n’avons vu que confusion et enlisement. Et il est une réalité dont il faut bien avoir conscience : nous avons perdu du terrain. C’est l’origine d’une partie du malaise français, de l’inquiétude viscérale que les choses ne sont pas prises en main. Avec un profond sentiment, amplificateur d’injustice, qui génère un blocage irrémédiable. Le malaise vient notamment, et c’est particulièrement grave dans un pays comme la France, de la perte de l’autorité de l’État. Historiquement, l’État est la colonne vertébrale de la France. Aujourd’hui nous avons perdu nos repères politiques fondateurs. Parce que seule la justice donne la légitimité, et l’autorité de l’État, cohérence et force à l’action politique. Ensuite, le sentiment que l’effort n’est pas partagé.
C’est bien là que bute la réforme des retraites, considérée comme injuste par une majorité de Français. Tout d’abord, je veux le dire, cette réforme était nécessaire. Mais si elle passe en force, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Les Français ont le sentiment d’accumuler les efforts à la fois par l’augmentation du nombre d’annuités et par la modification de l’âge légal de départ avec une retraite à taux plein. C’est un enjeu essentiel pour les carrièr
es incomplètes, c’est-àdire près de la moitié des femmes, qui risquent d’être amenées pour beaucoup d’entre elles à travailler effectivement jusqu’à 67 ans. La réforme des retraites a agi comme un révélateur. Même si les Français sont convaincus de la nécessité de la réforme, ils ne supportent plus l’injustice.
Selon vous, ce sentiment d’injustice va au-delà de la réforme des retraites ?
Bien sûr. Le malaise a commencé à grandir avec les relations coupables entre le pouvoir et l’argent, le style de vie de ceux qui nous gouvernent et ce sentiment permanent qu’il y a deux poids deux mesures. Sans égalité des citoyens devant la loi, sans égalité fiscale, sans égalité devant l’effort. Prenons l’exemple de la suppression des 100 000 fonctionnaires, typique d’une politique aveugle provoquant à juste titre une impression de désorganisation. Que voit-on dans deux grands domaines, l’école et l’hôpital, au coeur de la vie des Français ? Les écoles les plus touchées sont celles qui sont le plus en difficulté. L’affichage de deux, trois ou quatre enseignants supprimés a eu un effet démultiplicateur, induisant des problèmes de remplacement qui entraînent eux-mêmes le dysfonctionnement d’établissements entiers.
Nous assistons exactement au même phénomène au sein de l’hôpital. La règle “un fonctionnaire sur deux partant à la retraite non remplacé” aurait dû échapper à une application strictement comptable. D’autant qu’aujourd’hui, la première des injustices, c’est le chômage des jeunes. Nous ne pouvons nous permettre une génération sacrifiée. C’est pourquoi je propose de concentrer tous les efforts sur l’emploi des jeunes, en poussant les grandes entreprises à s’engager à embaucher des jeunes, en emploi, en formation, en alternance en nombre représentatif.
Néanmoins le gouvernement s’attaque avec vigueur aux déficits, dans le budget 2011…
Nous sommes passés d’un excès de dépenses avec, au début du quinquennat, une période où l’argent a été distribué par milliards, à une rigueur brutale, même si elle n’est pas avouée. Ne sommes-nous pas en train de perdre sur les deux tableaux ? L’année 2011 sera médiocre sur le plan de la reprise parce que nous avons à la fois un problème de déficit et un problème de croissance. C’est là qu’il aurait fallu combiner intelligemment ces deux axiomes, en trouvant le juste équilibre, l’alchimie exacte entre croissance et nécessité de traiter la dette. Nous ne pouvons mener cette entreprise seuls. La solution se trouvait dans une concertation à l’échelle européenne. Non pas pour nous imposer ce remède de cheval qui va sans doute finir par nous tuer les uns et les autres mais pour définir une politique commune, inscrite dans la durée, de réduction des déficits.
J’ai toujours dit qu’il nous faudrait douze années pour revenir à l’équilibre budgétaire. La promesse de revenir à 3 % de déficits en 2013 ne pourra être tenue. C’est avec nos partenaires européens, et en premier lieu les Allemands, qu’il fallait trouver une ligne de convergence et bâtir cet échéancier, bien moins violent et beaucoup plus efficace sur le plan économique, en maintenant l’investissement dans les dépenses d’avenir. Nous avons fait le choix d’une rigueur extrême, mal dosée, reposant exclusivement sur la diminution de la dépense et tournant le dos à l’effort fiscal. Pourtant, une hausse d’impôts serait consentie si elle était juste.
Vous trouvez que l’État a perdu sa crédibilité ?
Ce gouvernement agit à contretemps. C’est décidément l’une des marques de fabrique de ce quinquennat dont je crains qu’il ne finisse par discréditer l’idée même de réforme dans l’esprit des Français. Prenons l’exemple de la défiscalisation des heures supplémentaires. Ou encore du travail le dimanche. Étaient-ce, dans une période si tendue sur le marché de l’emploi, les bonnes mesures à prendre ? Nous sommes confrontés à des problèmes de sécurité majeurs. La loi sur la burqa était-elle vraiment nécessaire ? Tout comme le discours de Grenoble sur la déchéance de la nationalité française, établissant cette distinction aussi odieuse que scandaleuse entre les citoyens français et les citoyens d’origine étrangère. Qui va croire que la déchéance de nationalité, qui va peut-être concerner un cas par an, va régler quoi que ce soit en matière d’insécurité ? On voit bien le calcul politicien qui se cache derrière ces mesures. Au lieu de concentrer notre énergie pour faire face à nos difficultés économiques et sociales, nous mettons en place des stratégies idéologiques partisanes qui nous divisent et nous affaiblissent. Sans rétablir l’ordre pour autant.
Ce choix constant de l’idéologie conduit à bloquer notre pays. C’est manifeste dans la réforme des retraites. Le gouvernement aurait pu trouver le juste équilibre, en acceptant de revenir sur le taux plein à 67 ans. Il aurait ainsi sauvé le coeur de la réforme – et sa ressource principale– avec le passage de l’âge légal de 60 à 62 ans. Un compromis aurait pu être trouvé. Mais le président de la République est convaincu qu’avec sa posture de “capitaine Courage”, il construit la statue qui va lui permettre d’être élu en 2012. C’est l’inverse qui va se passer. La stratégie du “seul contre tous”, du “pouvoir contre le peuple” ne peut mener qu’à l’échec. Je le dis en connaissance de cause, j’en ai payé le prix lors du CPE, où je me suis trouvé enfermé dans un piège, pour des raisons à la fois juridiques et politiques. Essayons d’éviter de répéter toujours les mêmes erreurs. Faire la moitié du chemin pour trouver un compromis est une clef, aussi bien sur la scène internationale que nationale. Ce choix était simple, le gouvernement n’est pas en train de le faire. C’est le seul moyen aujourd’hui de combiner la justice et l’audace, en préparant une réforme concertée pour mettre en place un régime de retraite à la carte, crédible, moderne et durable.
Je crains que la confusion ambiante ne conduise à une fuite en avant. Les Français ressentent déjà cette agitation gouvernementale, faite de réformes inachevées et aussi d’inflation législative, avec cette manie de faire une loi après chaque fait divers dramatique. Le président donne le sentiment de tout faire seul, de l’Élysée, alors qu’à l’évidence c’est impossible. Il n’en a ni les leviers ni les outils. Finalement, l’hyperprésidence se traduit par une hyperimpuissance.
Quelles leçons tirez-vous de ces trois dernières années ?
Cette expérience, je l’espère, se limitera à une parenthèse politique. Nous avons besoin de revenir à un véritable équilibre institutionnel entre le président de la République et le premier ministre, entre l’exécutif et le Parlement. Actuellement le Parlement n’est pas en mesure de jouer son rôle. De même, sans un premier ministre à sa juste place, il n’y a pas de gestion efficace possible de l’État. Ensuite, il faut se concentrer sur la justice. Dès le début du quinquennat, la politique a été placée sous le signe de l’injustice sociale. On ne peut pas réformer un pays sans un sentiment de justice et d’effort partagé, qui plus est en période de crise. Enfin, sortons le plus vite possible d’une politique nationale partisane, nourrie par l’obsession du clivage gauche-droite et qui finit par enfermer et la gauche et la droite dans l’idéologie en nous rendant incapables d’agir. Nous touchons là un problème bien français, historique : la politique en France est organisée autour de la conquête du pouvoir, de la conservation du pouvoir, mais pas de son exercice.
Pour exercer le pouvoir, il faut être capable de travailler ensemble, de faire émerger le compromis positif. No
us ne sortirons pas de la crise française, prise dans son ensemble, sans un minimum de consensus entre la droite et la gauche. Ce consensus, nous l’avions dans deux domaines. Celui de la politique étrangère, d’abord. Nous l’avons perdu, avec le retour dans le commandement intégré et la perte d’initiative française. Notre deuxième consensus, fondamental, c’était la République. Mais le gouvernement a instrumentalisé nos valeurs républicaines, nous coupant du sens de l’intérêt général. Il est urgent de rétablir le désir de vivre ensemble qui se perd aujourd’hui sous la pression de l’individualisme. C’est pourquoi je suis favorable à la création d’un service civique généralisé, fractionnable au cours de la vie, au moment où l’on aspire à se mettre au service des autres
Source: Valeurs Actuelles, Propos recueillis par Eric Branca et Josée Pochat