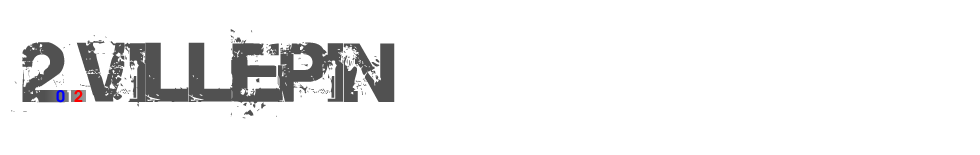Député UMP du Morbihan, François Goulard a précédé Valérie Pécresse au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au sein du gouvernement de Dominique de Villepin, dont il est un proche.
Il dresse un « bilan mitigé » de la loi sur l’autonomie des universités.
Les Echos: Quel bilan tirez-vous de la loi sur l’autonomie des universités ?
François Goulard: Un bilan mitigé. Globalement, on ne peut pas dire que c’est une mauvaise réforme. L’accroissement de l’autonomie de gestion des universités, dont elles se réjouissent, a par exemple permis, avec une certaine souplesse salariale, de faire venir un peu plus d’enseignants étrangers en France que précédemment. Mais cette réforme est loin d’être une révolution. Le management des universités n’a pas progressé en raison du mode d’élection du président et de la composition du conseil d’administration. Les conseils sont principalement dominés par les listes syndicales et le président, même si ses pouvoirs sont accrus, est dépendant. Nos universités sont comme des entreprises qui seraient dirigées par le comité d’entreprise au lieu du conseil d’administration. Il est aussi dommage que l’Etat n’ait pas été capable de transférer massivement l’immobilier dont il est propriétaire aux universités. C’est un vrai pouvoir que d’être maître de son immobilier…
L’autonomie ne met-elle pas les universités françaises en situation de concurrencer les plus grandes au niveau mondial ?
Bien sûr que non. Les universités françaises n’ont pas changé de catégorie. Cette réforme n’a pas traité les problèmes majeurs de l’université française, parce que l’on n’est pas parti d’une analyse réaliste de la situation. Le vrai sujet, pour qu’elles jouent dans la cour des grands, n’était pas l’autonomie de gestion. Le premier obstacle à l’affirmation de nos universités, c’est le management, qui n’est pas pertinent. L’autre problème, et il est de taille, c’est le recrutement des universités. Le fait qu’elles soient encombrées en premier cycle, pour à peu près la moitié de leurs effectifs, d’étudiants qui ne sont pas faits pour des études universitaires est un handicap considérable qu’on ne retrouve nulle part à l’étranger. Beaucoup de bacheliers s’orientent vers l’université par défaut et n’y ont pas leur place.
Ces problèmes doivent-ils être abordés d’ici à la fin du quinquennat ?
Ce ne sera pas le cas parce que ni la ministre ni l’Elysée n’ont conscience de cette situation. Les vrais problèmes sont très mal identifiés et évidemment non traités. Il faut réformer le management, développer des filières de type BTS mais en beaucoup plus grand nombre et plus ouvertes, opérer un vrai rapprochement entre les grandes écoles et l’université pour le troisième cycle. Les problèmes de l’enseignement supérieur, qui forment un tout, devront être traités dans le prochain projet présidentiel. Beaucoup reste à faire.
Pourquoi ne pas l’avoir fait lorsque vous étiez au ministère ?
Parce que l’on n’avait que deux ans. Et parce que ces choses-là ne sont dites par personne. L’admi-nistration centrale du ministère ne dit pas cela. C’est un constat auquel j’ai abouti au bout d’un an et demi d’exercice de la fonction.
Comprenez-vous les inquiétudes des enseignants-chercheurs sur leur indépendance ?
L’indépendance des enseignants-chercheurs ne me paraît pas mise en cause. S’il y a des problèmes dans la recherche, de recrutement comme de financement, ils ne sont pas liés à la réforme.
Source: Les Echos (propos recueillis par Pierre-Alain Furbury)