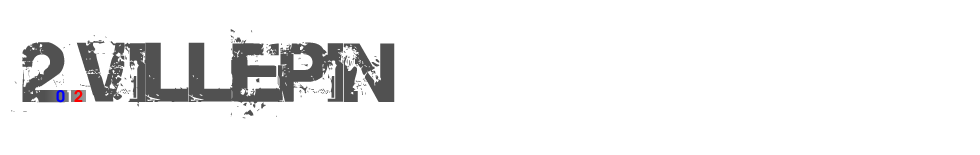Le gouvernement engage sa responsabilité devant l’Assemblée nationale, mardi 17 mars, sur une déclaration de politique étrangère. Il évite ainsi un vote sur la réintégration par la France du commandement intégré de l’OTAN décidée par Nicolas Sarkozy. L’ancien premier ministre Dominique de Villepin critique cette décision.
Le Monde: Pourquoi êtes-vous hostile à la réintégration de la France dans le commandement intégré de l’OTAN ?
Dominique de Villepin: On a présenté cette décision comme le résultat d’un processus continu de régularisation. Ce n’est pas mon point de vue. Au fil des années, nous avons pris, c’est vrai, des initiatives pour maximiser la contribution de la France au fonctionnement de l’OTAN, mais avec toujours le même souci : préserver notre position originale et singulière au sein de l’organisation. Ce qu’on nous propose aujourd’hui est une rupture politique et symbolique.
Vous voulez absolument être le défenseur du gaullisme ?
Je m’exprime moins au nom d’une fidélité ou d’une doctrine qu’au nom d’une expérience et d’une conviction. L’OTAN ne doit pas devenir une ONU bis ou le bras armé de l’Occident.
M. Chirac avait envisagé cette réintégration lorsque vous étiez secrétaire général de l’Elysée.
Oui, mais c’était en 1995, dans un contexte très particulier, juste après la chute du mur de Berlin, l’effondrement de l’URSS et la fin de la guerre froide. Les attentats du 11 septembre et la guerre en Irak ont changé la donne. Le concept de « guerre contre le terrorisme » est une aberration. La peur a conduit à renouer avec la dangereuse logique des blocs. La position originale de la France permettait de la contrecarrer. Même en 1995, je n’étais pas personnellement favorable à cette réintégration, car j’ai toujours pensé que l’indépendance de la France était intimement liée à notre singularité et à notre vocation diplomatique de pont entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud. La France n’est pas un pays comme les autres du fait de son histoire, de sa présence outre-mer, de son statut de membre du Conseil de sécurité. Tout cela nous confère des devoirs et des responsabilités, comme nous avons pu le faire en Irak. Le risque qui nous guette, c’est un rétrécissement de notre ambition et une banalisation de la voix de la France, alors même que l’affirmation de notre spécificité constituait un élément de notre identité et une garantie de protection.
Si la France avait réintégré le commandement militaire de l’OTAN, elle n’aurait pas pu avoir un message fort sur l’Irak ?
Dans cette crise, il y a eu deux aspects. L’un, consensuel, a consisté à ne pas envoyer de troupes en Irak ; l’autre, beaucoup plus audacieux, a été d’empêcher les Etats-Unis, nos très proches alliés, d’utiliser la légitimité onusienne pour valider la guerre. Nous avons mené un combat et cherché à convaincre nos partenaires qu’il y avait un risque majeur d’affrontement avec le monde arabe et l’islam. C’était le devoir de la France d’éviter ce choc entre l’Orient et l’Occident. Beaucoup d’hommes politiques ne nous suivaient pas et plaidaient pour que la France ne fasse pas de vagues. Je crains que, désormais, nous ne puissions plus nous autoriser cette audace.
Le contexte a changé. N’est-il pas temps d’évoluer ?
Je ne veux pas faire de procès d’intention à Nicolas Sarkozy. Nous aurons très vite l’occasion de vérifier si nous sommes capables ou non de préserver une position originale. Ainsi en Afghanistan, Barack Obama a décidé d’augmenter la présence militaire américaine. Saurons-nous faire prévaloir notre propre vision ? En 2001, les choses étaient claires, il s’agissait de lutter contre un sanctuaire du terrorisme ; aujourd’hui, l’échec est patent. La présence de troupes étrangères coalise contre elles une grande partie des forces de ce pays. J’estime qu’il n’y a pas de solution militaire et qu’il faut entrer dans un processus de désengagement, couplé avec une nouvelle stratégie régionale et un fort soutien économique et social.
Ne faut-il pas renoncer à la singularité française, qui irrite nombre de nos partenaires, pour relancer l’Europe de la défense ?
Le président de la République fait ce pari. Je crains que l’inverse ne se produise. Dans l’immédiat, le signal que nous donnons est un renforcement atlantique dont la politique européenne de défense n’est qu’un élément marginal. Là encore, les tests concrets viendront très vite. Quid de l’agence européenne de défense ? De la constitution d’un état-major européen ? De la création d’une force d’intervention rapide qui était censée atteindre l’objectif de 50 000 à 60 000 hommes ? Nous en sommes extrêmement loin.
M. Fillon a-t-il raison d’engager la responsabilité du gouvernement sur ce sujet ?
D’un côté, il reconnaît l’importance du sujet ; de l’autre, il limite la liberté d’expression de la majorité en déplaçant la question. Ce n’est plus un vote pour ou contre la réintégration mais pour ou contre le gouvernement. La question mérite pourtant un débat de fond au-delà des clivages partisans. Je déplore que vole en éclats le consensus qui existait sur notre politique de défense. Tout cela me paraît malvenu en période de crise. Concentrons-nous plutôt sur l’essentiel : la réponse économique et sociale aux inquiétudes et souffrances des Français. Je crains que l’action du président de la République ne soit entachée aujourd’hui d’une trop grande dispersion et de confusion.
Que devrait-il faire ?
Revenir à un équilibre institutionnel plus conforme à notre Constitution et à nos traditions. Nous avons besoin d’un président qui défende une vision, soit capable de rassembler. En se substituant au premier ministre, il a du mal à jouer ce rôle de sage attaché à sa fonction. Et il prend le risque de voir sa légitimité contestée. Par la force des choses, le mécontentement se tourne vers celui qui semble détenir tous les leviers et prendre toutes les décisions. Dans ce contexte, s’ouvrir à des personnalités fortes, capables de marquer un rassemblement plus large, serait un bon signal. La majorité ne manque pas de talents désireux de servir, à l’image d’Alain Juppé.
Faut-il changer de politique ?
Il faut rassembler le pays autour de ses valeurs fondamentales : l’indépendance, les principes républicains, le sens de l’intérêt général. C’est nécessaire pour retrouver la confiance des Français. Cela ne relève pas d’une simple stratégie de communication. Il faut reconnaître certaines erreurs commises sur le plan institutionnel et politique et en tirer les leçons. C’est en faisant preuve d’écoute et d’humilité que l’on peut avancer.
Cela veut dire en finir avec la rupture ?
La rupture était une erreur. Elle a été un moyen de conquête mais elle ne correspond pas à la réalité du pays et, aujourd’hui, en temps de crise, elle est devenue dangereuse. On a le sentiment qu’il y a une idéologie au pouvoir qui obscurcit la capacité à avancer en rassemblant. Seul doit prévaloir l’intérêt de la France et des Français.
Source: propos recueillis par Françoise Fressoz et Patrick Roger (Le Monde)