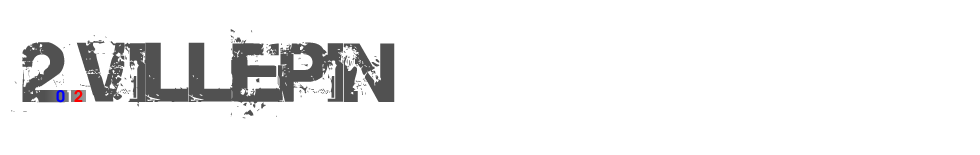Pour mieux exorciser ses échecs, l’ancien Premier ministre Alain Juppé les a couchés par écrit dans « Je ne mangerai plus de cerises en hiver… », qui sort le 12 mars chez Plon.
De la droite d’aujourd’hui, mais aussi de la crise et de l’Otan, Alain Juppé, 63 ans, parle ici. Rêvant que les Français le perçoivent enfin autrement.
L’Express: Affrontons-nous une crise du capitalisme ou une crise du modèle anglo-saxon?
Alain Juppé: Je serai modeste dans mon interprétation de la crise, vu le désarroi de la science économique. Je ne suis pas sûr que l’on puisse parler de crise du capitalisme. Selon moi, il s’agit plutôt d’une crise de la dérive du capitalisme et du libéralisme mal compris. Des apprentis sorciers ont construit un monstre qui leur a échappé. L’économie de marché, cela ne veut pas dire l’absence de règles. Si elle sait se doter de codes de bonne conduite, elle a encore de beaux jours devant elle.
Comment jugerez-vous si le G20 de Londres, le 2 avril, a réussi?
N’entretenons pas d’illusions : ce n’est pas en une réunion que l’on va remettre d’équerre ce qui est cul par-dessus tête. L’une des priorités me paraît être d’améliorer les moyens d’intervention du Fonds monétaire international. Ensuite, s’attaquer aux paradis fiscaux est une bonne chose. Et faire en sorte que certaines activités ou certains produits financiers n’échappent plus à toute réglementation.
En quoi l’attitude de l’Europe face à la crise pourrait-elle être plus convaincante?
Il y a de la marge ! Le silence de la Commission européenne a été assourdissant. L’Europe n’a certes pas réagi en ordre dispersé, mais il n’y a pas eu d’implication forte des instances communautaires. Aujourd’hui se pose la question de l’équilibre de la zone euro elle-même. Un démantèlement serait un cataclysme. Il faut donc une réaction commune des pays de la zone euro, et même des Vingt-Sept, et une solidarité active à l’égard des Etats membres en difficulté.
En 2009, les déficits publics vont exploser. Jusqu’à quel point peut-on laisser se détériorer la situation financière de la France?
Il n’y a sans doute pas moyen de faire autrement. La question qui se pose est de savoir jusqu’où peut aller l’endettement mondial. Si creuser les déficits n’est pas évitable à court terme, il faut se préparer, ensuite, à sortir de cette spirale. En cela, la stratégie du gouvernement, qui mise sur l’investissement, me paraît être la bonne.
L’emploi ne devrait-il pas être érigé en seule priorité, quitte à laisser de côté la question du pouvoir d’achat?
La seule vraie menace sur le pouvoir d’achat, c’est le chômage. Certes, il y a un problème de pouvoir d’achat récurrent, mais on ne peut pas parler de dégradation accélérée, sauf pour tous ceux qui perdent leur poste. L’emploi doit donc être l’absolue priorité.
Etes-vous favorable à la limitation des rémunérations des chefs d’entreprise?
Je suis profondément choqué par certains excès : parachutes dorés, bonus ou stock-options. Nous sommes là face à une perversion du capitalisme. Peut-on fixer des règles, élaborer une loi ? C’est là que le bât blesse. Commençons par poser le problème en termes éthiques: c’est un moyen de mettre la pression. Si on arrive ensuite, comme le propose Barack Obama aux Etats-Unis, à établir des règles dans certains pays, cela lancera un vrai mouvement international de moralisation.
Vous soulignez l’importance, en politique étrangère, d’une indépendance d’esprit totale. Est-ce la perte de cette indépendance d’esprit qui guette la France si elle revient au sein du commandement intégré de l’Otan?
Il faut garder notre indépendance d’esprit, notre autonomie de jugement : la France continue à être attendue et entendue. Il est important de maintenir ce principe. Est-il menacé par la réintégration dans l’Alliance atlantique ? Un processus de retour dans le commandement intégré de l’Otan en tant que tel ne me choque pas. L’invocation des mânes du général de Gaulle est un exercice périlleux : personne ne sait ce qu’il ferait aujourd’hui. Je suis d’autant moins choqué que, en 1995, nous avions engagé un tel processus. Nous avions posé deux conditions à l’époque : un véritable partage du commandement militaire et un progrès significatif vers une défense européenne autonome. A l’époque, elles n’ont pas été remplies. Aujourd’hui, même si on a avancé, elles doivent encore être clarifiées.
Vos réserves portent-elles sur le calendrier?
Je pense qu’il serait préférable d’attendre la redéfinition, l’an prochain, du concept stratégique de l’Otan et de son champ d’action territorial avant de rentrer définitivement. On me répond : « Rentrons cette année, ainsi nous pèserons davantage sur cette redéfinition ». Or on y est déjà à 99 %. Je ne suis pas convaincu que nous ayons à y gagner. Notre spécificité est peut-être symbolique, mais il y a des symboles qui comptent. Cela mérite que l’on en discute encore un bon mois.
Vous rapportez, dans votre livre, un jugement de Nicolas Sarkozy sur François Fillon: « Il n’est pas dominant. » Que vous inspire l’effacement du chef du gouvernement et de ses ministres depuis 2007?
Je dirais plutôt le « repositionnement ». Il y a deux explications. D’abord, la personnalité de Nicolas Sarkozy, qui s’occupe de tout, comme il le dit lui-même. Ensuite, le passage au quinquennat. Le calendrier électoral, avec la présidentielle suivie, dans la foulée, par les législatives, a encore amplifié ce mouvement. Le président est devenu le chef de la majorité parlementaire. Cette montée en première ligne change forcément ses rapports avec le chef du gouvernement et ses ministres. Cela dit, je considère que François Fillon existe bien : il a trouvé son créneau, avec un langage de vérité et de sérieux.
Nicolas Sarkozy modernise-t-il ou malmène-t-il la fonction présidentielle?
Je ne pense pas qu’il la malmène. Il a beaucoup de présence et de vitalité.
En quoi y a-t-il, ou non, rupture entre les présidences de Chirac et de Sarkozy?
Ce terme de rupture est une facilité. Il n’y a jamais de rupture totale dans la vie des peuples! Valéry Giscard d’Estaing avait tout dit, de ce point de vue, avec sa formule de « changement dans la continuité ». Il y a des réformes, des changements, des différences de tonalité qui s’opèrent, et c’est bien. Mais je ne crois pas que, en matière de politique étrangère, par exemple avec la Russie ou au Proche-Orient, nous vivions une rupture de fond.
Vous rapportez des propos peu amènes de Jacques Chirac sur Nicolas Sarkozy, et réciproquement. Pourquoi ces deux hommes ne s’entendent-ils pas?
Parce que le second voulait prendre la place du premier. C’est fait, alors, c’est le passé. Il y a eu aussi, sans doute, des différences de tempérament, bien qu’à mes yeux ils aient beaucoup de points communs. En 1995, Giscard qualifiait Chirac d’ »agité ». Aujourd’hui, on qualifie Sarkozy d’ »hyperactif ». Chirac avait ce talent de prendre, de capter son interlocuteur, comme le fait Nicolas, à sa façon.
Y a-t-il une réforme dont vous souhaiteriez que le gouvernement s’empare?
Je serais un peu en peine de vous répondre : le champ est largement couvert par le président ! Justice, éducation, institutions… Il s’est attaqué à tous les dossiers, et sur tous les fronts. C’est peut-être cela, le problème ! En 1995, j’ai fait l’erreur de lancer trop de chantiers en même temps. Il y a un peu de cela aujourd’hui. Il faut changer, mais sans trop perturber, tout de même, le corps social, surtout en situation de crise. Il faudrait laisser mûrir davantage certains dossiers. De temps en temps, quelques reculs tactiques, comme celui sur le lycée, peuvent se révéler utiles.
L’UMP est-elle actuellement conforme à l’idée que vous vous faisiez du parti au moment où vous l’avez lancé?
Oui, car c’est toujours un parti de rassemblement et d’ouverture. Mais il reste, pour moi, un point d’interrogat
ion : à quoi doit servir l’UMP? C’est très difficile d’être un parti de gouvernement : ou bien on approuve tout ce qui est fait, et on est accusé d’être un parti godillot ; ou bien on le critique, et on vous reproche de provoquer de la cacophonie. Il faut, pour éviter ce dilemme, anticiper, se positionner sur les débats à moyen et à long terme. C’est cette réflexion qui mérite d’être réactivée par l’UMP.
Quels conseils auriez-vous envie de donner à deux hommes qui furent proches de vous et qui incarnent la nouvelle génération à droite, Xavier Bertrand et Jean-François Copé?
Ce sont des hommes de valeur, qui ont de l’ambition, sans quoi ils ne feraient pas de politique. Ils mènent bien leur barque. Le seul conseil que je leur donnerais – mon expérience m’a poussé à la modestie – est de ne pas trop se précipiter.
Vous faites, ici, l’éloge de la sobriété, là, celui du sens de la mesure. Les hommes politiques français ont-ils tendance à les oublier?
Pas uniquement les hommes politiques ! La société française est souvent portée aux extrêmes. Il y a chez nous une tendance à la sinistrose et au catastrophisme. Je crois beaucoup, pour ma part, aux vertus de l’esprit de mesure. Les caricatures, c’est toujours facile ; les positions d’harmonie, de modération, moins. Avant d’agir, je préfère parfois me poser des questions plutôt qu’avoir des positions tranchées sur tout.
Que vous inspire, quand vous y repensez, l’épisode de l’aéroport de New York que vous racontez: en janvier 2005, en raison de votre condamnation judiciaire dans l’affaire des emplois fictifs du RPR, vous êtes bloqué, pendant plusieurs heures, au bureau de l’immigration?
Beaucoup de souffrances. Je n’ai pas choisi le titre de ce chapitre, « Humiliation », par hasard. C’est exactement ce que j’ai ressenti. En le racontant, j’ai voulu mettre ce moment en dehors de moi.
« Je sais ce que je lui dois. Je pense qu’en retour il sait ce qu’il me doit », écrivez-vous à propos de vos relations avec Jacques Chirac. Et vous précisez : « Une partie de ma réputation. » Se sacrifier pour un président, est-ce une noble cause?
Je ne me suis pas sacrifié, j’ai assumé mes responsabilités. Je n’en ai aucun regret. Ce n’est pas pour le président Chirac que je l’ai fait. C’est pour tout un parti, le RPR. Tous ses responsables étaient concernés. J’ai assumé car j’étais, selon les époques, n°2 ou n°1.
A quelles ambitions avez-vous aujourd’hui renoncé?
Peut-être à aucune. C’est le temps qui le dira.
Avez-vous un regret?
Oui, forcément. J’ai eu des phrases malheureuses, comme lorsque j’ai déclaré que Thomson « ne valait rien » ou qu’il fallait faire fondre la « mauvaise graisse » de la fonction publique. Je regrette aussi de ne pas avoir écouté, en 1995, la secrétaire générale de la CFDT d’alors, Nicole Notat, qui m’avait dit de ne pas toucher aux retraites en même temps que je mettais en chantier la réforme de l’assurance-maladie. En revanche, même si je crois avoir montré que j’étais capable de changer, je n’arrive toujours pas à regretter l’expression « droit dans mes bottes »! Qu’a-t-elle de choquant?
Pourquoi un homme politique ne décroche-t-il jamais?
Parce qu’il aime ça. Si on faisait cette activité en dilettante, arrêter serait facile. Quand on aime, que l’on est passionné, pourquoi abandonner ?
Source: L’Express (propos recueillis par Eric Mandonnet et Ludovic Vigogne)