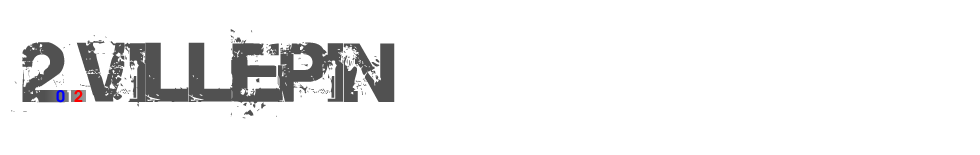Journaliste au Monde, Raphaëlle Bacqué a recueilli les confidences des premiers ministres sur leur passage à Matignon.
Voici quelques extraits de L’Enfer de Matignon (publié cette semaine chez Albin Michel, 20 euros) qui fera également l’objet de documentaires diffusés ultérieurement sur France 5, puis France 2.
Michel Rocard (premier ministre du 10 mai 1988 au 15 mai 1991) sur les conditions de sa nomination
« J’étais vraiment convaincu que nous étions dans une impossibilité de travailler ensemble et de cohabiter, donc j’étais très tranquille (…). Ma secrétaire m’apprend (le président ne me prend pas au téléphone) qu’il me convie à déjeuner le lendemain. Nous allons donc tomber le mardi 10 mai, qui sera l’anniversaire, le septième anniversaire de sa première élection, et qui est deux jours après sa réélection. Je ne sais rien de plus. (…) Ma secrétaire apprend que nous serons modestement quatre, lui et moi compris.
Le matin même du déjeuner, j’apprends que je suis convié à la table du président avec Pierre Bérégovoy et Jean-Louis Bianco. Bref, nous voilà tous les quatre, moi n’ayant rien préparé du tout (…). A sa droite, il place l’homme de sa confiance, son plus proche collaborateur, Jean-Louis Bianco. En face, il met l’autorité légitime la plus forte qui est celle de son ancien ministre d’Etat, Pierre Bérégovoy (…). Et puis moi-même, mais j’étais à la gauche du président, là où le protocole place les invités de moindre importance… Le président, comme à son habitude, nous décrit les travers et les drames de notre pays avec talent. (…) On n’en est pas encore tout à fait au fromage, et, tout à coup, le président a cette phrase tout à fait étonnante : « Il ne faudrait tout de même pas oublier que dans une heure et quart, et il regarde sa montre, je vais nommer un premier ministre. » Et il cueille le regard de Bérégovoy qu’il ne va plus quitter. Il parle en regardant Bérégovoy qui est pour lui un collaborateur proche, un ami (…). Et nous entendons : « C’est un exercice purement politique qui est totalement étranger à toute catégorie intellectuelle connue sous le nom d’amitié, de confiance, de fidélité ou de choses de ce genre. En fait, la nomination d’un premier ministre, c’est le résultat de l’analyse d’une situation politique. » Je lis sur son visage que Bérégovoy commence à ne pas prendre cela très bien. Moi je regarde obstinément le fond de mon assiette. François Mitterrand continue : « Et l’analyse de la situation politique actuelle est claire, il y a une petite prime pour Michel Rocard. » « Petite prime pour Michel Rocard… » Mon pauvre ami Bérégovoy passe du rouge au vert et au violet. Tout le monde a compris.
Edith Cresson (15 mai 1991-2 avril 1992)
Un jour, mes collaborateurs m’ont dit que je devrais regarder le Bébête Show pour comprendre ce qui se tramait contre moi. (…) J’étais représentée en cochonne, mi-pute, mi-mégère, nulle et lubrique, qui se traînait aux pieds de Mitterrand. C’est là que j’ai compris l’extraordinaire campagne qui était diffusée contre moi sur la chaîne de télévision la plus regardée. Je ne pouvais rien faire. (…) Alors j’ai laissé faire et j’ai cessé de regarder. C’est tout. Mais la presse, vous êtes tout de même obligé de la lire. Non pas pour savoir ce qui se passe, mais ce que les médias veulent que les gens pensent. Dès les premiers jours, j’ai entendu le pire. On attaquait Mitterrand à travers moi et on attaquait aussi directement ma personne. Dès ma nomination, François d’Aubert a lâché devant les caméras : « Voilà la Pompadour. » Personne ne s’est indigné. Les médias ont été incroyablement violents. Le Nouvel Observateur a publié une photo de mes jambes en affirmant que je portais des bas filés, alors que j’ai des cicatrices à cause d’un accident de voiture. Claude Sarraute, du Monde, a carrément écrit, en parlant de Mitterrand et moi : « J’imagine mal mon Mimi te repoussant du pied, agacé par tes câlineries de femelle en chaleur… » On s’est mis à déformer tous mes propos. On m’a fait dire en « une » du Journal du dimanche : « La Bourse, j’en ai rien à cirer. » (…) J’avais dit cela non pas à la journaliste qui était venue m’interroger, mais à un de mes collaborateurs qui me parlait au téléphone en interne, et qui me disait : « La Bourse n’a pas bougé », au milieu d’autres informations…
Dans une démocratie, il y a une majorité, une opposition. Nous étions dans la majorité, nous avions une opposition, très bien. Mais là, j’avais deux oppositions. J’avais une opposition normale et l’opposition des médias, en particulier la première chaîne de télévision qui avait décidé qu’il fallait faire la peau du premier ministre. (…) Aurais-je aimé rester ? On n’aime jamais rester dans une vie intenable, impossible. D’un autre côté, c’est un peu humiliant d’être révoqué sans raison. Mais j’en ai pris mon parti. J’avais fait tout ce que, humainement, on pouvait faire.
Jean-Pierre Raffarin (6 mai 2002-31 mai 2005)
Pour les premiers ministres, en général, les sondages sont très utiles au début de leur mandat et ne servent à rien à la fin. Au départ, ils sont un réconfort et ils peuvent être un élément politique très important. Il est évident que, dans mon rapport de force avec Nicolas Sarkozy, j’ai construit une relation différente dès que je l’ai doublé dans les cotes de popularité. Et lorsqu’au début de l’année 2003, il me redouble, il en profite. Donc il est clair que le sondage, c’est un peu le carnet de notes du premier ministre. Et tous les gens qui rentrent dans le bureau ont à l’esprit : « Il monte ou il descend. » On ne vous demande pas comment vous allez, puisqu’on connaît votre sondage.
Dominique de Villepin (31 mai 2005- 15 mai 2007)
Etre premier ministre, c’est se trouver en permanence dans cette complexité qui fait que ce que vous décidez passe par beaucoup de tamis, qu’entre le haut et le fin fond de la décision, il y a beaucoup d’obstacles, beaucoup de contraintes. Et de ce point de vue-là, oui, c’est un poste immensément frustrant qui apporte fort peu de satisfaction. Sauf si vous décidez de ne rien faire. Je l’ai observé dans ma longue expérience de fonctionnaire : quand vous décidez de ne rien faire, que les sondages sont bons, que le temps est calme, alors oui, on doit pouvoir sans doute goûter une vie tranquille à Matignon.
François Fillon (depuis le 17 mai 2007)
J’avais connu, comme ministre, trois premiers ministres, Alain Juppé, Edouard Balladur et Jean-Pierre Raffarin, dont les types de management étaient fort différents (…). Edouard Balladur avait sans doute le management des hommes le plus sophistiqué et le plus efficace. Il était toujours affable, très disponible pour les membres de son gouvernement, y compris pour les plus modestes d’entre eux. (…) Alain Juppé, c’était tout le contraire. Des décisions très abruptes et souvent pour les ministres le sentiment qu’ils n’avaient pas eu le temps de s’expliquer et de défendre leur position. (…) Jean-Pierre Raffarin, lui, donnait le sentiment de ne pas être en mesure de trancher les sujets. Soit parce qu’il ne voulait pas le faire, soit parce qu’il voulait que le président de la République le fasse. Nous avions donc des réunions très longues, assez confiantes, mais dont il sortait rarement une décision. Il y avait énormément de ministres qui passaient par-dessus la tête de Raffarin pour aller à l’Elysée voir Jacques Chirac, je le sais parce que j’en faisais partie.
Source: Raphaëlle Bacqué – L’Enfer de Matignon (Albin Michel)