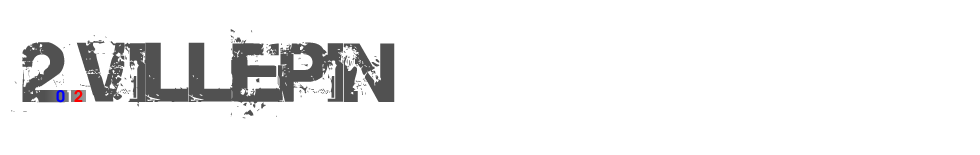Dans un nouvel essai historique aux nombreux échos contemporains et personnels (La chute ou l’Empire de la solitude 1807-1814, aux éditions Perrin), l’ancien Premier ministre s’est intéressé au déclin et à la chute de l’Empereur.
Entretien exclusif pour Le Figaro Magazine.
Le Figaro Magazine: Après « Les Cent-Jours ou l’Esprit de sacrifice » et « Le soleil noir de la puissance (1796-1807) », vous abordez aujourd’hui la période qui couvre les années 1807-1814. Soit l’essoufflement, puis la chute de l’Empire. Curieusement, on a le sentiment que c’est la période de l’aventure napoléonienne que vous préférez. Pourquoi?
Dominique de Villepin: La réflexion que j’ai voulu mener sur Napoléon tourne principalement autour de la problématique de la chute. La tentation habituelle est de découper la période napoléonienne entre une période de gloire et la période de déclin. Or, je crois qu’il y a, dès les années 1796-1807, y compris à l’apogée de l’Empire, les ferments de la chute. C’est cela qui rend d’ailleurs Napoléon aussi fascinant et intéressant à étudier: cette capacité à répondre aux difficultés naissantes, à anticiper, corriger, s’adapter et se métamorphoser. C’est vrai que, entre 1807 et 1814, nous voyons un homme au sommet de son art, mais aussi un homme gagné par l’ivresse, poursuivant un pari fou, impossible – le Blocus continental contre les Anglais -, qui le conduit à multiplier les malentendus : entre lui et les Français, puis entre lui et Alexandre de Russie. Son obsession du blocus le fait se lancer dans l’expédition d’Espagne, qui transforme la nature de son ambition : en passant d’une logique défensive contre l’Europe des rois à une logique d’agression contre un peuple, il perd ce qui faisait sa légitimité même. Or, je pense que l’une des grandes clés de l’histoire napoléonienne, c’est bien cette bataille pour la légitimité.
Vous montrez comment l’expédition d’Espagne représente à la fois un tournant militaire, avec, pour la Grande Armée, la découverte d’une forme de combat inédite -la guérilla -, mais aussi économique – le conflit va durer six ans et coûter cher – et moral – avec une véritable « crise de l’opinion » en France. Surtout, elle révèle à l’Empereur qu’il ne peut guère compter sur les membres de sa famille…
Au-delà du cas de Joseph à Madrid (« aussi suffisant qu’insuffisant« , raillait Talleyrand à son propos) se dévoile la grande déception qu’il exprime dans le Mémorial contre les « royautés frères » : « Ils étaient plusieurs que j’avais faits trop grands; je les avais élevés au-dessus de leurs états« . Mais Joseph, Louis, Jérôme ou même Murat se heurtaient à une difficulté de fond : comment faire en sorte que les pays qu’ils administrent adhèrent complètement à cet Empire qui, en raison du Blocus continental, les condamne à une grande souffrance? Comment ses frères pouvaient-ils ne pas se trouve en porte-à-faux vis-à-vis de leurs populations?
Aujourd’hui, il est facile de voir la campagne de Russie comme un immense piège magistralement orchestré par le commandement russe. Mais la défaite de Napoléon sur les rives de la Moskova et de la Berezina était-elle inéluctable?
Je pense que rien n’était écrit. Napoléon a commis des erreurs tactiques et des erreurs dans la gestion de l’espace, lui qui n’était pas habitué à se battre si loin de son territoire. Il n’attache probablement pas assez d’attention à l’intendance, à la logistique, en préférant consacrer toute son énergie au champ de bataille. Il est aussi évident que, si le climat de l’hiver 1812 n’avait pas été aussi rude, les choses eussent été bien différentes. De même, du côté de l’état-major russe, il existait un véritable débat pour savoir s’il fallait livrer bataille ou non. Si Barclay de Tolly n’avait pas choisi de se dérober, l’armée russe aurait probablement perdu contre l’armée napoléonienne. Au contraire, privée d’adversaire, l’armée impériale s’est épuisée dans l’immensité russe, agacée de cet adversaire quasi invisible qui se contentait d’attaquer par de brèves opérations, appuyée par des cosaques et des partisans, laissant le temps et le climat faire leur oeuvre. La Grande Armée s’est retrouvée minée de l’intérieur, cédant au désordre et au pillage.
Pourquoi avoir privilégié dans vos sources les récits des mémorialistes, voire des écrivains comme Tolstoï, Goethe ou Chateaubriand, plutôt que ceux des historiens? N’y a-t-il pas un risque à sortir de l’Histoire en privilégiant la mémoire, par définition moins rigoureuse?
Le recours aux mémorialistes permet d’appréhender, à la source, la psychologie de l’Empereur : son apathie, ses colères, ses doutes… Ses conversations avec Caulaincourt ou Metternich sont extrêmement importantes pour comprendre la façon dont l’homme évolue face aux difficultés. Dans un autre ordre d’idée, la vision des écrivains offre un autre regard politique et littéraire sur l’épopée impériale.
Il n’est pas rare que vous employiez le pronom personnel « nous » pour évoquer le destin des armées napoléoniennes. Pour quelle raison?
Il y a chez Napoléon comme un révélateur de ntore tempérament national. Les grands débats sur la politique étrangère de la France et sur ses frontières naturelles, ce rêve d’une France rayonnant à travers le monde, il me semble qu’ils sont inscrits au coeur de notre histoire. Napoléon est plongé au coeur d’une époque où tout se télescope, où différentes mémoires se sédimentent. Or, il tente de réconcilier toutes ces mémoires. Même si, à un moment donné, cela aboutit à une sorte d’ivresse du pouvoir, il y a en lui la volonté de fédérer, de rassembler, de donner un rôle central à la France. Mais l’immensité de l’Empire rend la chose impossible et on sent qu’en permanence il est soumis au doute. C’est une problématique qui me passionne sur le plan politique : voir comment, en permanence, cet homme d’Etat s’interroge et s’adapte pour essayer de conjuguer des réalités contraires.
Génial stratège, fin politique, grand réformateur, Napoléon n’en a pas moins négligé de prendre la mesure d’une donnée fondamentale : le temps politique…
De même qu’il dédaigne un certain nombre de facteurs techniques, de même qu’il se soucie peu de l’état physique et psychologique de ses troupes ou qu’il commet des erreurs tactiques, Napoléon ne prend pas suffisamment en compte le contexte économique et notamment la crise de 1810. Il ne perçoit pas qu’une partie de la population souffre et il se coupe des villes portuaires comme Bordeaux et Marseille, qui pâtissent du blocus. Sa logique de conquête militaire pèse lourdement sur le peuple français. Or, les aménagements intérieurs qu’il engage dans le même temps – le code civil, la réforme de l’Etat – s’inscrivent, eux, dans une durée beaucoup plus longue. Prenons le cas de l’Espagne : un certain nombre de réformes qu’il a voulu engager (celle des ordres monastiques, la suppression de l’Inquisition …) pourraient avoir un effet positif, mais il n’en tire aucun bénéfice immédiat, parce que la logique militaire d’occupation prend le dessus sur la logique des réformes, dont les effets se traduisent dans un temps différé. Ce décalage entre l’action et sa perception est au coeur de la difficulté politique à réformer.
Source: Le Figaro Magazine (Propos recueillis par Jean-Christophe Buisson et Raphaël Stainville)