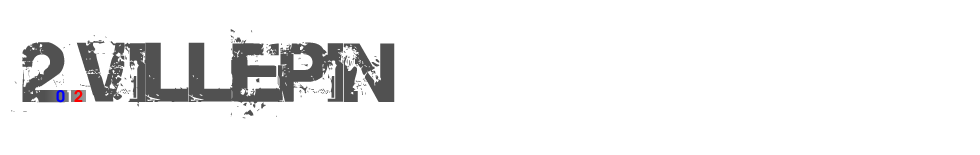« Ah ! Cette première rencontre avec Mahmoud Darwich, dans les salons trop solennels du Quai d’Orsay, là où un thé à la menthe sur la margelle d’une fontaine eût suffit ! Les lambris dorés pas plus que les chérubins sculptés ne peuvent rien ajouter à la dignité de cet homme très droit dans l’embrasure de la porte. Il a la lumière d’une étoile triste. En quelques mots et très peu de gestes, il martèle que la paix n’est pas divisible et que la terre suppose la présence et l’acceptation de l’autre: un autre homme, comme un autre peuple. Tout près, comme par-delà l’horizon lointain, cet autre existe, sachant que toute rencontre est une aventure empreinte de mystère, de désir et de peur.
Né dans le village de Birwa, à quelque dix kilomètres de Saint-Jean-d’Acre, Darwich a six ans quand est fondé l’Etat d’Israël, sept quand les nouveaux occupants du territoire viennent les réveiller une nuit, sa famille et les autres villageois, pour les chasser sur les routes de l’exil. Il s’en souvient encore comme d’une panique et il se revoit courant dans la forêt, tandis que les balles sifflaient au-dessus de leur tête et qu’ils ne comprenaient rien à ce qui leur arrivait. Après une nuit de marche, l’enfant se retrouve dans un village étranger, au milieu de visages inconnus? Innocemment, il demande où il est. Et c’est alors que, pour la première fois, il entend prononcer le mot Liban.
Une douloureuse réalité politique s’impose à lui par-delà les montagnes où se déployait l’imagination du jeune poète. Les fugitifs malgré eux ont passé la frontière – celle qui vient d’être créée, celle derrière laquelle s’est abritée une fragile mosaïque de communautés que l’Histoire a juxtaposées, vivants témoignages du Moyen-Orient de jadis.
Cette nuit marque violemment pour Darwich la fin de l’enfance. Il découvre alors le sens des mots qui vont avoir pour lui une résonance singulière: la patrie, la guerre, les réfugiés, l’armée, les frontières. Qu’est-ce donc que ces frontières qui bougent sur la carte, arbitrairement dessinées, brusquement abolies, et dont le caprice crée pour un enfant et ses proches l’épreuve de l’exil?
De cette effraction est née pour lui la poésie incarnée par ces chanteurs paysans, poètes de la veillée qui, pourchassés par la police israélienne, disparaissaient à l’aube dans les montagnes. Il s’est identifié à eux d’instinct. Et c’est à cause de ses vers d’enfant qu’il subit la première menace brandie par les autorités, quand le gouverneur voulut interdire à son père de labourer son champ.
Sa terre prend le visage d’un poème clandestin. Un mot échangé, un mot partagé sera toujours plus fort que la peur.
Plongé au coeur du conflit entre Israéliens et Palestiniens, témoin du siège de Beyrouth, Darwich a connu plusieurs fois la prison. Aujourd’hui encore, il demeure quelque part entre Amman en Jordanie et Ramallah en Palestine.
Il attend la lumière, dénonçant l’acte de violence qui, au mépris de l’autre, précipite les haines meurtrières. D’un sursaut, il veut creuser l’espoir et non les tombes. La paix jaillira de ces mots qu’Israéliens et Palestiniens devraient pouvoir un jour prononcer ensemble. Mais la frontière se dresse encore comme un épouvantail.
Honneur à ces nouveaux passe-murailles qui défient les lois de la géographie et de la politique ! Dans notre monde hérissé de menaces et de dislocations, la poésie a ce pouvoir. Les mots, même s’ils prennent racine dans une langue, volent au-dessus des frontières pour porter des messages d’espoir. Mais hâtons-nous car l’espoir est fragile. Parfois ils s’abattent d’un vol lourd et meurent, comme Mahmoud Darwich a vu mourir les oiseaux en Galilée.
Faut-il croiser le fer? Darwich, nostalgique d’un temps où vivaient en paix ses compagnons du peuple de la gazelle, sans intrus venus pour les effaroucher et les disperser, clame son refus: si l’on prend la terre de sa mère par le glaive, il ne signera pas le pacte entre la victime et son meurtrier ; il ne se résignera pas au déplacement de la frontière.
Comment accepter cette mascarade d’une paix du champ de bataille qui ne soit pas d’abord un accord dans les coeurs? Darwich est de ceux qui croient au respect et à l’échange comme préalable à une paix tant désirée. Il est de ceux qui, ne pouvant se satisfaire du simple chant du deuil, croient au pouvoir des mots qui libèrent les colombes de la paix, les oiseaux de nos voix.
Mais le problème est toujours d’habiter la terre. Privée de son souffle, elle ne peut espérer le retrouver que dans l’accueil, l’hospitalité, la reconnaissance surtout. Malgré ses plaies, elle doit savoir nommer les siens. Alors, la blessure du sillon se refermera sur la semence. Seuls l’eau et le travail des hommes réconciliés pourront redonner un visage et une histoire à ces terres arides.
Revenu chez lui en Galilée, le village de son enfance détruit, Darwich est contraint de s’installer ailleurs, à Dayr al-Asad, puis à Joleydé, et enfin à Haïfa, près de la mer. Presque un simple changement d’adresse, mais pour celui qui est réfugié dans sa propre patrie, cet exil est plus douloureux encore.
La peur de l’incarcération ou de l’expulsion l’a conduit à chercher, comme Adonis, une maison dans la langue, un souffle dans la poésie. Il a donné au mot frontière des résonances nouvelles, insupportables. Celles d’un glas annonciateur du deuil des espérances. Si le malheur est évité, du moins son ombre est-elle toujours présente et elle s’accompagne pour lui, comme autrefois pour Apollinaire, de l’ombre de son amour.
Pour l’exilé, la patrie n’est pas ici, ell n’est pas ailleurs ; elle se réduit à une corde à linge / Pour les mouchoirs du sang versé / A tout instant. Derrière l’image, on entrevoit la frontière, cette autre ligne tendue qui, sur la carte, décide de la délimitation d’un pays, tranchante jusqu’à la mort.
Au Moyen-Orient, la séparation a lieu, dès cette première nuit de 1948 qui met fin à l’enfance. Elle se double, pour Darwich, d’une séparation de fait avec Rita, la femme israélienne. Etouffant dans ces terres ensanglantées, elle décide brusquement de partir au-delà des mers, laissant celui qu reste à ses questions douloureuses. Partir conduirait à abandonner le visage familier de cette terre. Rester signifierait n’être qu’une pierre marquant l’emplacement du tombeau en souvenir d’une patrie défunte.
Les deux êtres séparés se réunissent dans une intimité impossible et devenue purement imaginaire. Hélas, ils sont loin l’un de l’autre, chacun rendu à sa solitude. La jeune femme envoie à l’absent des messages qui sont comme des chants. Il lui répond, par-delà les mers et les ans. Le moment de l’adieux consacre le double exil et une véritable frontière qui se dresse entre les deux. Le couple n’est pas seulement chassé du paradis terrestre. L’Eden lui-même s’est déplacé. Il s’en est allé ailleurs, en perpétuel exil, plus insaissable que jamais. Plus lointain encore que sur les anciennes cartes médiévales où l’on indiquait sa présence à la confluence des sources du Nil et du Gange.
En guise de compagne, il ne reste plus qu’au poète que la mort. La hache du silence s’est abattue après le départ volontaire de Rita. »
Source: Dominique de Villepin dans « Hotel de l’Insomnie » (Plon)