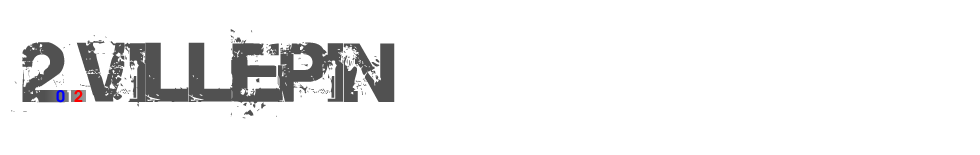Jacques Chirac a rendu hommage à Lazare Ponticelli, le dernier poilu français de la Grande guerre, mort ce matin à l’âge de 110 ans, saluant son « courage » et le « symbole » qu’il représentait.
« Comme tous nos compatriotes, j’ai appris avec beaucoup d’émotion le décès de M. Lazare Ponticelli, le dernier des combattants français de la Grande guerre », a indiqué l’ancien président de la République, dans un communiqué.
« Je veux saluer le courage de l’homme et le symbole de ces millions de jeunes qui répondirent avec un courage admirable et au prix de sacrifices immenses, à l’appel de la Patrie envahie », a-t-il ajouté. « Nous leur devons notre liberté d’aujourd’hui », a-t-il ajouté.
« Sa disparition est un moment important dans notre Histoire et notre mémoire collective », a conclu l’ex-chef de l’Etat.
Il était, en France, le dernier ancien combattant de 14-18, l’ultime rescapé parmi les 8,5 millions d’hommes mobilisés en bleu horizon. Le der des der. Lazare Ponticelli est mort, mercredi 12 mars, au Kremlin-Bicêtre, à l’âge de 110 ans.
Ce survivant nous reliait physiquement à des photos défraîchies de pioupious en capote, les bandes molletières tire-bouchonnées sur les brodequins, à des images tournées à la manivelle d’hommes hirsutes, le regard vide, enterrés vivants dans les tranchées. Avec sa disparition, la première guerre mondiale s’enfonce un peu plus dans les brumes du passé.
Tant qu’il l’a pu, le vieil homme aura témoigné sur le conflit, encore et encore, même quand ne sortait plus de sa bouche qu’un filet de voix à peine intelligible. Alors que beaucoup de vétérans s’étaient claquemurés dans le silence pour ne pas avoir à raconter l’horreur, Lazare Ponticelli avait choisi de dire l’indicible. Il assumait ce devoir pour ceux qui n’avaient pas eu la chance de s’en tirer.
« Tous ces jeunes tués, je ne peux pas les oublier. Quel gâchis ! » Alors, pour eux et pour la gloriole, Lazare ouvrait aux solliciteurs sa petite maison acquise dans les années 1920, au Kremlin-Bicêtre. Au milieu des meubles patinés, les histoires de cet homme qui avait fréquenté trois siècles étaient une remontée dans le temps. C’était aussi une leçon d’humanisme apprise en enfer.
Ses souvenirs de la vie quotidienne d’un simple soldat, d’un poilu, préservaient de l’oubli ou, pire, de la réécriture dogmatique. S’y mêlaient sens du devoir, écœurement, obéissance, héroïsme, révolte, fraternité. Ses bribes remontant au hasard de la mémoire résumaient les contradictions qui traversaient les combattants, emportés sans toujours comprendre, broyés par des événements qui les dépassaient.
Il nous parlait d’eux, ses camarades, et des autres, en face, pas si mauvais bougres, finalement. La narration semblait mécanique. Mais une larme surgissait sur le rebord des yeux et roulait lentement sur la joue. Elle remontait de quatre-vingt-dix ans.
Parfois, le narrateur prenait des licences avec la chronologie. Les scènes s’embrouillaient. De quoi faire tiquer les historiens. Mais fallait-il prendre ces souvenirs au pied de la lettre ? N’était-ce pas plutôt l’esprit qui comptait ? L’accumulation d’anecdotes formaient la geste du poilu, racontée par le dernier d’entre eux.
Chaque 11 novembre, Lazare allait à pied au monument aux morts du Kremlin-Bicêtre, râlait contre les discours ampoulés, emphatiques, « toujours trop longs ». Il se rendait aussi dans les écoles à 100 ans passés et martelait la même supplique. « Aux enfants, je leur dis et je leur répète : ne faites pas la guerre. »
La vie de Lazare Ponticelli était exemplaire pour bien plus que cette parenthèse terrible de quatre ans. C’était aussi l’histoire d’un émigré italien illettré, enfant de rien devenu patron d’une multinationale. Le parcours d’un « Rital » qui voulait absolument se battre pour cette France qui l’avait toléré, puis renié, enfin reconnu sur le tard comme un des siens.
« J’ai voulu défendre la France parce qu’elle m’avait donné à manger »
Lazare fut longtemps Lazzaro, né le 7 décembre 1897, à Bettola, en Emilie Romagne. Il est issu d’une famille pauvre de sept enfants. Un frère puis son père meurent en 1903. La mère abandonne la famille qui se disperse. La sœur aînée emmène une partie de la fratrie « au paradis », là où il y a du travail, en France. Trop jeune, Lazare reste en Italie. Il est confié à une marâtre.
A 9 ans, n’ayant aucune nouvelle des siens, Lazare décide de partir à son tour. Il prend le train pour Paris, débarque gare de Lyon sans parler un mot de français, ne sachant ni lire ni écrire. Il erre trois jours dans la salle des pas perdus, est recueilli par une famille italienne qui le prend en pitié et l’héberge quelques mois.
Lazare devient ramoneur et crieur de journaux. Dès la déclaration de guerre, trichant sur son âge, l’Italien s’engage. Il intègre le premier régiment de marche de la légion étrangère de Sidi Bel Abbes, y retrouve par hasard son frère Céleste. « J’ai voulu défendre la France parce qu’elle m’avait donné à manger », explique Lazare. Après un mois d’instruction, il est envoyé au front, sous les ordres d’un descendant de Garibaldi.
Il participe à la confusion des premiers mois. Son premier fait d’arme est d’avoir, alors qu’il était de garde, blessé un général au mollet. Il assiste à l’hécatombe, soigne son frère, blessé au combat. Le régiment perd un quart de ses effectifs en trois semaines. « Au début, nous savions à peine nous battre et nous n’avions presque pas de munitions. Chaque fois que l’un d’entre nous mourait, on se taisait et on attendait son tour. » Il crapahute dans la guerre de mouvement (Soissons, Vitry-le-François, l’Argonne), survit à la pagaille. Puis il creuse les premières tranchées d’un conflit qui s’organise pour durer.
Lazare Ponticelli aimait raconter ce jour où un homme s’était retrouvé blessé dans le no man’s land qui séparait les lignes. Les brancardiers n’osaient s’aventurer sous le feu. « Il hurlait : Venez me chercher, j’ai la jambe coupée. Je n’en pouvais plus. J’y suis allé avec une pince. Je suis d’abord tombé sur un Allemand, le bras en bandoulière. Il m’a fait deux avec ses doigts. J’ai compris qu’il avait deux enfants. Je l’ai pris et je l’ai emmené vers les lignes allemandes. Quand ils se sont mis à tirer, il leur a crié d’arrêter. Je l’ai laissé près de sa tranchée. Il m’a remercié. Je suis reparti en arrière, près du blessé français. Il serrait les dents. Je l’ai tiré jusqu’à nos lignes, avec sa jambe de travers. Il m’a embrassé et m’a dit : Merci pour mes quatre enfants. Je n’ai jamais pu savoir ce qu’il était devenu. »
En 1915, Lazare se bat du côté de Verdun lorsque l’Italie, le 24 mai, se range aux côtés des Alliés. Un officier le fait rechercher dans les tranchées. « Tous les Italiens devaient retourner se battre chez eux. » Le légionnaire proteste, souhaite rester. « Je pensais que m’être battu pour la France avait fait de moi un Français. » Déception. « Ils m’ont dit : Il faut vous en aller . » Il est démobilisé de force, rentre à Paris, se cache six semaines, tente de se réengager dans l’armée française, est finalement transféré entre deux gendarmes à Turin.
« Je tire sur toi mais je ne te connais même pas. Si seulement tu m’avais fait du mal »
Il enfile à regret l’uniforme italien, intègre les chasseurs alpins, se retrouve dans le Tyrol, enterré dans la neige face aux lignes autrichiennes. Ses compagnons parlent couramment l’allemand. Les deux camps s’envoient des messages avec un élastique puis sympathisent. « Ils nous donnaient du tabac et nous des boules de pain. Personne ne tirait plus. »
Les hommes organisent même des patrouilles communes. La farce dure trois semaines, manque de se terminer devant un conseil de guerre. « L’état-major nous a déplacés dans une zone plus dure. » En 1916, il est sur le Monte Cucco, qui sera le théâtre d’une terrible bataille l’année suivante. Les hommes multiplient les assauts stériles et dévastateurs, affrontent les gaz sans masque.
Lazare reste plus de deux jours derrière sa mitrailleuse. Des éclats d’obus lui grêlent le visage. Aveuglé par son sang, il parvient à bloquer des Autrichiens qui se sont réfugiés dans une caverne. Sa section fait deux cents prisonniers. Le héros blessé est envoyé à l’arrière. Il est opéré sans anesthésie, des hommes le maintiennent cloué sur la table d’opération pendant que le chirurgien creuse la plaie et la badigeonne d’alcool.
Ses faits d’arme valent à Lazare une citation mais également un dégoût absolu de cette guerre. « Je tire sur toi mais je ne te connais même pas. Si seulement tu m’avais fait du mal. » La révoltante absurdité des combats est trav
ersée d’infimes moments de bonté dont la rareté fait la valeur.
« Mon meilleur souvenir en Italie, ce sont les lettres que ma marraine de guerre, une porteuse de lait que j’avais rencontrée avant de partir au front, m’envoyait. Ne sachant à l’époque ni lire, ni écrire, ce sont des copains qui m’aidaient à correspondre avec elle. » Après quelques semaines de convalescence à Naples, Lazare est renvoyé en 1918 sur le front, vers Montello, où il apprend l’Armistice. Autrichiens et Italiens, « tous les gars levaient les bras en l’air ».
Lazare est contraint de rester sous l’uniforme italien. Il apprend par hasard la mort d’une de ses sœurs, Catherine, victime de la grippe espagnole. En 1920, l’armée italienne souhaite le démobiliser. Il refuse : il veut l’être sous l’uniforme français, avec lequel il a commencé la guerre, ce qui lui permettra de revenir légalement dans ce pays. Il lui faut à nouveau se battre, cette fois contre l’absurde administration. Il obtient finalement gain de cause. Il revient à Paris, avec cinq francs en poche.
Il redevient ouvrier. Avec Céleste et un autre frère, Bonfils, il monte une entreprise de ramonage et de chaudronnerie. Il se marie en 1923 avec une Française, Clara, dont il a trois enfants. Lazare n’obtiendra la nationalité française qu’en 1939, à la veille de la déclaration de guerre. Il veut encore se battre mais est jugé inapte au service parce que trop âgé. Il traverse sans déshonneur l’Occupation.
Après la Libération, sa société Ponticelli frères continue de prospérer. Elle se diversifie, notamment dans les travaux publics et l’extraction pétrolière, prend une stature internationale. Le groupe a aujourd’hui un chiffre d’affaires de 480 millions d’euros et emploie 3800salariés. Lazare Ponticelli en abandonnera progressivement les rênes dans les années 1960.
Il lui restait à honorer la promesse faite à ses camarades des tranchées. « Quand nous montions à l’assaut, nous nous disions : Si je meurs, tu penseras à moi. » Ne jamais les oublier : le dernier rescapé aura respecté jusqu’au bout ce serment.
Source: Benoît Hopquin (Le Monde)