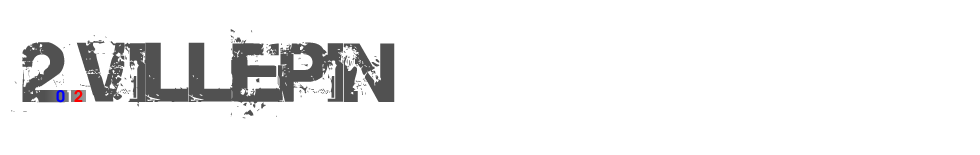La Berezina est donc une victoire incontestable. Or, elle apparaît comme le contraire au point de devenir dans notre langage courant synonyme d’une défaite absolue. L’explication de ce paradoxe tient pour beaucoup au caractère emblématique de cette bataille qui résume et incarne l’horreur de la retraite: « Les souffrances que subissait l’armée française au jour le jour, tout au long de sa route, se concentrèrent soudain en un spectacle tragique qui resta dans toutes les mémoires« , résume Tolstoï. En effet, la Berezina est une bataille à deux visages, où l’horreur des dernières heures finit par occulter le miracle initial.
La dernière journée de passage se transforme en un cauchemar qui hantera tous les survivants. La perte d’une division affaiblit tout notre dispositif sur la rive gauche tandis que les Russes se renforcent sans cesse. Ils arrivent bientôt à portée de canon et commencent à tirer sur la masse agglutinée à l’entrée des ponts. L’effet de panique qui s’ensuit précipite les hommes les uns sur les autres dans un chaos indescriptible. Le combat pour la survie prend alors des proportions homériques. Certains tentent de franchir le fleuve à la nage. D’autres restent hébétés sur la rive, en attendant la mort tandis que les plus robustes n’hésitent pas à se faire jour en précipitant les plus faibles dans l’eau ou dans les flammes. Ceux qui tombent sont aussitôt piétinés. Cadavres et voitures s’agglutinent, obstruant davantage l’entrée. « Nulle description ne pourrait rendre la confusion de la foule, le désir ardent de fuir, les cris, le désordre, la sauvagerie de ceux qui voulaient à tout prix devancer les autres, témoigne un contemporain. Voitures à bagages, canons, équipages, fourgons, charrettes, se poussèrent désespérément vers l’avant ; vociférations et jurements proférés dans toutes les langues de l’Europe se croisaient ; les fantassins frappaient à tort et à travers à coups de crosse de fusil ; les cavaliers jouaient du sabre tout autour d’eux ; les conducteurs faisaient des moulinets avec leurs fouets ; on entendait les appels désespérés des femmes et des enfants. Dans cette mêlée incroyable, chacun était bientôt séparé de ses compagnons ; je me vis soudain entouré de gens inconnus aux visages convulsés par le désespoir, qui cherchaient le salut dans le passage ou dans la fuite. Et, pendant ce temps, les boulets russes continuaient leur oeuvre. »
Le 29 novembre au matin, l’arrière-garde de Victor franchit les ponts avant de les faire sauter. Entre 10 000 et 20 000 traînards restent sur la rive gauche, aussitôt envahie par les cosaques. Emigré français passé au service du tsar, Langeron est saisi par le contraste entre la misère des survivants et le luxe des objets abandonnés dans les fourgons: « Toutes les richesses de Moscou y étaient rassemblées« , résume-t-il dans ses Mémoires avant d’énumérer « des bijoux très riches, de superbes fourrures, des perles, des diamants en profusion, les vases sacrés des églises de Moscou, des chasubles brodées en pierres précieuses, la croix dorée de l’église de Saint-Ivan-le-Grand, des collections de gravures, beaucoup de livres des superbes bibliothèques des comtes Boutourline et Razoumovski, des vaisselles d’argent et jusqu’à des porcelaines … ». Autant de symboles de la déchéance d’une Grande Armée qui croule sous l’or mais meurt de froid. La Berezina est emblématique d’une campagne durant laquelle Napoléon fut victorieux dans chacun de ses engagements, mais où la Grande Armée disparut en bloc dans l’enfer blanc du retour. Elle constitue une étape décisive dans le processus de décomposition qui commence, martelons-le, dès les premières semaines de campagne pour s’accélérer durant la retraite. En cela, elle peut être considérée comme »une défaite morale et politique, le symbole de ce que Talleyrand appelle « le commencement de la fin ». En toute logique, l’effondrement de la Grande Armée provoque celui du grand empire, puis la chute de l’Empereur. La retraite, commencée à Moscou, va continuer jusqu’à Paris en passant par l’échec de la campagne de 1813 et la débâcle de Leipzig. En dépit de quelques éclaircies – à Lutzen, Bautzen, puis surtout durant la campagne de France -, la suite tragique s’accomplit en dix-huit mois pour s’achever par l’abdication dans la solitude de Fontainebleau. Aux yeux de la postérité, la Berezina marque ainsi la césure entre la puissance et le gouffre. Dernier sourire de la fortune, l’exploit du passage s’efface derrière la symbolique de la défaite que la dernière bataille de la campagne finit par illustrer. D’ailleurs, Napoléon ne s’y trompe pas, puisqu’il quitte l’armée quelques jours plus tard pour regagner Paris en catastrophe: « Dans l’état actuel des choses, je ne puis en imposer à l’Europe que du palais des Tuileries« , avoue-t-il à Caulaincourt. Il fait précéder son arrivée de l’envoi du fameux 29ème bulletin qui ne cache rien de la catastrophe dans l’espoir de déclencher le sursaut nécessaire. Son départ, effectif le 5 décembre, achève de ruiner le moral des survivants par ailleurs confrontés à une nouvelle vague de gel. Murat, qu’il nomme pour le remplacer, songe aussitôt à quitter le navire pour sauver son trône et se montre incapable d’endiguer la débâcle. Les derniers jours, de Wilna à la retraversée du Niémen, sont les plus terribles. « On s’écoulait dans cet empire de la mort comme des ombres malheureuses. Le bruit sourd et monotone de nos pas, le craquement de la neige, et les faibles gémissements des mourants, interrompaient cette vaste et lugubre taciturnité« , déplore Ségur. Quand Ney tire le dernier coup de fusil, aux alentours du 15 décembre, le nombre de combattants valides se trouve réduit à moins de 3 000. « Tout est perdu« , résumer Berthier le lendemain dans une lettre à Napoléon.
Source: Dominique de Villepin dans Marianne (numéro 538 – du 11 au 17 août 2007)