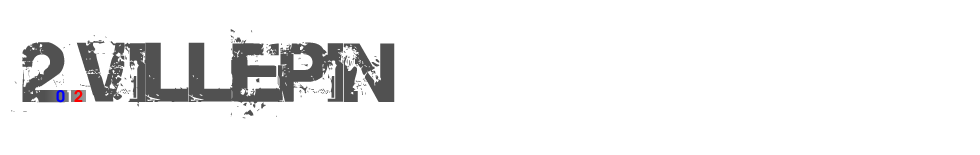L’ »armée mourante au milieu d’une nature morte » (Ségur) doit pourtant continuer son calvaire. Elle a cru pouvoir se reposer à Smolensk, mais la pénurie et la pression constante des Russes l’ont forcée à repartir.
En effet, Kutusov ne lâche rien et suit sa proie sur une route parallèle. Mais il sait attendre son heure avec la prudence qui le caractérise. Plutôt que de risquer une grande bataille comme l’y invite le tsar, il préfère ménager ses hommes et laminer son adversaire au moyen des raids de cosaques et des embuscades des partisans. Comme le résume Tolstoï, « l’armée russe devait agir à la façon du fouet sur un animal« , jusqu’au moment où la bête blessée pourrait être achevée sans risques. Au sortir de Smolensk, il a laissé passer la garde pour mieux décimer les différents corps qui s’échelonnent à sa suite. Ne lui reste plus qu’à conclure, comme il le confie à l’Anglais Wilson: « Le terme de la destinée de Napoléon est irrévocablement marqué: c’est dans les marais de la Berezina que s’éteindra le météore en présence de toutes les armées russes. » Celle de Tchitchagov arrive du sud tandis que Wittgenstein revient du nord pour ajouter 80 000 combattants aux 60 000 de Kutusov et broyer les débris impériaux dans une mâchoire de fer. Jaugeant la situation, Murat n’a plus qu’à conclure: « Nous y passerons tous ; il n’est pas question de se rendre.«
Et pourtant, c’est alors que le destin va s’inverser. Le miracle de la Berezina tient d’abord au retour de Bonaparte. Depuis le début de la retraite, il paraît morne, presque résigné, en tout cas absent. L’enchanteur d’Arcole et d’Austerlitz semble bien loin, alourdi au physique comme au moral, mal à l’aise depuis le début de cette campagne qui l’oblige à manoeuvrer sur un espace trop vaste et avec des forces trop disséminées. Le « maître des batailles » tâtonne et doute, comme à la Moskowa, où il a longuement hésité avant de refuser de faire donner la garde, comme à Moscou où il a perdu le mois qu’il ne rattrapera jamais. La défaite incarne l’échec de son grand empire, colosse aux pieds d’argile, venu trop tôt car bâti trop vite, à rebours de l’aspiration des peuples et des principes d’une Révolution dont il était pourtant l’héritier. En sacrifiant les réformes sur l’autel du blocus continental, Napoléon a renié sa légitimité sans jamais parvenir à se rapprocher de l’Europe monarchique qui continue à voir en lui l’héritier de Robespierre plutôt que le mari de Marie-Louise. Face à la chute, devant le gouffre, il se ressaisit soudain. L’annonce de l’attentat du général Malet, qu’il a reçue le 6 novembre, lui prouve la précarité de son trône, ébranlé par cet ancien général sans appui qui a failli réussir son coup d’Etat en annonçant sa mort. Personne à Paris n’a songé à proclamer son fils. L’empire, il le comprend alors, ne reposera jamais sur l’hérédité mais uniquement sur la victoire et la peur qu’il inspire. S’il tombe à la Berezina, l’ensemble de l’édifice s’écroulera comme un château de cartes et les notables apeurés n’auront plus qu’à rappeler les Bourbons. Plus que jamais, il lui faut vaincre ou périr.
Source: Dominique de Villepin dans Marianne (numéro 538 – du 11 au 17 août 2007)