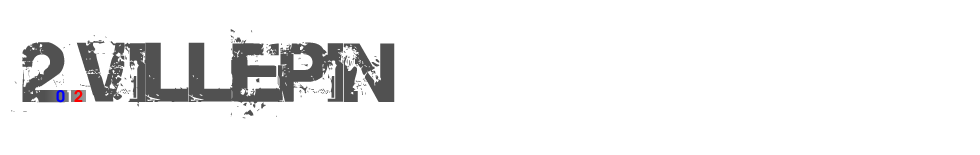Ils partirent 500 000, ils revinrent 50 000. La campagne de Russie se solde au passage de cette rivière fin novembre 1812. La Berezina est le dernier coup de génie de l’Empereur, malgré l’ultime et sanglant combat. Elle amorce l’inéluctable fin de l’Empire.
Aux alentours du 20 novembre 1812, une trentaine de milliers de combattants s’apprêtent à livrer la dernière grande bataille de la campagne de Russie. Exténués, démunis, flanqués d’environ 50 000 traînards, les débris de ce que l’on n’ose plus appeler la « Grande Armée » s’apprêtent à combattre trois armées russes, à la fois plus fraîches, galvanisées par leurs récentes victoires et la perspective d’écraser l’envahisseur. En passe d’être encerclés, les Français paraissent indéniablement condamnés: « Jamais Napoléon ne s’était trouvé dans une situation si désespérée« , prévient Antoine-Henri de Jomini (1779-1869), général de la Grande Armée et historien militaire. « Pressé sur sa droite, sur sa gauche et en queue, il se voyait encore arrêté de front par une rivière difficile à passer et défendue par une armée entière. » D’un avis généréal, la Berezina va entrer dans l’histoire comme le tombeau de l’Empire.
Comment en est-on arrivé là si l’on songe que, cinq mois plus tôt, près de 500 000 combattants défilaient en uniformes rutilants devant un Empereur au sommet de sa puissance et s’apprêtaient à franchir le Niémen? Devant cette « armée des 20 nations », les 180 000 Russes commandés par Bagration et Barclay de Tolly avaient préféré refuser le combat et refluer vers Moscou, retardant la bataille que Napoléon voulait leur imposer pour finir selon son habitude la campagne par un coup de tonnerre. La conjugaison du climat, de l’espace et de la valeur combattante des Russes allait détruire jour après jour une Grande Armée qui, de son côté, ne possédait plus les atouts de ses devancières. Les glorieuses phalanges d’Austerlitz, d’Iéna et de Wagram ont été décimées dans les boues de Pologne ou par les guérillas espagnoles. Pour les remplacer, des conscrits trop verts et, surtout, en nombre croissant, des contingents étrangers qui, pour la plupart, combattent sans enthousiasme quand ils ne sont pas carrément hostiles, comme les 30 000 Autrichiens de Schwarzenberg ou les 20 000 Prussiens, entraînés de force dans l’aventure. En lieu et place de l’instrument fluide qui a signé quinze ans de victoires, une véritable tour de Babel incapable de communiquer faute de posséder une langue commune ; un caravansérail alourdi par une masse de chariots et un nombre considérable de traînards. Avant de tuer par le froid, la Russie foudroie par les orages et épuise par la poussière. Entraînés à un rythme trop élevé par Murat, les escadrons de l’avant-garde fondent comme neige au soleil tandis que les premiers hommes s’écroulent et que les désertions atteignent d’emblée un rythme alarmant.
Contrairement à la vulgate, la campagne de Russie se perd durant la cinquantaine de jours d’offensive qui séparent le franchissement du Niémen de l’arrivée à Moscou. Les 30 000 morts de la Moskowa, la seule grande bataille de cette phase initiale, pèsent moins que les maladies et les désertions pour réduire notre masse combattante à une centaine de milliers d’hommes lors de notre entrée dans la capitale historique. En s’enfonçant trop loin et trop vite, Napoléon a pris le risque insensé de sacrifier la puissance à la gloire dans l’espoir de forcer le tsar à la paix par la rapidité de sa conquête. Or, Alexandre Ier ne cèdera rien. Misant sur l’immensité de son espace et son réservoir d’hommes, il a juré dès l’entrée en campagne qu’il ne négocierait pas tant qu’un soldat français resterait sur son territoire. Le voudrait-il qu’il risquerait de finir assasiné comme son père, Paul Ier, dont le souvenir le hante. La noblesse russe et l’armée, qui lui ont tant reproché Tilsit, refusent tout nouvel accommodement avec l’antéchrist jacobin, héritier de cette révolution satanique qui a osé contrarier l’ordre naturel et monarchique du monde. Napoléon, qui n’a jamais cru qu’au rapport de forces, ne comprend pas la profondeur de l’âme russe, à la fois fataliste, mystique et éperdument patriote ; attachée à l’orthodoxie et à l’autocratie, à l’opposé de ce rationalisme cartésien qui caractérise l’esprit de l’Empire. Déserte puis enflammée par Rostopchine, flamboyante puis calcinée, Mouscou en ruine consume ses illusions tandis que s’égrène le temps perdu et que l’hiver menace. Et pourtant, en dépit des suppliques de Caulaincourt, qui n’a cessé de mettre en garde contre l’expédition et le somme de partir avant qu’il ne soit trop tard, Napoléon reste cinq longues semaines dans l’attente d’une paix introuvable. Pour la première fois, il n’est plus maître de son destin. Tandis qu’il tue le temps comme il peut, l’armée de Kutusov se renforce inexorablement. Le rapport de forces bascule en faveur des Russes. Nul ne sait alors qu’il ne s’inversera plus.
Les vivres qui fondent, le temps qui menace, le silence d’Alexandre, enfin une attaque surprise des Russes contre Murat rendent le départ inéluctable. La rage au coeur, l’Aigle cède le 19 octobre après avoir donné l’ordre de miner le Kremlin. Par orgueil, il refuse d’abord de parler de retraite et tente de s’ouvrir un nouveau chemin, plus au sud, afin d’emprunter une autre route que celle suivie à l’aller, dévastée par les incendies et les pillages. Mais les Russes, autour de la petite ville de Malojaroslawetz, lui opposent une résistance acharnée qui l’oblige à renoncer à son plan. A l’issue d’un conseil de guerre décisif, il se résout à repartir par où il était venu, signant par là même sa défaite aux yeux du monde. La véritable retraite commence dans les derniers jours d’octobre. Elle prend d’emblée un caractère catastrophique en raison d’une somme de facteurs qu’il faut résumer sous peine de s’y perdre.
D’abord, la lenteur, résultant de la lourdeur des convois et du nombre élevé de civils, environ 50 000, qui ralentissent la longue colonne que Jomini compare à l’ »armée de Darius par la cohue d’équipages dont elle était encombrée » et Ségur à « une nation errante« . La plupart des combattants ont entassé des victuailles et le fruit de leurs rapines – or, chandeliers, livres et meubles – dans des fourgons qu’ils devront bientôt abandonner. Napoléon a aussi tenu à emmener tous ses canons, plus de 600, qui suffiront à épuiser les derniers chevaux disponibles. En résulte un étirement progressif puis une dislocation des corps, l’arrière-garde charriant son lot de traînards qui offrent une proie facile aux raids meurtriers des cosaques.
Ensuite, la pénurie. La campagne atteste de la nullité de l’intendance. Jusqu’alors la richesse des territoires envahis et la brièveté des opérations ont permis de pallier ses insuffisances. Selon l’adage, la guerre nourrisait la guerre. Il en va tout autrement dans un pays-continent comme la Russie où l’immensité de l’espace se complique de l’absence de ressources. La politique de terre brûlée, systématiquement pratiquée par les Russes à l’aller, laisse une route dévastée qui rend indispensable la bonne organisation de l’approvisionnement. Or, les magasins manquent ou ont été insuffisamment pourvus. Privé de pain et d’eau, le soldat part de plus en plus loin à la maraude quand il ne se jette pas sur les chevaux au fur et à mesure qu’ils s’effondrent. Avant de succomber au froid, le grognard meurt de faim et surtout de soif dans un pays où les points d’eau sont vite gelés. L’égoïsme règne bientôt en maître, dissolvant la discipline et abolissant toute solidarité. La retraite abonde d’exemples d’inhumanité: blessés jetés des voitures ou dépouillés de leur vivant, pauvres hères hantant les abords du feu qui leur est interdit par leurs anciens camarades, enfants abandonnés par leur mère. « Après avoir ravagé tout le pays, nous étions réduits à nous entre-détruire« , résume Fezensac auteur d’une des meilleures relations de la campagne. Le désordre s’ajoute à la peur pour démoraliser un combattant qui n’a jamais été vaincu et, comme l’a remarqué Napoléon, n’est pas propre à la retraite (1).
Enfin, le froid s’invite pour transformer la déroute en débâcle, le chemin de gloire en chemin de croix. La neige tombe début novembre pour ne plus s’arrêter alors que le thermomètre tombe à -25°C. Faute de vêtements d’hiver, les hommes s’accoutrent avec tout ce qui leur tombe sous la main donnant à la colonne un air de cour des Miracles. Les chevaux, non ferrés à glace, dérapent tandis que les combattants tombent pour ne plus se relever. Outre le ravitaillement, la quête d’un abri devient un nouvel enjeu pour la survie alors que les nuits sont de plus en plus longues, ce qui raccourcit d’autant les étapes et facilite la poursuite des Russes. Des centaines de témoins ont peint cet enfer blanc noirci de voitures abandonnées et de cadavres, le spectacle du dépeçage des chevaux dévorés par les survivants, les doigts qui tombent, les membres qui gèlent, enfin l’engourdissement et le regard vide qui préludent à la mort et donnent
le signal de la curée. Perdu parmi les ombres, un certain Chevalier dresse en deux phrases un tableau édifiant: « On ne voyait plus sur les routes des soldats français, mais des fantômes couverts de haillons, des figures hâves, une longue barbe sale et terreuse, la tête entortillée de mouchoirs, les mains et les pieds enveloppés de peaux de mouton ; des vieilles jupes de femmes, des vieilles couvertures, des chabraques de chevaux, de vieilles peaux leur couvraient la tête ; à peine si l’on apercevait leurs yeux ternes et hagards. Et tous ces lambeaux déchirés, brûlés, dégoûtants, tout cela marchait machinalement, sans but, au hasard, sans une ombre d’espérance.«
(1) « Les Français sont les plus braves qu’on connaisse ; dans quelle position qu’on les essaie, ils se battront ; mais ils ne savent pas se retirer devant un ennemi victorieux. S’ils ont le moindre échec, ils n’ont plus tenue ni discipline ; ils vous glissent dans la main », confesse-t-il dans le Mémorial.
Source: Dominique de Villepin dans Marianne (numéro 538 – du 11 au 17 août 2007)