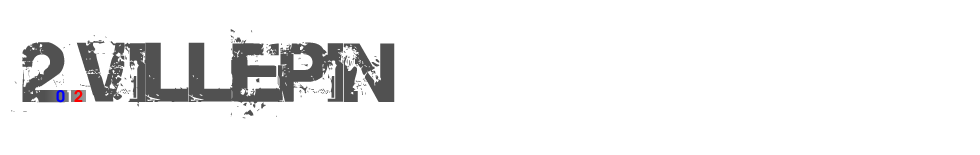Comment est née la crise financière? Pourquoi la crise n’en finit-elle pas? Faut-il craindre un effet domino sur les banques? Faut-il redouter un krach boursier mondial? Pourquoi le reste du monde est-il touché? Comment la crise financière affecte-t-elle l’économie réelle? Les pays émergents peuvent-ils résister à la crise? Quelles solutions à la crise?
En 8 questions-réponses, tout comprendre à une crise financière dont on n’a pas fini de parler…
1) Comment est née la crise financière ?
C’est du petit marché des subprimes, du nom de ces crédits hypothécaires américains risqués, que tout est parti. Parce que des banquiers ont octroyé des crédits immobiliers à des ménages aux revenus très modestes peu solvables en calculant leur capacité d’emprunt sur la valeur de la maison achetée. Tant que les prix immobiliers progressaient ce système fonctionnait. Mais lorsque l’immobilier a commencé à se replier aux Etats-Unis en 2007, l’effet pervers de cette mécanique s’est enclenché. Les ménages n’ont plus été capables de rembourser leurs emprunts, et les établissements de crédit qui les avait accordés se sont effondrés. La crise s’est ensuite diffusée à tout le système financier par le canal de la titrisation, cette technique née dans les années 1970 consistant à transformer des prêts bancaires en obligations achetées par les investisseurs du monde entier.
La crise est, d’une manière plus générale encore, la conséquence des excès observés sur le marché du crédit aux Etats-Unis. Dans les années 1990, la politique monétaire très souple – c’est-à-dire des taux d’intérêt très bas, rendant le crédit très peu cher – menée par le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Alan Greenspan, avait conduit à la formation d’une bulle spéculative à la Bourse de New York, notamment sur les valeurs Internet. Celle-ci avait fini par éclater au printemps de l’année 2000.
Après ce krach, la politique monétaire de la Fed a de nouveau été assouplie pour permettre à l’économie américaine de se relever. Après les attentats du 11 septembre 2001, les taux d’intérêt ont même été abaissés à 1 %. Cette réduction du coût de l’argent a certes permis de stimuler la consommation des ménages américains, leurs achats de logements et les investissements des entreprises. Mais elle a aussi permis aux financiers de multiplier les mécanismes d’emprunts de plus en plus sophistiqués et de plus en plus audacieux. « Les crédits ont agi comme des stéroïdes pour doper la croissance américaine. Mais il y a eu overdose. L’Amérique est aujourd’hui en cure de désintoxication », explique Joseph Stiglitz, économiste, Prix Nobel d’économie en 2001.
2) Pourquoi la crise n’en finit-elle pas ?
La crise dure parce qu’elle concerne désormais l’ensemble des crédits et non plus seulement le cadre étroit des crédits immobiliers à risque américains. Tous les types de crédits (automobiles, à la consommation, etc.) qui avaient été titrisés sont désormais touchés, soit un marché de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars, très supérieur à celui du seul compartiment des subprimes (1 300 milliards). De la même façon, elle n’affecte plus seulement les établissements qui avaient accordé des crédits immobiliers à risque aux Etats-Unis. Elle touche tous les acteurs financiers qui ont investi, par le biais de la titrisation, dans les marchés du crédit (banques, hedge funds, assureurs, fonds de pension, fonds communs de placement…).
Par ailleurs, la crise est alimentée par le sentiment de défiance qui perdure sur les marchés interbancaires. Plus personne ne sait trop précisément quelle est l’exposition des banques aux valeurs titrisées qui elles-mêmes ont bien du mal à être cotées ! Dans ces conditions, les banques rechignent à se prêter de l’argent entre elles, inquiètes à l’idée de ne pouvoir récupérer leurs fonds. Cette paralysie du marché monétaire grippe tout le système financier.
3) Faut-il craindre un effet dominos sur les banques ?
Si Lehman Brothers, la cinquième banque d’affaires des Etats-Unis, a pu brutalement faire faillite, si la valeur de cette institution vieille de cent cinquante ans a pu s’évaporer en quelques semaines, alors, en théorie, aucune banque cotée en Bourse dans le monde ne peut s’estimer à l’abri. Ce constat doit être nuancé. Car les banques aujourd’hui les plus exposées et les plus fragiles sont aussi celles qui étaient hier les plus actives et les plus puissantes sur les marchés financiers. C’est le cas des grandes banques d’investissement de Wall Street (Morgan Stanley, Merrill Lynch, Goldman Sachs…) qui exerçaient une domination sans partage dans ce domaine d’activité.
Les banques européennes, si l’on excepte les grands établissements suisses (UBS, Crédit suisse), étaient beaucoup moins spécialisés, ce qui aujourd’hui les protège. Au moins en partie. Elles bénéficient aussi de leurs activités de banque de détail qui elles restent très rentables et qui leur permettent d’éponger les pertes qu’elles ont pu subir avec leurs investissements hasardeux sur les marchés des subprimes. De façon plus spécifique, les banques françaises possèdent, en outre, des ratios de solvabilité élevés, ce qui leur garantit en théorie une bonne résistance face aux chocs financiers.
Au-delà des craintes sur les banques d’affaires de Wall Street, c’est maintenant les inquiétudes sur les assureurs américains qui se font jour. Notamment sur AIG, dont le portefeuille d’actifs était lui aussi massivement investi en valeurs « titrisées ».
4) Faut-il redouter un krach boursier mondial ?
« Les marchés, lorsqu’ils sont livrés à eux-mêmes, sont susceptibles de se laisser aller jusqu’aux extrémités de l’euphorie comme du désespoir », écrit le financier milliardaire américain George Soros, dans son ouvrage La Vérité sur la crise financière (Denoël). Or, à voir les faillites bancaires se multiplier et la récession menacer l’économie des Etats-Unis et en Europe, les investisseurs ont de quoi perdre espoir.
Pourtant, si cette crise financière est de l’avis des experts sans doute la pire depuis la grande crise de 1929 qui avait fait s’effondrer Wall Street de 46 % en deux mois, jusqu’ici, les marchés tiennent. Techniquement, un krach correspond à une baisse de plus de 10 % d’un indice en une séance. Or, à New York ou en Europe, les pires épisodes de panique se sont jusqu’ici traduits par des baisses relativement canalisées à moins de 7 %.
« Depuis le krach de 1987, il existe des garde-fous qui empêchent les marchés de reculer trop vite, trop fort », explique Jean-Louis Mourier, analyste chez Aurel. En outre, l’abondance de liquidités mondiale, provenant notamment des pétrodollars et des injections d’argent par les banques centrales, évite des purges trop violentes.
Aujourd’hui, les investisseurs parlent davantage de « krach rampant ». C’est-à-dire d’une baisse continue du marché, sans rebond. Depuis janvier, la Bourse de Paris a ainsi reculé de 25,74 %, et celle de New York de 17,70 %. Les places des pays émergents relativement épargnées n’échappent pas non plus à la correction. Les places de Shanghaï et de Bombay ont perdu 61,72 % et 34,77 % de leur valeur en neuf mois. Aujourd’hui, la plupart des investisseurs s’attendent à ce que ce mouvement de baisse généralisée se poursuive, compte tenu de la détérioration de la situation de l’économie réelle. Moins de croissance, donc moins de profits pour les entreprises.
5) Pourquoi le reste du monde est-il touché ?
Contrairement à ce qu’on avait pu espérer au départ, la crise des subprimes ne s’est pas limitée au territoire américain. « Les Etats-Unis ont réussi à exporter leurs problèmes partout dans le monde », remarque un gérant. M. Stiglitz observe, lui, que, dans une économie globalisée, il était illusoire de penser que le nuage des subprimes ne franchisse pas les frontières des Etats-Unis.
L’accélération de la mondialisation financière, au cours des dernières décennies, a rendu inévitable ce type de contamination. Tout choc dans un pays – a fortiori aux Etats-Unis – se fait immanquablement ressentir partout sur la planète. Une sorte d’effet papillon. Des investisseurs du monde entier possédaient
des dettes américaines titrisées. La Banque centrale de Chine détient ainsi 380 milliards de dollars de créances sur Fannie Mae et Freddie Mac. Et, pour la petite histoire, l’une des premières victimes de la crise des subprimes aura été, dès l’automne 2007, une petite ville du nord de la Norvège, dont la gestion financière était un peu trop audacieuse.
6) Comment la crise financière affecte-t-elle l’économie réelle ?
Après avoir longtemps fait preuve de résistance, ce qu’on appelle l’économie réelle (la production industrielle, les investissements, l’emploi, etc.) a fini par être rattrapée par la crise financière. Le taux de chômage remonte depuis plusieurs mois aux Etats-Unis, tandis que la zone euro et le Japon ont enregistré des taux de croissance négatifs au deuxième trimestre.
La crise financière – dont l’impact vient s’ajouter à celui de la flambée des matières premières – s’est diffusée à travers plusieurs canaux. Le premier est le renchérissement du crédit. Malgré les efforts des banques centrales pour apaiser les tensions sur le marché monétaire, les taux d’intérêt ont monté. Il est devenu plus coûteux pour les entreprises mais aussi pour les particuliers de se financer. Par ailleurs les banques, plus prudentes, ont elles-mêmes accordé moins facilement des crédits. Ce mécanisme, que les spécialistes désignent sous le nom de credit crunch (pénurie de crédit) est un frein puissant aux investissements et à la consommation, donc à la croissance.
Un autre canal de diffusion de la crise financière est celui de l’effet patrimonial. La chute des marchés boursiers et de l’immobilier constitue une destruction de richesses qui là encore pèse sur le comportement des ménages et des entreprises.
Enfin, de façon plus générale, l’instabilité du système bancaire et la crainte d’assister à un effondrement en cascade d’établissements de crédit pèsent sur le moral de tous les agents économiques. Ces derniers préfèrent attendre, avant de prendre des décisions, que la tempête se calme. D’où un risque de paralysie de l’économie.
7) Les pays émergents peuvent-ils résister ?
La crise financière, qui ébranle les économies des grands pays industrialisés, a jusqu’ici relativement épargné les pays émergents. Au sein des « BRIC » (Brésil, Russie, Inde et Chine), la croissance ne montre pas de signes d’essoufflement marqué. Elle reste très élevée, notamment en Chine où elle flirte avec la barre des 10 %.
Contrairement aux précédentes crises, qui avaient mis en évidence la dépendance des pays du Sud aux pays du Nord, la crise des subprimes semble révéler une plus grande autonomie de ces nouvelles puissances économiques. Celle-ci s’expliquerait notamment par la progression du niveau de vie des populations locales et la constitution d’une classe moyenne qui consomme davantage. Selon la Banque mondiale, en Asie de l’Est, le taux de pauvreté, de 80 % en 1981, le plus élevé du monde, est tombé à 18 % en 2005.
L’idée selon laquelle la Chine et les autres grands pays émergents pourraient résister à la crise des subprimes n’est toutefois pas partagée par tous les économistes. « L’affaiblissement du capitalisme américain est un fait, mais les pays émergents sont plus fragiles qu’on ne le croit », tempère Jacques Mistral, économiste et membre du centre d’Analyse économique (CAE). Selon lui, la Chine notamment est encore très sensible aux fluctuations des économies occidentales. Les marchés américain et européens sont les premiers débouchés des exportations de produits « made in China ».
![]() Quelles solutions à la crise ?
Quelles solutions à la crise ?
Les économistes sont unanimes pour dire qu’on ne pourra pas enrayer une crise d’une telle ampleur en agissant uniquement sur la liquidité, c’est-à-dire en injectant de l’argent dans le circuit financier mondial, pour permettre aux banques de se financer. Toute la régulation du système financier mondial doit être repensée.
Le débat se focalise autour de quelques grandes idées : la suppression des zones de non-régulation dans la sphère financière (les établissements de crédit hypothécaire américains) ; la mise en place de règles strictes pour les agences de notation qui évaluent les risques de crédit des entreprises (méthodologie, transparence, etc.) ; l’assouplissement des normes comptables internationales, assises sur la valeur de marché des actifs, qui ont accentué les effets de la crise ; le remplacement du G7 par un G20 associant les pays émergents, à même d’aider l’économie mondiale à sortir de la crise grâce à leurs excédents de liquidités ; en Europe, la mise en place d’une supervision bancaire européenne calquée sur le système européen de banques centrales et dialoguant avec les autres superviseurs mondiaux…
Mais dans l’immédiat, il faut trouver une solution de sortie de crise. Deux écoles s’affrontent. L’une prône la mutualisation des pertes via la mise en place de systèmes de défaisance géants, qui permettront d’amortir les pertes. L’autre s’en remet à une gestion de la crise au cas par cas, en fonction du risque que représente une banque pour la stabilité d’ensemble du système financier.
Source: Pierre-Antoine Delhommais, Claire Gatinois et Anne Michel (Le Monde)