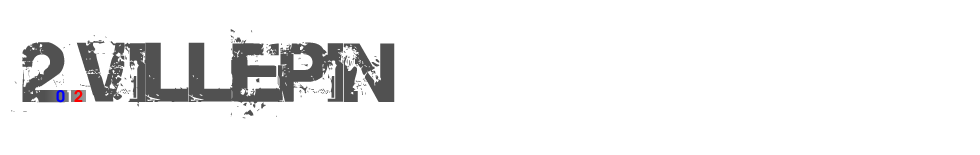« Ici, rue de Varenne, les Ouvriers de l’Heure passent, mais ils ne se livrent guère. Voici donc consignés quelques fragments d’un registre sans date, arrachés à une longue nuit.
Face aux Minotaures, ce fil d’encre et de papier m’a aidé à tenir le cap. A chaque feuillet, j’ai voulu m’alléger, me désamarrer : creuser en moi pour trouver la force d’avancer jusqu’au retournement de la conscience où l’épreuve devient une chance de libération.
Quoi que l’on entreprenne, il y a toujours vautours et gibets au bord du chemin.
Mais peut-être notre meilleur allié est-il parfois le mauvais sort. A minuit, la solitude se brise par la grâce de compagnons sollicités, compagnons invisibles qui défrichent la vie aux avant-postes, qui fixent des repères, qui nous donnent des mots comme autant d’armes pour notre propre combat. A leur suite, tout un peuple de riverains s’élance à l’assaut des horizons neufs. Et au matin, le miracle se renouvelle : l’homme s’éveille, libre de toutes entraves.
C’est le temps de l’aveu. Celui que l’on se fait à soi-même. Etre au monde ne va pas sans tremblement. Etre en politique ne va pas sans périls.
Aujourd’hui, comme hier, le cœur saigne. Le combat est solitaire, d’un devoir sans gloire. Jeux anonymes, mouvements de houle nourrissent la rumeur, contes cruels jetés en pâture par des chroniqueurs sourds aux sentiments humains. Comment pourrais-je avancer quand le bagage devient fardeau, brûle l’échine, lacère ? Et qui craindre le plus : l’ange ou le démon, l’effroi de l’âme ou le combat des hommes ?
Ecrire, non pas une chronique de la peur mais un journal contre la peur, enrichi du regard de quelques fidèles, scrutant gouffres et ciels, depuis les hunes, dans un enchevêtrement de lames, de mâts et de cordages.
Je veux partir avec les guetteurs de terre, Char et Celan, avec les navires démâtés de Rimbaud et de Baudelaire, et les voix d’îles, d’archipels et de rivages de Césaire, Walcott ou Darwich. Tant d’autres encore se frayent un chemin à travers les ruines d’un monde dévasté.
Aux heures de la plus grande inquiétude, partir à la recherche d’une sérénité perdue, c’est remonter dans son passé pour retrouver une lumière première.
Cette lumière, j’ai eu, enfant, la chance d’en être ébloui. Du Maroc à l’Amérique du Sud. Les vastes étendues désertiques furent mon premier tableau noir, là où toutes traces et toutes différences s’effacent. Je n’ai pas oublié les prières du jour et la brûlure de la nuit. Je rêvais des villes saintes où les livres sont comme de vieux sages et où les hommes parlent comme des grimoires anciens : Chinguetti, là-bas, à portée de chameaux, où se rassemblent les pèlerins pour la Mecque, où sont collationnés manuscrits et corans, que garde le vigilant minaret de la mosquée, surmonté de ses cinq globes dorés.
Les hasards de la vie m’ont conduit dans bien d’autres contrées, dans cette Inde toute pleine encore de la parole des Védas, ou encore dans une Afrique où résonnent les souvenirs de l’empire du Mali. J’avançais dans l’oublié, l’inexploré ou le dédaigné. Après l’Orénoque ou l’Amazonie, je rêvais encore de Patagonies et de Tibets. Pour défier la guerre silencieuse des hommes entre eux, la violence, la misère, l’injustice, je voulais partir à l’assaut des continents aux appétits d’empire insatiables. Pour moi, la parole d’exil fut d’abord l’apprentissage d’une terre intérieure, gagnée sur la solitude. Je m’approchais de civilisations anciennes où des paroles magiques et des rites puissants s’offrent pour surmonter les peurs resurgies d’un passé ancestral. Ainsi l’homme espère-t-il dompter la brousse, terrasser la Bête, triompher des forces qui cherchent à l’asservir. »
Source: Hôtel de l’Insomnie, par Dominique de Villepin (Plon)