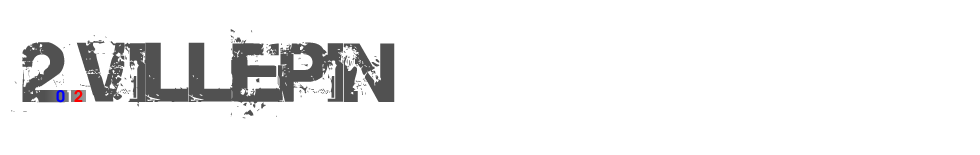« Le soleil noir de la puissance » : contrairement à ce que l’on serait tenté de croire, ce beau titre savamment énigmatique du nouveau livre de Dominique de Villepin n’annonce pas une autobiographie de l’ancien Premier ministre, mais le deuxième volume de la trilogie qu’il consacre à Napoléon.
Celui-ci porte sur la période 1796-1807, celle qui s’ouvre par la victoire miraculeuse de Lodi, à l’issue de laquelle le jeune commandant en chef de l’armée d’Italie conquiert sa célébrité, et qui s’achève par le traité de Tilsit, cet apogée de l’Empire.
Autant dire qu’il s’agit de la période la plus faste de l’épopée napoléonienne, puisqu’elle couvre l’ascension de la gloire militaire de Bonaparte, la conquête de la popularité inouïe qui fut la sienne dans la France traumatisée et déchirée du Directoire, l’établissement du Consulat, le sacre (ridicule) et l’Empire, la série la plus prestigieuse, incomparable même, des grandes victoires militaires, les conquêtes, l’Europe continentale à genoux, mais aussi, mais encore l’invention de l’Etat moderne, la formation d’une administration à l’époque unique au monde, les grands textes civils, la France à son plus haut.
Avec Dominique de Villepin, rien n’est jamais simple : de cette chevauchée fantastique de l’Histoire, il fait la tragédie d’un désastre annoncé. Sur ces prouesses, sur ces triomphes, sur ces exploits il bâtit un mausolée mortel inéluctable. Deux siècles après, quand on connaît l’épilogue wagnérien de l’aventure napoléonienne, cela pourrait ressembler à une prophétie trop facile, trop évidente. Il n’en est rien. Car il s’agit en réalité de la projection irrépressible de l’étrange tempérament littéraire, fiévreux, spontanément apocalyptique de l’auteur. Villepin ne saurait être Villepin que dans le drame, et pour lui la France, même au plus haut de la gloire impériale, ne saurait être qu’un chef-d’oeuvre traqué par le destin.
« Le soleil noir de la puissance » n’est pourtant pas un livre indifférent. Autant les essais politiques de Dominique de Villepin (« Le cri de la gargouille », « Le requin et la mouette », etc.) sombrent dans le galimatias et dans l’amphigouri, autant ses ouvrages historiques ne manquent ni de force, ni de rythme, ni même de clarté. Comme le premier tome déjà publié de cette série (« Les Cent-Jours ou l’esprit de sacrifice »), celui-ci a de l’élan, parfois de la puissance. Villepin est à l’aise dans les grandes synthèses géopolitiques, a de la verve pour décrire les batailles, les négociations ou les trahisons. Il a lu tous les grands textes, qui abondent (Chateaubriand, Benjamin Constant, Michelet, Thiers, Taine, Albert Sorel, Stendhal, François Furet), toutes les études précises (Tulard, Bredin, Jouvenel, etc.), tous les Mémoires (il donne sa juste place aux remarquables souvenirs de Marmont), il les utilise intelligemment et il les cite avec probité. S’il n’apporte évidemment pas d’informations inédites, s’il ne propose pas d’éclairages inattendus sur les situations ou sur les personnages, son jugement est sûr et sa langue se dépouille. Reste qu’il faut une dose d’orgueil peu banale pour oser ainsi se confronter à tellement d’auteurs illustres sur le sujet le plus souvent abordé de l’histoire de France. Reste aussi qu’au fil des pages ce Napoléon apparaît en quelque sorte villepinisé. La peur et le rêve, l’ambition et la démesure, les prouesses et les aveuglements, les emportements et les accablements, l’audace et le trouble semblent surgis du miroir d’un Villepin en redingote grise et petite tenue de colonel de chasseurs à cheval.
Source: Alain Duhamel (Le Point)