Cinquième « épisode » de notre série « Villepin, l’Homme d’Etat »: « Point de déclin, mais un destin », une Tribune signée par Dominique de Villepin en octobre 2003.
Celui-ci redit son amour pour la France, « notre vieux pays » selon le titre de son dernier livre à sortir en librairie dans 10 jours:
« Cette France, je l’aime « comme un bloc », dans la lignée d’un Clemenceau qui a su honorer son âme en la qualifiant de « soldat de l’idéal » au sortir de la Grande Guerre. « Notre patrie », célébrée par Péguy, est certes frondeuse de tempérament, divisée dans la paix, imprévisible et parfois injuste. Mais elle a toujours su se rassembler dans l’épreuve ; se relever de ses chutes pour rester à l’avant-garde du progrès. Je crois à la pérennité d’un patriotisme rassembleur, ce « plébiscite de tous les jours » cher à Renan. Je crois au relèvement par la volonté. Notre pays demeure porteur, au-delà d’une histoire, de valeurs qui obligent et d’atouts économiques reconnus », écrit Dominique de Villepin.
*****
« De nouveaux clercs sonnent le tocsin. A les lire, la France serait à l’agonie. Impuissante, irrémédiablement condamnée au déclin. Face à la polémique qui enfle, il faut s’en tenir à la réalité. Un constat d’abord. La nostalgie d’un âge d’or est presque aussi vieille que la France elle-même. « Les hommes d’autrefois étaient beaux et grands. Ce sont maintenant des enfants et des nains », se lamentait déjà Guiot de Provins au début du XIIIe siècle. La plainte revient en force au lendemain de la Révolution, qui féconde l’école réactionnaire. Nourrie de Burke puis de Maistre, elle n’a cessé de dénoncer la République régicide puis la dictature impériale, appelant à la « libération » de l’étranger pour célébrer la Restauration vengeresse et condamner la monarchie de Juillet, avant cette IIIe République qui osa écarter Boulanger puis acquitter Dreyfus.
Ressourcée par le positivisme, l’Action française prenait un relais nauséabond, antisémite et parlementicide, jusqu’à ce que sa condamnation par Rome l’eût réduite à un groupuscule dont le dernier carré allait inspirer la flétrissure de Vichy. Comme chacun sait, l’ultracisme n’allait pas tarder à renaître de ses cendres. L’apocalypse sur fond de diabolisation des politiques a toujours constitué son fonds de commerce idéologique, les philippiques sur le déclin et les petites phrases assassines contre les dirigeants sa marque de fabrique.
Dressé par la défaite militaire ou la crise économique, le spectre de la chute a hanté chacune de nos périodes de troubles et de métamorphoses : 1789, 1815, 1870 ; les années 1930, 1940, puis la décolonisation ont ouvert les joutes et confronté les points de vue. L’interrogation légitime sur le destin de la France habite Chateaubriand, Tocqueville, Taine ou le Renan de la Réforme intellectuelle et morale, avant André Tardieu dans La Révolution à refaire,ou Marc Bloch dans L’Etrange défaite. Nulle complaisance dans ces textes appelés à durer. Nulle attaque basse, facile, méprisante. Aujourd’hui comme hier, il faut penser la France sans pour autant la dénigrer.
La rhétorique du déclin entremêle, dans un étrange attelage, influences réactionnaires, technocratiques et ultralibérales. Le courant réactionnaire, comme au lendemain de la Révolution, refuse le changement, l’accusant de n’amener que désordre et décadence. L’école technocratique, issue du rationalisme du XIXe siècle, débite la France en statistiques qu’elle commente à perte de vue et de sens. Quant à certains libéraux, ils reprochent à notre pays de n’avoir pas osé ces réformes à la hache qu’illustrèrent, en leur temps, Margaret Thatcher ou Ronald Reagan, tout en se réclamant, de manière aussi ambiguë que peu convaincante, du libéralisme politique.
Venons-en maintenant au coeur du propos, autrement dit aux accusations d’arrogance et d’immobilisme. Loin d’un quelconque angélisme ou d’une vanité déplacée qui sont les deux faces d’une même démagogie, le gouvernement n’a jamais nié que la période était difficile. Faut-il rappeler que le président de la République a été le premier à diagnostiquer la fracture sociale ? Le choc du 21 avril a révélé l’ampleur des défis à relever pour les partis de gouvernement ; le chômage angoisse les Français ; les déficits réduisent les marges de manoeuvre.
Assurément, la France s’inquiète devant l’Europe et la mondialisation. Sa croyance en un avenir meilleur, fortifiée par le cycle vertueux des « trente glorieuses », s’est assombrie depuis une génération. Nombreux sont ceux qui ne croient plus en la politique, oscillant entre la démission dans l’abstention ou la fuite en avant dans le vote protestataire. Mais le doute n’est pas l’échec, la crise ne signifie pas la fatalité de la chute.
Ce qui est en revanche indéniable, c’est que ce rang, ce modèle seraient aujourd’hui menacés si notre pays n’était pas capable de mener à bien de vigoureuses réformes. Nous devons transformer notre Etat pour le rendre plus efficace, remettre en marche l’ascenseur social, libérer les énergies et les initiatives, soutenir et protéger les plus faibles et les plus défavorisés, redonner sens et souffle à la politique et conforter notre place dans le monde par l’affirmation de notre vision. La peur du déclin est infondée. Mais le débat a le mérite de souligner l’exigence du changement.
L’héritage des erreurs passées aurait pu inciter à la résignation, la véritable antichambre du déclin. Au lieu de baisser les bras, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a fait le choix résolu de l’action. A ceux qui parlent d’immobilisme et d’absence de résultats, je veux opposer les faits. En un an, la réforme des retraites, qui était susceptible de faire tomber dix gouvernements, selon le mot d’un ancien premier ministre, a été réalisée. Le processus de refondation de notre système de santé est désormais engagé. Une étape décisive de la décentralisation a été actée. L’insécurité, qui gangrenait les fondements mêmes de la société, a reculé. La valeur travail, sans laquelle il n’y a ni progrès économique ni progrès social, a été réhabilitée : les 35 heures ont été assouplies ; le smic augmenté d’un niveau sans précédent depuis vingt ans ; l’impôt sur le revenu baissé de près de 10 % pour que l’effort et le talent soient enfin mieux récompensés ; le revenu minimum d’activité conçu pour aider les plus fragiles à sortir du piège de l’assistance et à retrouver le chemin de l’activité et de l’emploi.
Le dialogue social est devenu un des moteurs de la réforme, comme en témoigne le récent accord sur la formation professionnelle, signé par tous les syndicats, symbolisant ainsi un mouvement profond de notre société : au-delà des tensions inévitables, nous sommes en train de passer d’une culture d’affrontement social à une culture de dialogue et de contrat. N’en déplaise à certains de nos clercs aveuglés par le pessimisme et l’amertume : la France réforme, la France travaille, la France dialogue.
L’honneur du gouvernement est de relever les défis, sans présupposés dogmatiques, déterminé qu’il est à accomplir la transformation qui nous permettra d’affronter le monde de demain. Il reste encore beaucoup à faire, bien des batailles à gagner, mais le mouvement est lancé. La responsabilité de tous les acteurs du pouvoir et de la société est engagée. Dans un pays où l’Etat a précédé la formation de la nation, l’exemple doit bien sûr venir d’en haut, d’autant plus vigoureusement que le grand enjeu de la révolution pacifique à conduire, c’est bien de remettre cet Etat à sa vraie place, au service des Français. Le sursaut est nécessaire, même si le doute et l’inquiétude sont là. Chacun en est conscient. C’est notre chance !
Créatifs dans leurs invectives, nos chantres du malheur le sont nettement moins dans leurs propositions. Le grand soir libéral, que certains appellent de leurs voeux, conduirait non pas au « rêve américain » mais à l’impasse. La neurasthénie en vogue aggrave les maux qu’elle prétend combattre. Si la France est aussi malade qu’on le prétend, le meilleur moyen de la guérir consiste-t-il à lui seriner dix fois par jour qu’elle va mourir et que ses médecins sont incompétents ? L’autoflagellation n’est pas un signe de courage mais bien plutôt de faiblesse.
Si l’Etat a ses pesanteurs et ses manques, la diabolisation de ses serviteurs désignés comme boucs émissaires des difficultés actuelles ne facilitera en rien sa mutation. Et les sarcasmes contre quelques-uns des travers supposés de nos compatriotes n’aideront pas non plus la France.
Cette France, je l’aime « comme un bloc », dans la lignée d’un Clemenceau qui a su honorer son âme en la
qualifiant de « soldat de l’idéal » au sortir de la Grande Guerre. « Notre patrie », célébrée par Péguy, est certes frondeuse de tempérament, divisée dans la paix, imprévisible et parfois injuste. Mais elle a toujours su se rassembler dans l’épreuve ; se relever de ses chutes pour rester à l’avant-garde du progrès. Naturellement, cela n’est jamais allé sans cris ni heurts. Toutefois, le sentiment d’unité, ce choix du vouloir-vivre ensemble, fortifié par une histoire commune, a toujours su transcender les clivages.
Je crois à la pérennité d’un patriotisme rassembleur, ce « plébiscite de tous les jours » cher à Renan.
Je crois au relèvement par la volonté. Notre pays demeure porteur, au-delà d’une histoire, de valeurs qui obligent et d’atouts économiques reconnus, notamment en termes de qualification et d’innovation. Il suffit de voyager au-delà des frontières de notre Hexagone pour le constater. A l’étranger, la France reste un pôle de pensée et de culture, une puissance majeure, sur le plan économique, militaire ou politique. Et c’est au moment où notre pays retrouve sa voix originale dans le concert des nations, c’est au moment où un grand nombre de peuples se reconnaissent dans les valeurs que la France défend, que fuse l’accusation d’arrogance, dans la bouche même de ceux qui crient au déclin.
Pourtant, regardons autour de nous. La France montre une extraordinaire vitalité. Des entreprises comme Renault ou Air France, qu’on disait naguère condamnées, se sont redressées de manière spectaculaire jusqu’à occuper, dans leurs secteurs d’activité, les premières places mondiales. En dépit de coûteuses erreurs de politique économique, à l’image des 35 heures, la France tient son rang, affiche un niveau de vie élevé, parvient à préserver un modèle social équilibré.
Point de déclin, mais un destin. Au regard destructeur et désenchanté, j’oppose celui que je croise jour après jour, renvoyant l’image d’une France influente, entendue et attendue, respectée pour ses idées. Je veux continuer à défendre cette France audacieuse et solidaire, servie par un Etat moderne. La force du compromis national réside dans l’équilibre qu’il a su trouver entre sacralité des libertés individuelles et solidarité publique, initiative et protection, humanisme et universalisme.
Au nouvel âge de la mondialisation, cet équilibre doit être repensé afin d’être pérennisé. Loin d’être archaïque, je le crois résolument porteur d’avenir. La conscience de notre identité dans un monde troublé, alliée à l’esprit de conquête, constitue notre meilleur atout.
Devant les défis qui nous attendent, la vocation du politique consiste plus que jamais à se rassembler autour d’un devenir commun. Pour relever le gant, il a besoin de toutes les capacités, à commencer par la créativité des intellectuels. Là comme ailleurs, l’importance des enjeux justifie une mobilisation féconde. »
Source: Tribune de Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie, publiée dans Le Monde du 7 octobre 2003, dans la série « Comment va la France ? »
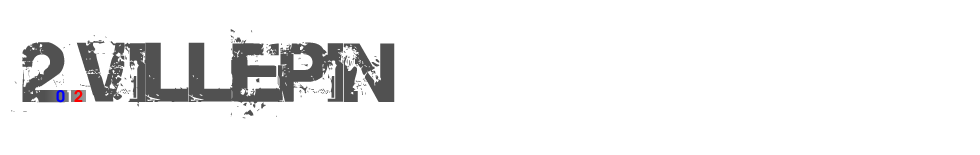


Il parle d’un pays et c’est mon pays.
Oui, quel Verbe.
DDV.. je sais « c’est bête ».. mais je crois à lui.