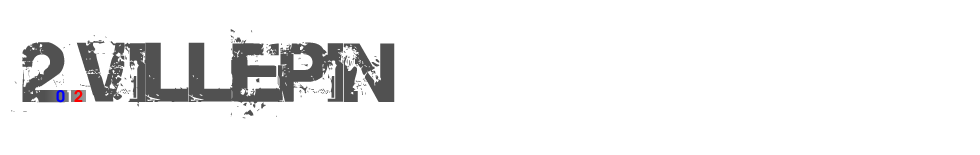La rédaction du magazine Casemate, magazine consacré à la BD, nous autorise à reproduire des extraits de l’interview que lui a accordée Dominique de Villepin, à l’occasion de la sortie cette semaine de Quai d’Orsay chez Dargaud. Pour lire l’interview dans son intégralité, le numéro 26 du magazine Casemate est en vente dans les kiosques jusqu’au 28 mai.
Dominique de Villepin connaît la bande dessinée. Il compte parmi ses amis Régis Franc et fut celui de Gérard Lauzier. Mais rien ne le préparait à devenir héros d’un roman graphique, Quai d’Orsay, dessiné par Christophe Blain, l’auteur de Gus, Isaac le pirate, Le Réducteur de vitesse… Coscénarisé par Abel Lanzac (pseudo), ex-membre du cabinet de Villepin aux Affaires Etrangère au temps de la crise irakienne, le livre a séduit le ministre qui balaie la charge comique pour retenir la vérité du mouvement, de la vitesse, véritable marque de cet homme en perpétuelle accélération. Bien vu, monsieur Blain.
Casemate: Vous reconnaissez-vous dans Quai d’Orsay?
Dominique de Villepin: Dans ce travail, c’est le mouvement qui m’a fasciné. Lorsque l’on parle du Quai d’Orsay, on s’attend à une vieille dame pluricentenaire, immobile, sclérosée, arthrosée. Et là, on voit une espèce de tornade, ce qui correspond bien aux deux années que j’ai passées au ministère des Affaires Etrangères, à essayer de porter secours aux quatre coins de la planète et d’apporter des réponses à d’autres crises. Il y a un double mouvement qui me paraît bien vu: un mouvement physique qui correspond bien à ce que nous avons vécu à cette période, et en même temps la quête des mots pour trouver la bonne façon de nommer et de dire, qui est le premier outil du diplomate.
Justement, Quai d’Orsay montre combien le mot – ce mot qui doit mettre le monde en mouvement – est malléable, mouvant, négocié entre des influences et des exigences contradictoires…
En effet, cette bande dessinée fait bien ressortir que le point central, c’est la quête. Cette quête est à la fois un mouvement vers les choses, vers les gens, à travers la géographie et l’Histoire et une sorte de rébellion par rapport à l’ordre établi. J’ai la conviction que dans la chose publique autant qu’en diplomatie, le mot précède l’action. Là, on rejoint la poésie. Rimbaud disait: « La poésie ne rythmera plus l’action, elle sera en avant. » Et c’est parce que j’ai voulu appliquer cet adage quand j’étais au Quai d’Orsay que, pendant ces deux années, la parole a été une vraie prise de risque, sur les concepts, sur les mots, sur les gens à qui on parlait. Il fallait constamment que la parole soit devant. C’est pourquoi j’ai passé mon temps à répondre à des interviews, à écrire des tribunes, à faire des discours, parce que j’essayais à chaque fois d’aller plus loin. Et, à chaque fois, la machine diplomatique du Quai d’Orsay était forcée d’avancer et de se remettre en cause, alors que, traditionnellement, le mot en diplomatie est le plus petit dénominateur commun. En général, on ne fait pas d’effort, on prend le mot le plus consensuel, on prononce la parole minimale. Moi, il fallait que je sois celui qui prenne le plus de risques, il fallait que je lance très loin la parole pour essayer de faire avancer tout le monde.
(…) J’ai eu la chance d’avoir à travailler dans une période où tout explosait: les relations avec les Etats-Unis, le positionnement d’un certain nombre de pays émergents, la poussée d’un certain nombre de grands pays, les rapports de force, les défis de l’après-2001 comme le terrorisme et la prolifération… On ne pouvait pas rester sur notre quant-à-soi et il fallait des mots plus grands, qui débordent, qui obligent à penser autrement. Il fallait que la France soit dans l’initiative et je demandais aux diplomates de faire qu’elle soit devant. Dès lors, c’est un mouvement perpétuel pour prendre la mesure des choses et pour essayer d’éteindre les incendies. Il faut alors être capable de conjuguer la vitesse (on a souvent fait quatre pays en une journée) et les mots.
On a l’impression que le cabinet fonctionne comme une bulle cernée par le monde, le président de la République et les autres ministres…
Oui, mais avec, dans ce cas précis, deux caractéristiques: il faut être en avant-garde, et il faut que cette avant-garde soit en permanence remise en cause. Et moi je joue tous les jours et vingt fois par jour le rôle de trublion. Je fais reprendre les choses, je fais intervenir un autre membre du cabinet pour stimuler le premier qui travaille sur un discours… On est dans une sorte d’insatisfaction permanente, mais créatrice. Le but est que chacun soit perpétuellement dans un mouvement qui l’amène à donner le meilleur de lui-même. C’est là que le rapport au ministre devient très complexe: il faut à la fois beaucoup d’affection parce qu’on ne peut pas travailler sans une estime réciproque, il faut prendre en compte la vie personnelle de chacun, les contraintes affectives et relationnelles entre les uns et les autres… Mais quand ce mouvement s’arrête, c’est la répétition, le déjà-vu, le médiocre.
Source: Casemate – Numéro 26 – Propos recueillis par Bertrand Dicale