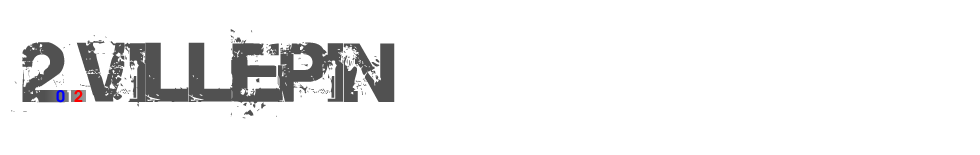Dominique de Villepin a accepté de répondre aux questions de Femina.fr sur sa vision de la politique et sur le sens de son engagement.
Dans cet entretien, l’ancien Premier Ministre fait part de son ambition politique. « Mon ambition, c’est de servir. Dans les circonstances qui se présenteront, à la hauteur des possibilités telles qu’elles existeront ». « En revanche, je ne souhaite pas mettre de limite au combat que je veux mener. Je pense que la France aujourd’hui, dans la crise, doit penser grand (…) je sais aussi que nous pouvons le faire, qu’il n’y a pas de fatalité », ajoute-t-il.
Dans la même interview, Dominique de Villepin évoque son enfance passée au Maroc et au Vénézuela, « des pays où de fortes inégalités sociales existent », où il a pu « prendre conscience assez tôt des enjeux sociaux et de l’importance de la justice ».
Version Femina: A l’adolescence, étiez-vous déjà quelqu’un d’ »engagé »?
J’ai ressenti le besoin de m’engager très jeune, lors de mon enfance passée au Maroc puis au Venezuela. Ce sont des pays où de fortes inégalités sociales existent. J’ai donc pris conscience assez tôt des enjeux sociaux et de l’importance de la justice.
Evidemment, quand on est jeune, l’engagement prend des formes très sommaires. Mais mon envie de contribuer à un nouvel ordre mondial, plus juste, remonte à cette période-là.
Comment est arrivée la politique dans votre vie ?
Ma première réflexion, sur le plan politique, s’est articulée autour de mes racines familiales. J’ai eu de nombreuses discussions avec mes parents, gaullistes, et mes grands-parents, très engagés dans le service de la France. C’est à travers leur histoire, leurs propres batailles que j’ai eu envie de reprendre le combat à ma façon. La découverte de l’Histoire de France a également beaucoup contribué à l’éveil de mon sentiment politique. Le fait d’avoir grandi à l’étranger m’a davantage sensibilisé à l’image de la France dans le monde, à son rayonnement et aux attentes qu’elle créait. Pour ces raisons, après avoir fait l’ENA, j’ai choisi de devenir diplomate. Je voulais contribuer à faire vivre la France sur les territoires extérieurs. Au fil des années, mon sentiment que ce pays avait une âme, une langue, un projet d’organisation de la société mondiale, ainsi que des valeurs qu’elle souhaitait défendre, a grandi en moi. Cela m’a donné envie de participer à la vie politique. Etant gaulliste, je me suis naturellement tourné vers Jacques Chirac, qui était alors maire de Paris. Il se trouve que ma sous-directrice au Quai d’Orsay était l’épouse de Camille Cabana, secrétaire de la ville de Paris à la même époque. J’ai donc rencontré très simplement Jacques Chirac, lorsque j’avais vingt et quelques années. Voyageant beaucoup et rencontrant de nombreux dirigeants internationaux, j’ai ainsi commencé à participer à sa réflexion.
Pouviez-vous dès lors imaginer les enjeux d’un tel engagement?
On mesure très tôt l’extrême exigence d’un tel engagement. Cette activité proliférante allait très vite devenir le centre de ma vie.
La politique vous a-t-elle appris quelque chose sur vous-même ?
Bien sûr. Tout ce qui est difficile vous apprend quelque chose sur vous-même. Par exemple, quand vous faites du marathon – ce qui est mon cas – au delà de 30 kilomètres, vous vous trouvez dans une solitude telle qu’il devient nécessaire de savoir puiser au fond de soi. La politique, c’est pareil. On ne fait pas de politique sans risque ou sans critique. Il faut être très sûr de ce que l’on défend et du combat que l’on mène, sans quoi, il ne nous reste plus qu’à déposer notre sac au bord du chemin. On apprend à se connaître davantage, à faire la part entre l’essentiel et l’accessoire. On redouble aussi de détermination. En ce qui me concerne, ayant choisi le service public, mon engagement était de servir les Français. Mais en politique, il faut quelque chose de plus : cette conviction de pouvoir changer les choses. En découle une capacité au dépassement, au-delà même de ce qui est raisonnable. Parce que l’on sent que si l’on ne fait pas les choses, personne ne le fera à notre place. Puis on découvre des sentiments et des questions qui n’apparaissent que dans la difficulté. On est parfois amené à se demander si tout cela vaut la peine, s’il est nécessaire de prendre tant de risques. Ces questions-là vous amènent à puiser en vous, ce qui est très enrichissant.
Quel aspect de ce milieu trouvez-vous le plus difficile ?
Le plus difficile, c’est d’apprendre à ne pas répondre. À ne pas rendre coup pour coup. À ne pas s’attarder sur des critiques ou des attaques qui n’ont pas d’autres buts que celui de vous faire mal et de vous immobiliser. On peut aussi être touché par le scepticisme de beaucoup de citoyens. On doit faire abstraction de beaucoup de choses désagréables pour arriver à persévérer. Parfois, il faut peu de sens commun pour continuer en politique. Mais l’Histoire nous a montrés à quel point la ténacité est nécessaire pour défendre ses valeurs et ses convictions, afin que de nouvelles choses deviennent possibles. Ces débats, ces combats, ne peuvent être menés qu’avec le sentiment certain qu’ils servent une cause visant l’intérêt général.
Que préférez-vous en politique ?
Il y a d’abord les convictions, si fortes qu’elles vous poussent dans vos retranchements et peuvent dès lors rendre les choses réalisables. Puis il y a des images très concrètes, des personnages en chair et en os, des témoignages qui vous donnent une raison supplémentaire de vous battre et de continuer. Quand, par exemple, de jeunes agriculteurs vous disent qu’ils ont décidé de consacrer leur vie à une forme d’élevage mais qu’ils constatent qu’ils ne vont pas y arriver, cela vous touche. Vous pouvez peut-être faire quelque chose pour les aider. Ou contribuer à les aider, car la politique, ça ne se fait pas tout seul. Ce sont de nombreux hommes et femmes qui, avec leurs engagements mis bout à bout, rendent les choses réalisables. Cela implique donc beaucoup d’humilité. Chacune de ces personnes peut faire la différence. Je l’ai vécu lors de drames humanitaires, ou, tout récemment, à Haïti. Quand ce qui semblait perdu, cinq minutes avant, devient à nouveau possible parce que quelqu’un se lève ou tend la main, qu’une vie est sauvée, qu’un enfant va vivre ; quand ce type de miracle survient, vous n’avez plus jamais la tentation de baisser les bras.
Source: Cyril Cournoyer de l’Epine (Version Femina)