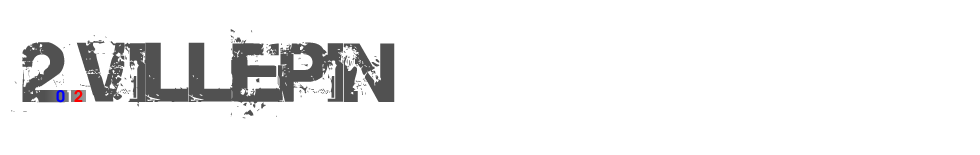Edwy Plenel, Directeur de la publication de Mediapart, nous autorise à reproduire ici son article intitulé « Clearstream: les faits contre les fictions » publié dans l’édition de Mediapart datée du lundi 1er février. Qu’il en soit chaleureusement remercié, tant ce texte s’avère remarquable sur la forme comme sur le fond !
Libre commentaire de M. Edwy Plenel, partie civile au procès, et Directeur de la publication de Mediapart.fr
Le jugement du procès Clearstream n’aura pas surpris les lecteurs de Mediapart, tant nous n’avons cessé, à contre-courant des médias dominants, d’affirmer que la réalité de cette affaire était à mille lieues de la légende sarkozyste d’un complot villepiniste. Ce n’était pas un engagement d’opinion, mais un travail d’information.
Il suffit de relire aujourd’hui nos enquêtes avant l’ouverture du procès, puis notre prise de position le jour de son ouverture, enfin notre compte-rendu des audiences pour retrouver un fil logique menant aux conclusions du tribunal.
Partie civile, puisque victime, comme 227 autres personnes physiques ou morales, de la calomnie qui m’attribuait un compte bancaire suisse bénéficiaire de commissions occultes, et ayant, à ce titre, accès au dossier, je l’ai dit et redit, depuis le printemps 2006, tant devant les juges d’instruction que dans les colonnes des tribunes qui m’étaient offertes avant la naissance de Mediapart, Le Soir de Bruxelles ou la radio France Culture. La décision rendue par le tribunal est en tous points conforme à la position défendue à la barre par Maître Jean-Pierre Mignard, en mon nom et en celui du magistrat Gilbert Flam.
Nous la défendrons de nouveau lors du procès en appel.
Clearstream : les faits contre les fictions, par Edwy Plenel – Article publié le lundi 01 février 2010
Le jugement rendu, jeudi 28 janvier, dans l’affaire Clearstream n’est pas la victoire d’un homme sur un autre, mais d’un principe sur sa négation. Ce n’est pas la victoire de Dominique de Villepin sur Nicolas Sarkozy, même si, en concluant à l’innocence du premier, il signe la défaite du second, qui n’a cessé de vouloir détourner cette affaire à son profit, au mépris de la séparation des pouvoirs et de l’égalité des armes. Non, c’est, bien plus essentiellement, une victoire des faits sur les fictions, de la vérité des faits sur le mensonge des rumeurs, de la réalité factuelle sur les spéculations intellectuelles.
En ce sens, c’est une victoire de la raison contre la déraison, de la justice contre son détournement, de la démocratie contre sa privatisation. Car rendre la justice, ce n’est pas spéculer ; c’est, d’abord, démontrer. Dire le droit, ce n’est pas croire ; c’est, au préalable, prouver. Sans réalité factuelle, pas de construction juridique. Sans faits, pas de droit. Modèle du genre avec ses 327 pages extrêmement fouillées, toutes de précaution et de rigueur, le jugement de la onzième chambre du tribunal correctionnel de Paris, présidée par Dominique Pauthe avec, pour assesseurs, Cécile Louis-Loyant et Virginie Tilmont, ne s’en tient justement qu’aux faits, les cernant avec une extrême minutie tels qu’ils ressortent du dossier d’instruction et des audiences du procès.
Or quels sont les faits établis, vérifiés, recoupés, incontestables, dans ce dossier ? D’abord qu’il n’y aurait jamais eu d’affaire Clearstream sans le faussaire Imad Lahoud qui, au final, apparaît bien comme le personnage central ainsi qu’en témoigne l’échelle des peines, sa condamnation étant la plus lourde. Ce n’est pas un exécutant secondaire, mais un premier rôle. Lahoud, dit le tribunal, est « un menteur invétéré, un metteur en scène insatiable et un comploteur infatigable » ; « il s’est révélé un redoutable escroc aux renseignements », mettant « son indéniable intelligence et ses compétences professionnelles indiscutables au service d’un arrivisme certain » ; paraissant « s’être installé dès 2002 dans une activité de faussaire », il est « parvenu à se rendre indispensable et insoupçonnable, voire intouchable » auprès de ses protecteurs, aussi bien dans le monde de l’industrie que dans celui du renseignement.
Ensuite qu’à ce faussaire, il faut ajouter un calomniateur : Jean-Louis Gergorin, « l’initiateur et l’auteur principal des délits de dénonciations calomnieuses ». Sous le choc du décès soudain, début 2003, de son mentor, Jean-Luc Lagardère, « il a agi pour satisfaire des intérêts personnels sous couvert de défense de ceux d’EADS et du groupe Lagardère et des impératifs de sécurité nationale ». « Habité par une intention de nuire en partie sous l’influence pernicieuse et néfaste d’Imad Lahoud », c’est lui, et lui seul, qui « a su instrumentaliser les autorités », mettant « en scène ses démarches, leur donnant une apparence de crédibilité et de légitimité ». Ayant perdu contact avec le réel, obsédé par une vision complotiste du monde, prenant ses fantasmes pour la réalité, il n’avait plus qu’une obsession : « Crédibiliser son combat contre un ennemi chimérique par l’utilisation de données dont il connaissait le caractère mensonger. »
Pourquoi Dominique de Villepin est innocent
Deux personnages, pas un de plus, pour une seule et même chimère, construite par l’un, diffusée par l’autre. Tout autour, et le jugement n’en ignore aucun, divers protagonistes qui les ont connus ou croisés, qui ont été sollicités ou démarchés, qui furent piégés ou trompés, alléchés ou manipulés, informés et désinformés, imprudents ou curieux, mais dont aucun élément factuel ne permet d’établir qu’ils ont consciemment et activement participé à la falsification et à la calomnie, aux faux et à leur diffusion. Tous, à des degrés divers, seront utilisés comme paravents ou cautions par les deux coupables désignés qui n’ont cessé de les citer, de les mentionner et de les compromettre afin d’échapper à leurs propres responsabilités.
Tous, loin de là, n’étaient pas sur le banc des prévenus, l’instruction ayant fait un tri incohérent, partiel et partial, en ne retenant, outre le journaliste Denis Robert et l’informaticien Florian Bourges, que Dominique de Villepin afin d’étayer sa thèse d’une manipulation ourdie au sommet de l’Etat. Afin surtout d’affirmer, contre l’évidence même puisque pas moins de 228 personnes physiques ou morales furent victimes de cette calomnie, que la machination n’avait qu’une seule finalité, qu’une cible véritable : Nicolas Sarkozy.
Cette thèse des deux juges d’instruction tenait si peu et se révéla si fragile durant les audiences que l’accusation elle-même se refusera à la soutenir, le procureur de la République ne faisant plus reproche à l’ancien premier ministre que de son retard à dénoncer la calomnie.
Or la vérité du dossier comme des audiences, confortée par diverses notes administratives minutieusement citées par le tribunal, c’est que, énonce le jugement, « la preuve n’est pas rapportée à l’encontre de Dominique de Villepin tant d’une instruction, donnée en connaissance de cause, de commettre le délit de dénonciation calomnieuse dont il aurait été l’instigateur, que d’une abstention d’empêcher la réitération de la dénonciation qu’il aurait su calomnieuse, susceptible de constituer un acte de complicité ». Autrement dit, il n’y a pas la preuve, dans les milliers de pages du dossier et après plusieurs années d’investigations, que Dominique de Villepin ait pu inspirer ou accompagner la calomnie forgée par Imad Lahoud et promue par Jean-Louis Gergorin.
Ce jugement ruine la légende d’un complot chiraquien, organisé par un introuvable cabinet noir en vue de règlements de comptes, à droite, pour l’élection présidentielle de 2007. La seule manoeuvre politique tangible dont ce dossier témoigne depuis 2004 est la pression constante sur la justice et les médias de Nicolas Sarkozy, hyper partie civile devenue hyper président notamment par l’exploitation tendancieuse de cette affaire afin de publiquement discréditer son potentiel rival. Quant à la réalité de la calomnie, elle est plus prosaïque que les fictions, hélas, propagées par une partie de notre profession dans sa chronique aveuglément à charge du dossier : deux personnages, pas un de plus, l’un faussaire professionnel, l’autre délirant occasionnel.
Source: Edwy Plenel dans Mediapart