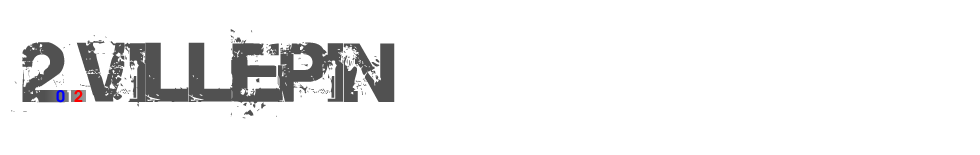Europe, Afghanistan, Culture, Avenir politique personnel… la suite des interviews données par Dominique de Villepin le weekend dernier au Portugal.
Sur l’Europe: « L’Europe est en train de manquer son rendez-vous avec l’Histoire »
Dominique de Villepin considère que l’Europe est en train de manquer son rendez-vous avec l’Histoire, en ne profitant pas de l’opportunité créée par l’arrivée d’une nouvelle Administration aux Etats-Unis.
« Je ressens une tristesse infinie en constatant qu’au moment-même où l’Amérique voudrait faire quelque chose pour le Monde, les dirigeants européens sont aux abonnés absents. Nous sommes en train de manquer une occasion formidable », a affirmé Dominique de Villepin lors d’une interview donnée à l’agence de presse portugaise Lusa, en marge du Festival du Film d’Estoril où il est intervenu le weekend dernier.
Dominique de Villepin était Ministre des Affaires Etrangères au moment de l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis et leurs Alliés, et il a alors pris clairement position contre la décision de l’Administration Bush. Il reconnaît que beaucoup de choses ont changé depuis lors: « La vision du monde des Américains et de l’Administration américaine d’Obama a profondément changé. L’Administration Bush considérait que la force était la seule réponse à apporter face aux désordres mondiaux, alors que Barack Obama est davantage respectueux des peuples et des différentes identités », a-t-il souligné.
Dominique de Villepin considère cependant que les Etats-Unis, tout comme les autres puissances occidentales, continuent à faire fausse route en Afghanistan : « Nous n’obtiendrons pas la paix en Afghanistan tant que nous considérerons que nous devons l’obtenir à travers une présence armée. Il n’y aura pas nouvelle politique possible en Afghanistan tant que nous ne commencerons pas par définir un calendrier de retrait des troupes occidentales. »
Par conséquent, « il est très important que l’Europe ne manque pas ce rendez-vous avec l’Histoire. Quels Etats européens sont capables d’aider l’Amérique à bâtir la paix au Moyen-Orient, à créer un État Palestinien ? Quels Etats Européens sont capables d’aider les États-Unis à trouver une solution en Iran ? »
« L’Europe manque d’imagination, de courage et d’envie de jouer un rôle sur la scène internationale. La grande absente sur la scène internationale, c’est l’Europe. »
En ce qui concerne la relation entre la France et le Portugal, Dominique de Villepin a souligné que les deux pays « ont en commun une ambition universaliste. (…) Nous avons conscience de nos devoirs concernant l’Afrique, nous la connaissons. Au-delà des questions théoriques, nous savons qu’il y a des visages d’hommes, de femmes, d’enfants. Nous savons ce qui est en cause en Afrique, en Amérique latine, en Asie. »
« Nous souffrons d’égoïsme et surtout de manque d’ambition. L’Europe, qui est historiquement un continent de culture, devait être aussi un continent de devoir. En temps de crise, nous avons tendance à nous rétrécir, à nous refermer sur nous-mêmes, à imaginer que la priorité, c’est la seule satisfaction de nos problèmes. Ce qui est vrai dans la vie personnelle l’est aussi dans la vie collective: plus nous nous sentons concernés par les problèmes de autres, plus vite nous résolvons nos propres problèmes. »
Sur l’Afghanistan: « Les pays occidentaux sont enlisés en Afghanistan »
« Nicolas Sarkozy a réduit la capacité de la France à faire entendre une voix indépendante sur les grandes questions, je pense notamment à l’Afghanistan. Les pays occidentaux sont enlisés en Afghanistan et la France a le devoir de montrer à quel point nous avons besoin d’un calendrier de retrait.
Quand j’étais Premier ministre, j’ai défendu l’idée d’un retrait auprès du président Jacques Chirac. Et nous avons retiré d’Afghanistan nos forces spéciales. Comme les troupes étrangères sont perçues comme des forces d’occupation, un retrait est devenu nécessaire. Il n’y a pas de politique nouvelle en Afghanistan qui ne se base préalablement sur un calendrier de retrait des forces occidentales. Et au niveau mondial, nous devons être davantage en initiative.
Je déplore que l’Europe, par exemple, ne soit pas plus présente sur le dossier iranien. C’est aussi vrai s’agissant de la question palestinienne, où les Européens sont absents. Je trouve que l’Europe n’est pas suffisamment consciente de sa mission, ce qui crée des difficultés supplémentaires pour Barack Obama.
La condition pour agir efficacement à 27, c’est d’abord que l’Allemagne et la France parlent d’une même voix. Le nouveau Traité de Lisbonne va permettre cela, à la condition que les personnes choisies pour représenter l’Europe puissent être capables de s’affirmer. Je ne crois pas que l’Europe doive être une puissance timide et que les Européens aient intérêt à avoir des responsables parlant au nom de l’Europe, le président du Conseil ou le ministre des Affaires Étrangères, qui soient de simples figurants.
Le Traité de Lisbonne nous engage dans une période de transition. Mais il faut préparer l’avenir, en ayant pour but un président du Conseil européen élu par les citoyens européens. »
Sur la Culture: « La force révolutionnaire de la Culture »
« Un ministère de la Culture est toujours un parent pauvre, réduit à sa valeur budgétaire et perçu comme un ministère de subventions », déplore Dominique de Villepin qui défend une remise à jour permanente de la politique culturelle.
« Il n’existe pas de politique culturelle toute faite: une politique culturelle a toujours besoin d’être améliorée, d’être ajustée. C’est un travail de dialogue permanent », a déclaré Dominique de Villepin lors d’une interview donnée à l’agence de presse portugaise Lusa, en marge du Festival du Film d’Estoril où l’ancien Premier Ministre français a parlé du rôle précurseur d’André Malraux, premier Ministre de la Culture français, de 1959 à 1969, sous la présidence du Général de Gaulle.
Visiteur assidu du Portugal, Dominique de Villepin connaît profondément l’histoire et la culture de ce pays. Pour évoquer l’identité culturelle portugaise, il cite volontiers Fernando Pessoa.
« Il faut constamment corriger constamment les choses, si nous voulons que les musiciens, les cinéastes, les hommes de littérature ou de théâtre puissent s’exprimer », a affirmé Dominique de Villepin. « Il faut le faire avec la préoccupation de la nouveauté et de l’accompagnement des créateurs pour franchir des étapes, et avec la préoccupation de la diversité, pour que la culture ne soit pas seulement le reflet de la mentalité d’une partie de la société ou d’une époque. »
« La politique culturelle ne peut pas ignorer les nouvelles technologies, notamment Internet. Nous avons voté en France la loi Hadopi qui essaie de remplir un vide juridique et qui permet d’affirmer que toute oeuvre de création mérite une rémunération, mais nous sommes conscients des limites d’une loi comme celle-ci, et nous devons réussir à avancer vers un système plus stimulant sur le plan culturel. »
Sur le rôle que l’État peut avoir dans ce plan, Dominique de Villepin défend que « le marché n’est pas suffisant. Il ne peut pas y avoir seulement Hollywood et Bollywood dans le cinéma ». « Comment expliquer le miracle du cinéma de Palestine, d’Israël, d’Iran, et même des films indépendants américains, avec des budgets minuscules ? »
« L’État est là pour donner une chance, pour sortir de la logique de marché, parce que le grand risque de la mondialisation, c’est que la culture soit ravalée au rang de simple marchandise. C’est une menace pour la culture. Nous avons besoin de permettre l’expression des créateurs qui ont quelque chose à dire, quelle que soit leur origine. C’est là que des mécanismes appropriés d’encouragement à la création ont la pos
sibilité de tout changer. »
Dominique de Villepin a souligné qu’André Malraux « a été le premier à montrer jusqu’à quel point il est important que chacun ait accès à la culture et à toutes les oeuvres culturelles. Cette affirmation est révolutionnaire. La culture n’est pas enfermée dans des boîtes, dans les livres, dans les musées, dans les bibliothèques ni dans les théâtres. »
L’éducation est un « bien commun » mais la culture, pour Dominique de Villepin, est plus que cela: « un lien entre les hommes, un moyen d’indépendance et d’appartenance, ce que Malraux appelait un anti-destin. »
« Le destin d’un jeune né en banlieue n’est pas le même que celui d’un enfant né dans la bourgeoisie ou de celui d’un fils d’ouvrier. Mais la culture peut aller à l’encontre de cette fatalité et permettre que chacun se réapproprie sa vie et son avenir. La culture, ce n’est pas seulement la magie des mots et des images, l’alchimie du créateur, c’est aussi ce miracle donné à chaque citoyen de de pouvoir changer sa propre vie. Un anti-destin, c’est un avenir différent de celui qui était écrit. Et c’est cela, la force révolutionnaire de la culture. »
« L’enseignement nous permet de comprendre le monde, mais la culture va plus loin. Elle permet d’agir sur nous-mêmes non seulement dans la connaissance que nous avons de nous, mais aussi dans notre capacité à changer. La culture est un élément d’interaction entre moi et moi-même et entre moi et les autres. C’est le meilleur instrument de transformation, de métamorphose. De ce point de vue, la culture est un instrument extrêmement puissant que nous avons sur nous et les autres. C’est un élément de liberté ».
Sur son avenir politique personnel: Avec Nicolas Sarkozy « une autre conception de la politique et dans certains cas, une autre conception de la République »
Dominique de Villepin affirme qu’il n’est pas dans son caractère d’être en position d’attente et que, quelle que soit l’issue du procès Clearstream, il restera fidèle à l’engagement public qui est le sien.
« Quand une personne ne s’estime coupable de rien, elle attend sereinement que la justice fasse son travail », a déclaré Dominique de Villepin à l’agence de presse portugaise Lusa.
Et d’ajouter: « Mon engagement public ne cessera de s’affirmer dans les proches années, très simplement parce que c’est ma volonté ainsi que celle de nombreux Français d’affirmer une exigence républicaine et sociale, une exigence d’indépendance nationale. »
Dominique de Villepin dit qu’il ne se considère pas comme un homme de droite, « parce que la gaullisme se place au-dessus des clivages partisans », et explique appartenir « à la tradition gaulliste qui a toujours cherché à trouver des réponses non idéologiques, marquées par l’exigence des principes et de l’intérêt national. »
Sur le rôle politique qu’il aura à l’avenir, Dominique de Villepin contourne la question et déclare qu’il désire que la France soit « républicaine, solidaire, indépendante ». « Mon combat est davantage un combat ancré dans la réalité quotidienne des Français que celui d’un homme qui se bat pour son propre succès politique. »
Tout en refusant de comparer les personnalités de Sarkozy et de Berlusconi, Dominique de Villepin reconnaît qu’il « peut y avoir des ressemblances », comme « certaines facilités ou bien encore la place de l’argent ». Mais il ne veut pas être injuste: « Nous devons considérer un homme politique pour ce qu’il veut faire. »
Et à cet égard, il ajoute: « Je n’ai pas jamais mis en cause la volonté de Nicolas Sarkozy de réformer la France, ni sa volonté de rupture, même si je suis convaincu que ce n’est pas la solution. Ce que je mets en cause, ce sont les résultats de cette politique, la capacité de cette politique à adapter et à changer la France. Je crois qu’il faut choisir quelques réformes et les mener jusqu’à leur terme, avec le souci de l’efficacité et au nom de l’intérêt général. »
Enfin, « nous devons privilégier ce qui nous unit et non ce qui nous divise. Ce sont des principes très simples pour lesquels je me bats et que je considère importants, et je ne veux pas faire de procès d’intentions à Nicolas Sarkozy. »
Interrogé enfin sur sa candidature aux élections présidentielles de 2012, Dominique de Villepin répond: « Je trouve cela prématuré. À deux ans et demi des élections, l’important, c’est d’abord de répondre aux préoccupations quotidiennes des Français en matière économique, sociale et internationale. »
La divergence avec Nicolas Sarkozy « n’est pas une rivalité reposant sur un différend judiciaire. Elle est basée sur des différences de vision, de personnalité, de tempérament, sur une autre conception de la politique et dans certains cas, une autre conception de la République. »
Source: Diario de Noticias