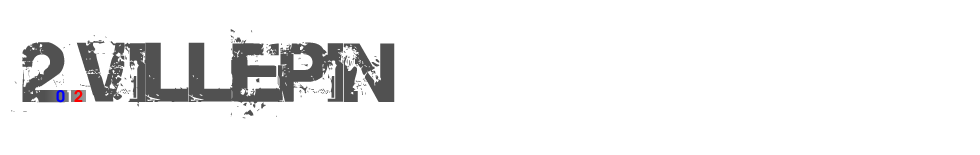Coûteux, contraire à la vision traditionnelle de la famille et porteur de l’idée d’assistanat pour la jeunesse, alors que la droite voulait réhabiliter le travail : tels sont les trois griefs potentiels auxquels s’expose le plan pour les jeunes que Nicolas Sarkozy a présenté mardi 29 septembre à Avignon.
Interrogé vendredi par des jeunes du réseau villepincom.net, Dominique de Villepin a déclaré à propos du RSA jeunes: « C’est vrai que la façon dont nous allons répondre aux problèmes des jeunes (et j’en sais quelque chose, j’ai eu à faire une crise majeure dans ce domaine) est tout à fait essentielle. Je dirais que tous ceux qui se sont attaqués à la tentative d’apporter une réponse spécifique aux jeunes ont eu des difficultés. Alors évidemment, il est peut-être plus facile de distribuer de l’argent et d’assister les jeunes: on prend moins de risques.
Quand on prend une décision aussi importante que celle-ci en direction des jeunes, décision qui engage lourdement les finances publiques, je crois qu’il faut se préoccuper à la fois des modalités, bien sûr, mais il faut aussi se préoccuper de la philosophie. Quelle est la philosophie derrière ce RSA jeunes?
D’abord constatons qu’il s’agit d’un contrat spécifique, mais avec un demi-emploi et avec une demi-rémunération. Malgré toutes les limites de ce que j’avais pu proposer à l’époque en 2006 et avec toutes les incompréhensions qui l’ont accompagné, la proposition que j’avais faite à travers le Contrat Première Embauche, c’était un vrai emploi et une vraie rémunération. Alors c’est vrai qu’il y avait un délai de deux ans d’adaptation, peut-être difficile à vivre dans un monde qui bouge vite et dans un monde où on a le sentiment et le risque de la précarité, mais c’était un vrai emploi et une vraie rémunération.
Le risque, c’est bien de créer une trappe, une trappe à précarité où des jeunes vont s’installer dans une situation entre-deux, entre deux emplois, une situation d’instabilité.
Je crois que la philosophie qui consiste à essayer d’encourager la marche vers l’emploi, le déclic de l’emploi, me paraît plus saine, plus naturelle, plus normale: c’est ce que nous avions voulu faire. Par ailleurs, la démarche qui était la nôtre à l’époque, c’était une démarche qui ne coûtait pas un sou à l’Etat: nous sommes là dans une démarche qui repose sur la contribution du budget de l’Etat.
Néanmoins, ne nous privons d’aucun instrument. Je pense que le Haut Commissaire Martin Hirsch n’est pas suspect de mauvaises intentions. Je crois que dans ce domaine-là, il faut être pragmatique, il faut voir comment les choses vont se passer. Il faut expérimenter et si les résultats ne sont pas satisfaisants, il faut en tirer les leçons rapidement. Mais de toute façon, nous n’apporterons pas avec ce RSA jeunes la réponse qu’attendent les jeunes. »
La mise en place d’un RSA jeunes soulève de nombreuses interrogations
Coûteux, contraire à la vision traditionnelle de la famille et porteur de l’idée d’assistanat pour la jeunesse, alors que la droite voulait réhabiliter le travail : tels sont les trois griefs potentiels auxquels s’expose le plan pour les jeunes que Nicolas Sarkozy a présenté mardi 29 septembre à Avignon. « Notre société s’est figée au détriment de la jeunesse », a déploré le président de la République en annonçant une série de mesures largement concoctées par le haut-commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch, pour un montant potentiel de 650 millions d’euros.
Ainsi, les jeunes de moins de 25 ans ayant travaillé à temps plein pendant deux ans (ou à deux tiers de temps pendant trois ans) et qui se retrouveront au chômage ou réduiront leur activité auront droit au revenu de solidarité active (RSA), soit 450 euros par mois, lorsqu’ils auront épuisé leurs droits à l’assurance chômage. Coût prévu : 250 millions d’euros, pour 160 000 personnes, dont 120 000 ayant un emploi.
Des dotations seront expérimentées pour favoriser l’autonomie des jeunes. S’y ajoutent toute une série de mesures pour mieux organiser l’orientation. Les jeunes de 16 à 18 ans se verront obligatoirement proposer un emploi ou une formation. Il s’agit de soutenir l’insertion d’une classe d’âge plus pessimiste en France que dans le reste de l’Europe, particulièrement frappée par le chômage, mais aussi de reconquérir un électorat rétif, selon les enquêtes d’opinion.
« Je vais faire ce que la gauche aurait dû faire depuis longtemps », a notamment dit M. Sarkozy. Il surveille toujours avec inquiétude les mouvements de jeunesse, qui auraient pu lui coûter son élection après les manifestations, à l’hiver 2006, contre le contrat première embauche (CPE) proposé alors par Dominique de Villepin. Elu président, M.Sarkozy avait vite fait machine arrière fin 2008 lors de la contestation des lycéens contre la réforme du ministre de l’éducation, Xavier Darcos.
Le plan pour la jeunesse suscite un soulagement tout relatif chez les financiers. Bercy se réjouit que des moyens de financement pour 2010 aient été trouvés, mais déplore qu’on ne supprime pas une ancienne allocation lorsqu’on en crée une nouvelle. Ce fut déjà le cas, en 2008, du RSA, qui ne fut pas financé comme prévu par la réduction de la prime pour l’emploi. Les financiers estiment que le poids des dépenses publiques, les plus élevées au monde devant la Suède, ne pourra être réduit qu’en s’attaquant aux transferts sociaux.
Seconde interrogation : ce nouveau plan envoie-t-il le mauvais message à la jeunesse ? Nicolas Sarkozy a voulu rassurer les députés UMP inquiets de voir la jeunesse assistée. « Mon intention n’est pas d’instaurer un RMI jeune », a déclaré M. Sarkozy. Les dirigeants de l’UMP se sont donné le mot pour relayer le propos présidentiel. Ils se rassurent en constatant que le RSA, qui a remplacé le RMI, ne sera pas généralisé, sans conditions, aux moins de 25 ans.
« Le grand totem à droite, c’est le RMI qu’on donne au jeune à 18 ans sans jamais avoir travaillé. Là, je suis rassuré », poursuit M. Copé. « Il faut soutenir l’idée de donner le RSA à ceux qui ont travaillé deux ans en CDD ou en intérim et sont les premières victimes du chômage et des licenciements », explique Pierre Méhaignerie, président UMP de la commission des affaires sociales de l’Assemblée, qui craignait qu’un RMI généralisé ne conduise à soutenir « l’oisiveté ».
Tant pis, en revanche, si un jeune travaille deux ans et reprend ensuite ses études en bénéficiant du RSA. « Si un jeune qui a commencé un travail, le plus souvent manuel, à 18 ans et reprend au bout de deux ans une formation, on ne peut pas le lui reprocher », tranche M. Méhaignerie.
Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, craint que la pression soit telle que les critères d’octroi du RSA ne finissent par être assouplis. Il prône donc l’emploi d’un autre nom que le RSA pour l’allocation allouée aux jeunes travailleurs. Nicolas Sarkozy et Martin Hirsch n’en veulent pas, refusant d’avoir un traitement spécifique pour la jeunesse, jugé discriminatoire. Ils ne veulent pas prendre le risque de créer un abcès de fixation comme le CPE.
Troisième interrogation, le plan jeunesse envoie-t-il un mauvais signal sur la politique de la famille ? C’est la crainte de M. Mariton, qui s’inquiète de l’expérimentation qui va être faite sur 8 000 jeunes en leur allouant une dotation d’autonomie de 3 000 euros par an sur deux ans, comme le réclame l’UNEF ou l’ont expérimenté certains pays d’Europe du Nord. Il faut pour cela que leurs parents renoncent à leur part d’allocations familiales ou de quotient familial. Cette somme, versée au mois le mois, serait débloquable pour des buts précis : recherche d’emploi, obtention du permis de conduire, paiement de caution.
Cette philosophie est en effet contestée par la droite traditionnelle. « Le premier lieu de la solidarité, c’est la famille et c’est seulement quand elle est défaillante qu’il y a aide publique », indique M. Mariton, qui revendique une vision « classique » de la famille par rapport à l’approche consumériste du président de la République, centrée sur les prestations. L’allocation autonomie remettrait en cause les piliers de la politique française que sont le quotient familial et les allocations familiales.
M. Hirsch défend quant à lui sa position : « Lorsque vous êtes issus d’une famille très modeste, vous avez des aides via les bourses ; lorsque votre famille est favorisée vous avez des aides gigantesques via le quotient familial, l’éducation gratuite, etc. En revanche, vous n’avez presque rien pour les familles moyennes », explique le haut-commissaire à la jeunesse. Il espère que ses expérimentations permettront de passer à un système plus progressif.
Des expérimentations dont se méfie Hervé Mariton, échaudé par le précédent du RSA. « Le RSA a été généralisé en deux temps trois mouvements parce que Martin Hirsch l’a exigé. L’expérimentation ne doit pas être le précurseur forcé de la généralisation. »
Les principales mesures annoncées
- Le RSA sera étendu aux moins de 25 ans, à condition qu’ils aient travaillé 3600 heures (l’équivalent de deux ans) au cours des trois dernières années. Les jeunes pourront en bénéficier s’ils sont devenus chômeurs ou s’ils ont réduit leur activité, après extinction de leurs droits aux Assedics. 160 000 d’entre eux sont concernés (coût : 250 millions d’euros).
- Le contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis) qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans menacés d’exclusion –actuellement de 900 euros par an – sera augmenté (80 millions d’euros). li>
- Un dixième mois de bourse sera versé aux étudiants scolarisés dans les universités ayant allongé à dix mois le cursus scolaire (150 millions d’euros).
- Complémentaire santé : l’aide aux étudiants sera doublée à 200 euros (30 millions d’euros) ;
- Les apprentis bénéficieront des droits attachés à la carte étudiant.
- Les entreprises privées pourront prérecruter des jeunes dont ils financent la formation.
- Les stages non associés à une formation seront interdits.
- Un service public de l’orientation sera mis en place.
- Un livret de compétence sera expérimenté pour valoriser l’extra-scolaire (activités associatives, culturelles, sportives).
- De 16 à 18 ans, un droit à préparer sa vie active sera créé, sous forme d’une formation ou d’un emploi. Ceux qui décrochent après 16 ans seront suivis.
- Le service civique volontaire concernera 10 000 jeunes en 2010. L’objectif est de parvenir à 10 % d’une classe d’âge.
- Une prémajorité à 16 ans permettra à un jeune d’être président ou trésorier d’une association ou de créer son entreprise.
- Trois types de dotations seront expérimentés : 8 000 jeunes de 18 à 25 ans, désireux de s’autonomiser, se verront attribuer 3000 euros pendant deux ans maximum pour financer certaines dépenses (formation…). Leurs parents devront renoncer aux allocations familiales. 8 000 jeunes de 18 à 25 ans en difficulté bénéficieront d’un revenu garanti d’environ 250 euros par mois s’ils signent un accord de formation ou acceptent un emploi. 6 000 jeunes de 16 à 18 ans bénéficieront d’une aide maximale de 2 500 euros s’ils reprennent une formation.
Source: Le Monde