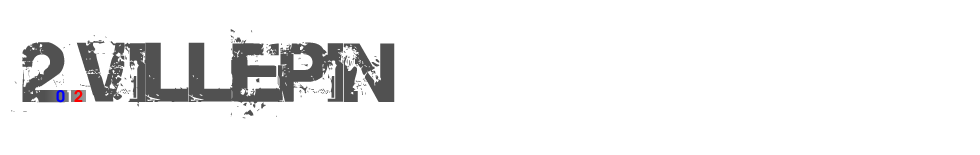L’ancien premier ministre Dominique de Villepin dit vouloir « offrir une alternative à la politique qui est menée » par Nicolas Sarkozy même s’il juge « prématuré » de dire s’il sera ou non candidat à la présidentielle de 2012, dans un entretien à paraître jeudi 3 septembre dans L’Express.
Retrouvez ici l’intégralité de son interview.
« Nicolas Sarkozy et moi avons des personnalités différentes, des motifs de désaccord importants comme sur l’Otan ou la politique sociale » même si « nous nous retrouvons sur la conviction que la France a besoin de réformes en profondeur, sur le goût de l’action et sur le souci des résultats », déclare-t-il.
« Fort de mon expérience, je veux offrir une alternative à la politique qui est menée. C’est dans cet esprit qu’a été créé, à l’initiative de l’ancienne ministre Brigitte Girardin, le Club Villepin, pour permettre à des personnes de tous les horizons de se retrouver autour d’une même ambition pour la France« , souligne M. de Villepin.
Interrogé sur une éventuelle candidature en 2012, il répond que « tout cela est prématuré » sans pour autant exclure quoi que ce soit. « Je suis résolument engagé au service de la France. J’ai la conviction que l’élection présidentielle marque un rendez-vous entre un homme et un peuple, au-delà des clivages partisans et des intérêts personnels ».
M. de Villepin accuse son rival de « fragiliser notre modèle républicain ». « Je suis frappé par la récurrence d’un raisonnement à la fois simplificateur et moralisateur, qui consiste à opposer en permanence les bons et les méchants et à faire de la stigmatisation et de la punition les axiomes de la vie publique ».
« C’est une vision où l’autre -le chômeur, l’immigré, le fonctionnaire, l’adolescent qui télécharge des films- est suspect a priori », dénonce-t-il.
« Le risque de notre système, c’est le déséquilibre. Il y a le président, peu de gouvernement, pas d’opposition organisée ni de contrepoids crédible. A cet égard, le rôle du Parlement est essentiel et les efforts de Jean-François Copé pour promouvoir les initiatives de la majorité parlementaire vont dans le bon sens. Nous avons besoin de garde-fous », insiste l’ancien Premier ministre.
Le texte de l’interview de Dominique de Villepin dans L’Express
L’Express: En quoi le verdict du procès Clearstream aura-t-il une influence sur la suite de votre carrière politique?
Dominique de Villepin: Je n’ai jamais mêlé la politique à cette échéance, et je n’ai cessé de dénoncer l’instrumentalisation politicienne de cette affaire.
Nicolas Sarkozy a défendu l’impartialité de la justice sur ce dossier, dans son interview au Nouvel Observateur en juin: « Deux juges dont l’indépendance d’esprit est notoire ont instruit l’affaire. Ils ont demandé l’avis du parquet. Le parquet pouvait dire non. Il a dit oui. Les juges pouvaient dire non. Ils ont dit oui. »
Cette déclaration ne correspond pas à la vérité de la procédure. En ce qui concerne mon rôle supposé, le parquet et les juges ne sont pas en phase. Mais, surtout, ce propos souligne à quel point nous sommes dans une situation inédite et malsaine. Garant de l’indépendance de la justice, le président de la République n’a pas à donner son opinion sur une affaire judiciaire en cours. A fortiori, il est inconcevable qu’il le fasse, directement ou indirectement, dans une affaire qui le concerne personnellement. Certes, le président est partie civile, mais ce n’est pas une partie civile comme les autres. Il pèse sur le dossier de tout son poids institutionnel : il a autorité sur le parquet, il appartient au Conseil supérieur de la magistrature et plusieurs de ses ministres sont témoins ou partie civile. L’un de ces témoins est même garde des Sceaux. Pour éviter la confusion des genres, il aurait dû faire preuve d’une grande retenue, alors que chacun sait qu’à l’Elysée ce dossier a bénéficié d’une attention toute particulière.
« Laissons faire la justice pour que plus jamais des officines ne puissent salir en toute impunité », ajoutait Nicolas Sarkozy. Vous sentez-vous visé? »
D’autant moins visé que je les ai toujours combattues.
Au printemps, vous déclariez: « Il y a un risque révolutionnaire en France. » Le climat social des derniers mois et le résultat des européennes ne vous ont-ils pas démenti?
Le climat social est loin d’être apaisé, les nombreux conflits le montrent. Une détérioration est d’autant plus à craindre que nous allons faire face à une nouvelle hausse du chômage. Nous devons rester vigilants, y compris sur la crise financière. L’économie mondiale est aujourd’hui sous perfusion des gouvernements et des banques centrales. La guérison n’est pas acquise pour autant, car des incertitudes demeurent : encours de cartes de crédit aux Etats-Unis, risque de bulles spéculatives en Chine ou, chez nous, baisse accentuée de l’investissement.
De même, ne sous-estimons pas le malaise français, qui touche à la fois la politique, la société et l’Etat. La confusion est aggravée par les dérives de l’hyperprésidence, où une réforme chasse l’autre, dans l’urgence et sous le coup de l’émotion. Mais avec quelle vision d’ensemble et pour quels résultats ? Ainsi, on a raison de poser la question des bonus, mais ne négligeons pas les deux questions centrales de la répartition des richesses, entre le capital et le travail, et la panne du crédit aux entreprises comme aux particuliers.
Vous évoquez des « dérives ». Des exemples?
Ce qui m’inquiète, c’est la fragilisation de notre modèle républicain. Notre idéal d’une république fraternelle, unie et indivisible ne doit pas céder la place à un système politique fondé sur les divisions, les rapports de force et les intérêts particuliers. Je suis frappé par la récurrence d’un raisonnement à la fois simplificateur et moralisateur, qui consiste à opposer en permanence les bons et les méchants et à faire de la stigmatisation et de la punition les axiomes de la vie publique. C’est une vision où l’autre – le chômeur, l’immigré, le fonctionnaire, l’adolescent qui télécharge des films – est suspect a priori.
Quelles répercussions voyez-vous sur la société française?
Cette suspicion crée des fractures profondes et sans doute durables en son sein. Face aux injustices entre individus et entre générations, on oscille entre révolte et indifférence, au profit d’un sauve-qui-peut individuel. Or nous avons besoin d’une morale collective et d’un partage équitable. Quand Nicolas Sarkozy préconisait son « Travailler plus pour gagner plus », il négligeait ces exigences. Le défi, désormais, est davantage de travailler tous pour vivre mieux.
En quoi mèneriez-vous une politique différente de celle de Nicolas Sarkozy?
Si l’on prend un peu de recul, on s’aperçoit qu’il existe des convergences entre la politique que j’ai menée de 2005 à 2007 et celle conduite par Nicolas Sarkozy, que ce soit en matière d’innovation, de compétitivité ou de mobilisation en faveur de l’industrie. Mais ce qui manque aujourd’hui, ce sont des lignes directrices claires. Quelles sont les priorités de l’action gouvernementale en matière économique et sociale? Elles ne sont pas lisibles. Or, il appartient au président de proposer une vision et de dégager les grandes orientations.
Pour ma part, je vois deux grands chantiers à mener. Le premier, c’est celui de la réforme de l’Etat, qui vit un profond malaise. Je crois qu’il faut une réforme globale de nos administrations, qui traite non seulement la question des collectivités locales, mais aussi celle des missions de l’Etat central et celle de la fonction publique.
Le second chantier, c’est celui du financement de notre protection sociale. La crise a démontré son immense utilité. Basculons sur l’ensemble des revenus les charges qui pèsent sur les seuls salaires. Démontons la machine à exclure qui affecte particulièrement les jeunes et les seniors.
Etat et Sécurité sociale sont deux piliers de notre modèle. Il est, pour moi, essentiel de les moderniser, pour répondre aux deux défis maj
eurs que sont la compétitivité et l’emploi. Appuyons-nous sur des principes forts de responsabilité et de justice, ce qui justifie de répartir plus justement les efforts face à la crise. Je propose de créer une nouvelle tranche de l’impôt sur le revenu, à 45%, et de suspendre le bouclier fiscal.
Les institutions, qui ont évolué dans la pratique comme dans les textes, fonctionnent-elles aujourd’hui mieux qu’hier?
Nicolas Sarkozy a incontestablement répondu à une demande forte des Français, qui veulent savoir qui décide et qui conduit le pays, spécialement dans un temps de crise aiguë. Mais le risque de notre système, c’est le déséquilibre. Il y a le président, peu de gouvernement, pas d’opposition organisée, ni de contrepoids crédible.
A cet égard, le rôle du Parlement est essentiel et les efforts de Jean-François Copé pour promouvoir les initiatives de la majorité parlementaire vont dans le bon sens. Nous avons besoin de garde-fous. Or, tout repose sur la vertu du président lui-même. Les prédécesseurs de Nicolas Sarkozy avaient une conception de leur fonction qui les conduisait à se fixer des limites, prenant en compte l’exigence de sérénité, le rôle d’arbitre, la possibilité d’un recours. Protégeons les dirigeants contre eux-mêmes, en encadrant mieux les pouvoirs.
Enfin, le débat doit être élargi à toutes les forces de la société pour promouvoir le bien public. Le Grenelle de l’environnement, par exemple, est une idée venue de la société civile. Ni le président, ni l’Etat ne sont désormais capables de définir seuls l’intérêt général.
Sur l’environnement, avant le sommet de Copenhague, comme sur la crise financière avant le sommet de Pittsburgh, Nicolas Sarkozy veut que la France s’érige en modèle pour les autres pays. Approuvez-vous sa stratégie?
Que la France doive avoir un rôle d’initiative, j’en suis convaincu. Nous avons besoin d’entraîner, ce qui suppose un effort constant d’explication, de pédagogie et de concertation, en particulier avec nos principaux partenaires européens, à commencer par l’Allemagne. L’exigence d’efficacité commande d’éviter l’isolement ou la rupture.
En quoi l’élection de Barack Obama change-t-elle la donne internationale?
Barack Obama représente une chance et une opportunité pour la communauté internationale. Il faut qu’il réussisse. Je souhaite un leadership européen capable de l’épauler sur le dossier du climat, dans la recherche de la paix au Proche-Orient ou face à la situation en Iran. Et, en Irak, si l’on veut éviter la guerre civile, l’Europe doit avoir une diplomatie plus audacieuse, en mobilisant davantage tous les pays de la région.
Les Etats-Unis ont-ils raison de renforcer leur présence militaire en Afghanistan?
La politique américaine en Afghanistan est dans l’impasse, et nous n’avons pas suffisamment joué notre rôle en renonçant à une révision stratégique profonde. J’avais insisté auprès de Jacques Chirac, avant la fin de sa présidence, pour que nous amorcions un désengagement de nos troupes, en particulier des Forces spéciales. Il faut d’urgence envoyer un signal fort: une stratégie de coopération économique et sociale ambitieuse sur le terrain, assortie d’un calendrier de retrait pour montrer que notre visée n’est pas militaire. Tirons les leçons de l’Histoire et refusons les oeillères idéologiques qui font le jeu des extrémistes.
La France a-t-elle raison de parler avec la Syrie?
Je suis favorable à un dialogue avec Damas, à condition qu’il soit exigeant. Voyez comme nous avons manqué de lucidité vis-à-vis de la Libye.
Lors du Conseil des ministres du 29 juillet, Nicolas Sarkozy a évoqué, à propos de la promotion de Bruno Le Maire à l’Agriculture ou de la prolongation du mandat de Pierre Mongin à la présidence de la RATP, l’ »ouverture aux villepinistes », soulignant: « Ils ont été tous les deux directeurs de cabinet de Dominique de Villepin, qui me vomit dessus à longueur de temps dans la presse. » Serait-il plus tolérant que vous?
J’ai du mal à croire que de tels propos puissent être tenus en Conseil des ministres, même si je me réjouis que soit saluée la qualité de mes proches et, notamment, de Bruno Le Maire, qui fait un remarquable travail au gouvernement.
Au-delà des hommes, ce qui m’importe, c’est l’ouverture aux idées et la définition d’un projet d’envergure, dans un souci d’efficacité et de justice sociale. Nicolas Sarkozy et moi avons des personnalités différentes, des motifs de désaccord importants comme sur l’Otan ou la politique sociale, mais nous nous retrouvons sur la conviction que la France a besoin de réformes en profondeur, sur le goût de l’action et sur le souci des résultats.
Il y a là des choses importantes qui nous rapprochent et je me réjouis quand la France est en initiative, comme pendant la présidence française de l’Union européenne. Il est important, au sein d’une famille, de préserver la réflexion, le débat et la proposition. Toute réforme suppose un patient travail d’explication pour rassembler et lever les peurs. Fort de mon expérience, je veux offrir une alternative à la politique qui est menée. C’est dans cet esprit qu’a été créé, à l’initiative de l’ancienne ministre Brigitte Girardin, le Club Villepin, pour permettre à des personnes de tous les horizons de se retrouver autour d’une même ambition pour la France.
Qu’est-ce qui vous incitera à être, ou pas, candidat à la présidentielle de 2012?
Tout cela est prématuré. Je suis résolument engagé au service de la France. J’ai la conviction que l’élection présidentielle marque un rendez-vous entre un homme et un peuple, au-delà des clivages partisans et des intérêts personnels.
Sources: Agence France Presse et L’Express