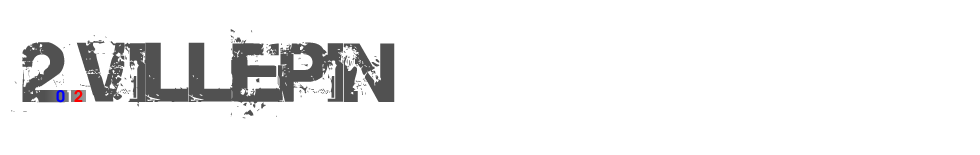Cet été, chaque samedi, retrouvez sur ce blog un extrait de La cité des hommes. Aujourd’hui: Le cercle vertueux
Aujourd’hui, nous bénéficions d’une conjoncture favorable. Il existe, avec l’élection de Barack Obama, un désir de renouveau et de dialogue. La tempête financière et économique impose de son côté la recherche de solutions communes et de responsabilités mieux partagées. Le multilatéralisme devient la norme. Bien sûr, cela signifie la hiérarchisation des choix et la capacité à tenir le cap.
Il faut établir un calendrier pour sortir de l’ornière. Un plan d’action efficace devrait se concentrer sur les crises dont la résolution serait bénéfique à la stabilité mondiale. En tête de liste, la crise israélo-palestinienne qui tourmente le Moyen-Orient et discrédite depuis longtemps l’action internationale dans le monde; de même, le conflit du Sahara occidental qui s’enracine depuis plusieurs décennies et forme une base arrière aux violences extrémistes, empêchant la pacification du Maghreb; enfin la crise afghano-pakistanaise qui gangrène l’ensemble de la région.
Ces crises présentent des similitudes. Elles offrent aussi des amorces de solutions communes. D’abord, éviter tout abcès de fixation lié à la présences de puissances étrangère, en dehors d’une stratégie et d’un calendrier soigneusement fixés. Ensuite, mettre en oeuvre un processus intérieur de dialogue et de rassemblement de toutes les forces de stabilité puis créer une dynamique régionale dans l’intérêt de tous; enfin, définir un effort économique et social de grande ampleur pour favoriser le développement. La prise en compte de ces crises dans l’urgence du cas par cas, par cloisonnements étanches et successifs, ne mène nulle part. Il faut restaurer une vision d’ensemble au service d’un nouvel ordre international. (…)
Ainsi, le conflit israélo-palestinien reste la clé de voûte de la paix au Moyen-Orient. Il est un exemple tout à la fois des blocages et des opportunités actuelles. Les grandes lignes directrices pour sortir de cette crise sont connues. Non pas une politique de petits pas, car celle-ci a échoué, mais une politique de pas résolus, c’est-à-dire volontariste dans l’immédiat, visionnaire à long terme. Elle passe par la coexistence de deux Etats viables, obligeant à des concessions douloureuses de part et d’autre.
Le conflit dans la bande de Gaza, qui a commencé en décembre 2008, a été l’illustration de la spirale des violences qui tire la situation vers le bas depuis les débuts de la deuxième Intifada. Il illustre le fait qu’il n’y a pas de paix sans partenaires et pas de négociations sans intermédiaires. Certes, en raison des luttes fratricides entre Fatah et Hamas, il manque un interlocuteur solide chez les Palestiniens. Mais peut-on reprocher aux Palestiniens de ne pas disposer d’un gouvernement capable d’assumer des pourparlers de paix? Ils n’en ont plus les moyens, vivant au jour le jour, dans un désespoir grandissant, dans des espaces confinés et cloisonnés à l’extrême. Il manque aussi, chez les Israéliens, une direction politique capable d’assumer la paix, en raison d’un système politique bloqué par le vote à la proportionnelle, la surenchère communautaire et la radicalisation nationaliste ou religieuse. Il n’y a eu d’avancées sur le chemin de la paix qu’avec des personnalités fortes – faucons devenus colombes par réalisme comme Yitzhak Rabin puis Ariel Sharon.
Aussi compréhensible soit-elle, la logique israélienne de garanties de sécurité comme préalables aux concessions territoriales ne paraît pas offrir d’issue. Seule la médiation peut permettre l’enclenchement d’une spirale ascendante, menant par degrés à un accord. Cette médiation nécessite bien sûr la participation des Etats-Unis, mais les Européens ont un rôle à jouer s’ils parlent d’une seule voix. Les médiateurs doivent d’abord accompagner le dialogue et apporter leur garantie et leur soutien matériel en cas d’accords. Ils doivent ensuite s’impliquer économiquement pour permettre une reconstruction réelle de l’Etat palestinien, ce qui suppose plus que la seulle manne européenne qui semble parfois destinée à compenser l’aveu d’impuissance. Enfin, le règlement du conflit implique un dialogue régional, incluant à la fois les Etats modérés comme l’Egypte et des pays comme la Syrie et l’Iran.
Le profit à en tirer à l’échelle mondiale serait immédiat. L’attente, dans une grande partie du tiers-monde, à l’égard d’un règlement israélo-palestinien, est immense tant le conflit en est venu à symboliser le double langage occidental, la loi du plus fort supplantant le droit international. L’apaisement au Moyen-Orient en serait facilité. Le cercle vertueux s’élargirait progressivement, dans le temps et dans l’espace. Cela s’appliquerait dans un Irak conflictuel tel qu’il ressortira très certainement du retrait américain, car les antagonismes chiites, sunnites et kurdes ont été avivés. Il n’y a pas d’autre moyen de parvenir à un équilibre régional, également conditionné par la menace de prolifération nucléaire. L’abcès de fixation israélo-palestinien et son extension libanaise ont trop longtemps distordu les lignes de force au profit de la surenchère.
Il reste que, pour l’heure, tout paraît bloqué au Proche-Orient où la droite dure israélienne et les radicaux du Hamas semblent se rejoindre pour abandonner la solution de deux Etats, israélien et palestinien, vivant en paix, côte à côte. Chacun, donnant libre cours à ses arrière-pensées et son idéologie, ne veut retenir que la possibilité d’un seul Etat. Inacceptable pour la communauté internationale, cette perspective n’est pas sans danger pour Israël qui devra à terme faire face, d’une manière ou d’une autre, aux déséquilibres démographiques entre Israéliens et Palestiniens. A défaut donc d’un déblocage de ce qu’il est convenu d’appeler la « mère des crises », il faut s’atteler sans attendre à conforter toutes les avancées possibles sur deux autres fronts tout aussi centraux.
Celui de l’Iran. Il faut revenir à une situation réaliste, c’est-à-dire intégrant Téhéran comme composante à part entière de la région mais en tenant compte des grandes lignes de fracture historiques entre le monde arabe et le monde perse, entre sunnites et chiites. Un accord sur le nucléaire iranien, repoussant la perspective d’une intervention armée, ne manquerait pas d’avoir des retombées bénéfiques collatérales en Syrie, en Irak, en Afghanistan, et même dans l’ensemble du Proche-Orient. Un échec, en revanche, enclencherait le cercle vicieux de la prolifération, pouvant encourager alors des vocations en Egypte, en Turquie, en Arabie Saoudite ou dans les Etats du Golfe.
Celui du Pakistan également. En effet, la situation de ce pays est celle d’un Etat quasi failli, proche de celle de l’Afghanistan, présentant un double risque: terroriste en liaison avec l’islamisme radical, mais aussi militaire, qui ne permet plus d’exclure un affrontement nucléaire avec l’Inde. La rivalité entre ces deux Etats est ancienne mais l’exacerbation croissante des tensions entre les deux peuples a atteint un point culminant avec les récents attentats de Mumbaï.
Islamabad, Téhéran et Jérusalem, telles sont bien, aujourd’hui, les trois portes d’entrée de la guerre ou de la paix pour le monde.
La cité des hommes – Dominique de Villepin – Plon – En vente dans toutes les librairies