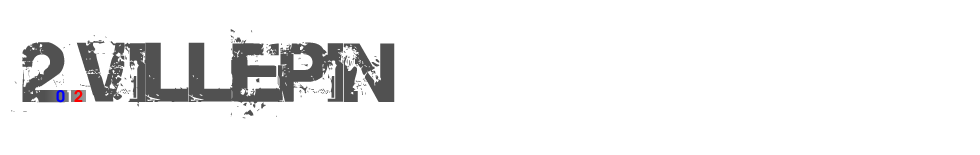Cet été, chaque samedi, retrouvez sur ce blog un extrait de La cité des hommes. Aujourd’hui: La revanche de l’histoire
L’histoire est de retour. Nous sommes à l’aube d’une de ces grandes crises qui façonnent depuis toujours la condition des hommes. On l’avait dite assoupie et épuisée il y a moins de vingt ans, appelée à prospérer dans la bonace, alors que les tempêtes guettaient à peu de distance. Il y eut d’abord 2001 et le bouleversement des attentats du 11 Septembre. Puis 2003, et l’enlisement de l’Amérique dans une logique de force. Enfin, l’été 2008 et ses déflagrations multiples, de la guerre en Géorgie à la faillite de Lehman Brothers.
Les menaces s’accumulent. Le précédent de 1929 hante tous les esprits: une spéculation boursière aggravée par un recours excessif au levier financier, puis une catastrophe économique dans laquelle, de proche en proche, un effondrement bancaire entraîne une crise de crédit, celle-ci engendrant à son tour une récession industrielle. Demande et production s’engagent dans une spirale dépressive. Les Etats succombent aux pièges du protectionnisme, des dévaluations compétitives et des politiques aux effets déflationnistes. En 1932, le revenu national américain a diminué de moitié par rapport à ce qu’il était à la veille du krach. Les ressemblances sont réelles: la même brutalité d’une crise, au fond inéluctable, le même appel à la restauration de la morale, la même tentation du repli, le même risque d’abandon de certains pays fragiles.
Aujourd’hui comme hier, il est illusoire de croire à un découplage de l’economique et du politique. La crise de 1929, faut-il le rappeler, a favorisé la prolifération des nationalismes et l’avènement du nazisme. La crise économique souffle, dans un cas comme dans l’autre, sur les braises d’un système international déséquilibré et incertain, ici l’unipolarité américaine après la guerre froide, là les frustrations du traité de Versailles à l’issue de la Première Guerre Mondiale.
D’ailleurs, 1929 n’est pas le seul exemple: toutes les crises économiques majeures charrient leur lot de conflits internationaux et d’instabilités politiques nationales. (…)
Au tournant du XXIème siècle, d’autres menaces existent: un Moyen-Orient plus dangereux que jamais, une rupture possible de la construction européenne ou encore un raidissement nationaliste de la Chine.
Enfin, les crises parachèvent des mouvements de fond déjà amorcés de longue date. La dépression de la fin du XIXème siècle a accéléré la montée en puissance des nouveaux pays industrialisés: Etats-Unis, Allemagne, Japon. 1929 a entériné le déclin européen et préparé la bipolarisation entre Russes et Américains. Aujourd’hui, l’ascension des pays émergents, Chine et Inde surtout, mais aussi, avec quelques bémols, Russie, Brésil et Mexique semblent inéluctable. Peut-être seront-ils plus secoués que d’autres car ils demeurent fragiles. Néanmoins, ils devraient sortir renforcés de l’épreuve. Une nouvelle hiérarchie économique et de nouvelles règles de la compétition se mettent en place.
Il faut exercer notre regard à saisir toutes les promesses de ces transformations. Chaque crise a ses vertus, à commencer par l’obligation de nous remettre en question. Elle nous donne l’occasion de nous débarasser des habitudes acquises, des facilités de l’indignation et de l’assèchement du sens critique. Rares sont les drames dont les hommes ne soient sortis plus déterminés à assurer leur prospérité et à garantir la paix. La sortie de l’enfer de la Seconde Guerre mondiale , engendrée par la dépression des années trente, a conduit au renouveau. La victoire a permis la refondation du pacte démocratique, avec de nouvelles constitutions plus audacieuses et plus équilibrées. Elle a légitimé la construction collective de l’Etat providence inspiré par Beveridge comme par le programme du Conseil national de la Résistance pour la France libre, à l’origine de l’ordonnance de la Sécurité sociale de 1944. Elle a instauré le compromis fordien des Trente Glorieuses, lorsque les gains de productivité et les hausses de salaire créaient les conditions de la demande accrue d’une société de consommation. Enfin, elle a jeté les bases d’une tentative inouïe de sécurité collective dans le cadre des Nations unies, dans le droit fil de l’idéalisme de la charte de l’Atlantique signée le 14 août 1941. (…)
Il faut se garder de deux écueils. La célébration béate des vertus de la crise, car le renouveau naît de douleurs humaines que nul ne peut oublier. La démesure prophétique, car la tentation est toujours grande de voir se dessiner la fin du monde dans les brumes des grandes faillites. Les écrits économiques et politiques des années trentes fourmillent de « crépuscules » ou de « fins » du capitalisme qui, avec près d’un siècle de recul, paraissent excessifs. La reconstruction nécessaire repose sur la capacité au réalisme dans les constats autant que dans les objectifs. Elle exige, pour être menée à bien, une vision et des bras. Elle est l’affaire des citoyens et de leur volonté, pour édifier une cité-monde qui soit enfin une cité des hommes.
La cité des hommes – Dominique de Villepin – Plon – En vente dans toutes les librairies