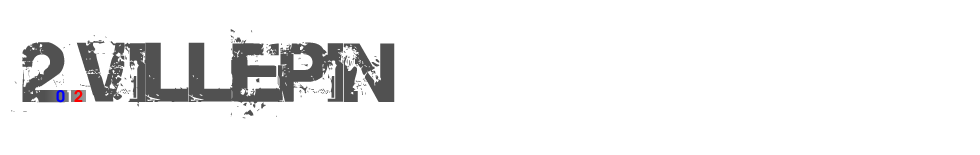Après huit années d’administration Bush, l’Amérique semble… fatiguée. Et les Américains aspirent à un profond renouvellement. La présidence de George W. Bush a-t-elle été la pire de l’histoire américaine? Certains s’interrogent alors que le républicain atteint des records d’impopularité.
Retour sur deux mandatures marquées par la lutte contre le terrorisme et la récession économique.
Les Américains n’ont pas le moral. Crise des « subprimes », récession, pétrole, couverture maladie, impasses des guerres en Irak et en Afghanistan… la liste est longue.
Des historiens américains s’interrogent déjà pour savoir si la présidence de George W. Bush a été la pire de l’histoire des Etats-Unis. La réponse est positive, si l’on en croit les dernières études. Selon un sondage publié le 1er mai par CNN, 71% des Américains désapprouvent sa conduite des affaires, un chiffre qui en fait « le président le plus impopulaire de l’histoire moderne » des Etats-Unis. Ni Richard Nixon, ni Harry Truman, pourtant très impopulaires, n’avaient franchi le seuil de 70% de mécontents. « Il faut peut être remonter à 1923 et Warren G. Harding, un président alcoolique, joueur de poker et corrompu, pour trouver un mandat aussi catastrophique », résume Pap Ndiaye, maître de conférence à l’EHESS, dans le Géo du mois d’octobre.
Qu’ils choisissent McCain ou Obama le 4 novembre, les électeurs américains auront surtout une envie: tourner la page. En attendant, l’heure est au bilan. Economique d’abord, car sujet central de cette fin de mandature. Ce n’est pas très glorieux. A sa décharge, George W. Bush ne peut être tenu pour responsable de la récession qui s’est invitée au début de son premier mandat – éclatement de la bulle internet – et à la fin de son second – crise des « subprimes ». A l’inverse, son prédécesseur, Bill Clinton, avait pris les rênes de l’Amérique à l’aube d’un nouveau cycle économique.
L’Amérique en crise
Mais pour la plupart des économistes, George W. Bush a aggravé la tendance. En choisissant de diminuer les impôts des plus riches, d’abord. En souhaitant faire des Etats-Unis une « nation de propriétaires », ensuite. Conséquence: les banques ont massivement prêté de l’argent à des ménages non solvables, situation qui a conduit tout droit à la crise des « subprimes » et à de nombreuses expulsions.
La bonne croissance des années 2001 à 2007 s’accompagne d’un renforcement des inégalités sociales. Un revers pour celui qui, durant la campagne de 2000, défendait son « compassionate conservatism ».
Si on devait retenir un chiffre de ces huit années, ce serait celui du budget fédéral américain: quand Bush a pris le pouvoir, il était excédentaire de 236 milliards de dollars, il sera déficitaire en 2009 de 490 milliards.
Un mauvais résultat notamment expliqué par le poids de la guerre en Irak dans le budget. Selon le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz l’intervention américaine devrait coûter au moins trois mille milliards de dollars.
Le premier mandat de George W. Bush s’ouvre pourtant sur une vraie tentation isolationniste. Mais l’Amérique désireuse d’échapper au désordre mondial se fait surprendre par les attentats du 11 septembre 2001. Le 13, George W. Bush désigne Oussama Ben Laden comme le commanditaire des attaques et promet de « mener le monde à la victoire » contre Al-Qaïda.
S’en suivront le déclenchement de la guerre en Afghanistan puis les Patriot Act I et II, qui limitent les libertés individuelles et renforcent le pouvoir des autorités.
L’Amérique contre le terrorisme
Puis, la victoire militaire rapidement acquise en Afghanistan, vint le temps de la préoccupation irakienne, qui n’a plus jamais quitté le devant de la scène. Et le passage de la « guerre préventive » – pour prévenir un danger imminent – à celui de la « guerre préemptive » – la guerre avant même que la menace existe. George W. Bush dresse la liste des « Etats voyous » – Iran, Irak et la Corée du Nord en 2002, accusés de soutenir le terrorisme et de vouloir se procurer des armes de destruction massive. Des ADM rendues tristement célèbres par le secrétaire d’Etat Colin Powell, qui, devant le Conseil de sécurité des Nations unies le 5 février 2003, présente des preuves – qu’on sait aujourd’hui fausses – de la présence de ces armes en Irak. La machine est lancée.
Le 20 mars 2003, les Etats-Unis, soutenus par plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, envahissent l’Irak. Comme en Afghanistan, la victoire militaire est rapidement acquise et Saddam Hussein fait prisonnier. L’Amérique a-t-elle gagné sa guerre contre le terrorisme? Les réalités afghane et irakienne viennent lui rappeler qu’il n’en est rien. L’opinion américaine, elle, a depuis changé d’avis et réclame majoritairement le retour de ses soldats.
Dans le reste du monde, les mandats de George W. Bush sont marqués par un désengagement dans le processus de paix au Proche-Orient et une relation de méfiance avec l’Europe. Pour preuve, le président américain effectue sa première visite au Moyen-Orient en janvier 2008! En novembre de la même année, il tente – tardivement – de relancer les négociations, en organisant une conférence internationale à Annapolis, restée depuis sans effet.
Avec l’Iran, Bush a toujours prôné la fermeté, refusant de négocier avec le président Ahmadinejad tant que son pays poursuivrait ses activités d’enrichissement d’uranium. Une politique qui a conduit au statu quo: le Conseil de sécurité multiplie les trains de sanctions à l’égard de la République islamique qui, elle, réaffirme sans cesse son droit au nucléaire civil.
Quant à l’Europe, les relations se tendent avec la guerre en Irak. En la matière, Condoleezza Rice conseille de « punir la France, ignorer l’Allemagne et pardonner à la Russie ». Un pardon que la crise en Géorgie a balayé: Washington n’a pas hésité à dénoncer les agissements d’une Russie impérialiste. Côté français, l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy a entraîné un dégel.
Autant de dossiers brûlants et non réglés que George W. Bush laisse à son successeur. Qu’il soit Barack Obama ou John McCain, le 44e président aura fort à faire.
Source: Marianne Enault (Le Journal du Dimanche)