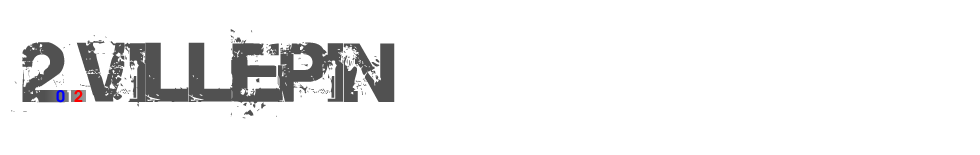C’est dans un contexte tendu que le conseil des ministres examinait, lundi dernier, le projet de loi pénitentiaire.
Le nombre des détenus dans les 200 prisons françaises vient en effet d’atteindre un nouveau record en juillet 2008. Plus de 64.000 personnes sont incarcérées, dont près de 17.600 prévenus non encore jugés.
Ce retour à l’inflation carcérale repose sur divers facteurs liés au renforcement de la politique sécuritaire, notamment la loi sur la récidive et la mise à exécution des courtes peines. Actuellement, 40 % des condamnés purgent une peine de moins d’un an et 29 % une peine de 5 ans et plus. Par ailleurs, les condamnés à des longues peines (20 à 30 ans) sont de plus en plus nombreux.
Près des deux tiers (63 %) des établissements pénitentiaires sont en surpopulation (126 personnes pour 100 places en moyenne) et, parmi eux, 7 % affichent une densité de 200 % avec en moyenne deux détenus pour une place. Ce taux est largement au-dessus de la moyenne des États-membres du Conseil de l’Europe (102 %).
Les prévenus en attente de leur jugement et les condamnés à de courtes peines sont les plus touchés par le surpeuplement. Depuis 2007, la grâce collective du 14 Juillet n’est plus appliquée. La Constitution prévoit désormais que le Président peut accorder un droit de grâce à titre individuel.
Réussir la réinsertion des détenus
L’un des grands axes du projet, calqué sur la réglementation européenne, est de « réussir la réinsertion » des détenus dont les droits vont être renforcés, notamment le droit au travail. Actuellement, 60 % des arrivants en détention sont sans activité ou au chômage, 60 % de la population pénale est sans diplôme et 25 % des détenus sont illettrés.
La loi prévoit qu’un engagement professionnel sera signé entre le chef d’établissement et le détenu, précisant ses droits et obligations. Les entreprises d’insertion pourront également faire travailler les détenus et faciliter leur accès au marché du travail à la sortie de prison. En 2007, 38 % d’entre eux ont exercé une activité rémunérée et perçu entre 350 et 500 euros nets mensuels en moyenne.
Développement des alternatives à l’incarcération
Autre mesure phare du projet, visant à lutter contre la récidive, le développement des alternatives à l’incarcération et des possibilités d’aménagement de peines.
Les prévenus (personnes en attente d’un jugement) qui encourent une peine d’au moins deux ans de prison peuvent, au lieu d’exécuter leur détention provisoire derrière les murs, être « assignés à résidence » (port d’un bracelet électronique fixe ou mobile) pendant une durée de 6 mois, renouvelable plusieurs fois (3 fois si la détention provisoire dure 2 ans). Si la personne est ensuite condamnée, la durée de l’assignation à résidence sera déduite de la durée de sa peine.
Par ailleurs, les possibilités d’aménagements de peines (semi-liberté, bracelet électronique…) concerneront non seulement les condamnés à des peines d’un an (ce qui est le cas aujourd’hui) mais aussi les condamnés à des peines allant jusqu’à deux ans, ce qui concerne 90 % des personnes condamnées.
Pour les peines inférieures à six mois et dans les cas où il ne reste que quatre mois à exécuter, le placement sous surveillance électronique devra être ordonné, sauf en cas de refus du condamné ou de risque de récidive.
Actuellement, un peu plus de 3.200 condamnés exécutent leur peine avec un bracelet électronique fixe.
Source: Laurence Neuer (Le Point)