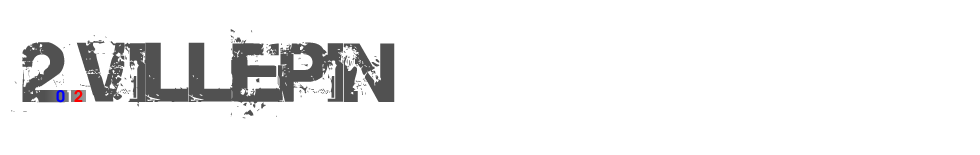Lancée en grande pompe sous le signe de la paix, l’Union pour la Méditerranée doit encore régler de nombreuses questions-clé de fonctionnement et démontrer qu’elle peut répondre aux défis d’une région aux écarts économiques considérables et aux profondes divisions politiques.
« Nous en avions rêvé, l’Union pour la Méditerranée est maintenant une réalité », s’est félicité dimanche le président français Nicolas Sarkozy, hôte du sommet qui a réuni 43 pays, tout en reconnaissant qu’il y a encore « beaucoup de travail ».
Son ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner a salué un « événement magnifique ». Mais il a déploré que la rivalité israélo-palestinienne, qui a déjà plombé ces dernières années la coopération euro-méditerranée, ait provoqué un « blocage de dernière minute » dans la rédaction de la déclaration finale.
Les questions institutionnelles devraient occuper une bonne part des travaux de mise en place de l’UPM dans les prochains mois.
Le choix d’un site pour le secrétariat général, que se disputent le Maroc, la Tunisie, Malte et l’Espagne, reste à régler. Les ministres des Affaires étrangères de l’UPM doivent se retrouver en novembre pour tenter de résoudre ce point.
La question du financement des projets régionaux destinés à donner un contenu concret à l’UPM (environnement, transports, protection civile etc.) n’est pas non plus verrouillée.
M. Kouchner a reconnu que pour faire avancer l’UPM « il faudra trouver des idées et des moyens » et promis que « toutes les voies seront explorées ». Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a toutefois estimé que la dynamique créée par l’UPM allait aider à dégager des « ressources additionnelles ».
Reste également à démontrer que le lancement de projets de coopération ciblée suffira à combler l’immense écart de développement de cette région, où le revenu moyen par habitant est de 26.000 dollars au nord, contre 7.000 dollars par an au sud.
Le président égyptien Hosni Moubarak a souligné dimanche que la population des pays du sud méditerranéen allait augmenter de 100 millions de personnes d’ici 2030. Un défi de taille pour une Europe à la démographie poussive, confrontée à une forte pression migratoire venue du sud.
L’UPM risque aussi de se heurter aux mêmes écueils que le processus de Barcelone, lancé en 1995 pour tenter de relancer la politique méditerranéenne de l’UE, victime notamment des tensions israélo-arabes.
La querelle de fin de sommet entre Israéliens et Palestiniens sur la dénomination « d’Etat national » pour qualifier Israël a une nouvelle fois montré la difficulté de traduire en pratique les envolées sur les espoirs de paix.
A Beyrouth, le quotidien As-Safir a estimé que « le rêve de Sarkozy pourrait connaître le même sort » que « la Déclaration de Barcelone qui a achoppé sur le conflit arabo-israélien ».
Antoine Basbous, directeur de l’Observatoire des pays arabes, souligne quant à lui que l’UE reste comme avant confrontée à la difficulté de travailler avec une rive sud minée par ses rivalités internes, dominée par « des dirigeants plus soucieux de sanctuariser leurs régimes que de développer leurs pays ».
L’UPM pourrait encore pâtir de la volonté affichée de certains pays européens de renforcer la coopération avec l’Europe de l’est et caucasienne.
Les principaux points de l’acte de naissance de l’Union Pour la Méditerrannée
Voici les principaux points de la déclaration commune des 43 dirigeants présents au sommet de lancement de l’Union pour la Méditerranée destinée à « bâtir ensemble un avenir de paix et de démocratie », dans leur déclaration commune. Le passage sur le processus de paix israélo-palestinien a donné lieu à d’intenses tractations jusqu’à la clôture du sommet.
Armes de destruction massive: « Les parties s’emploient à établir, au Proche-Orient, une zone exempte d’armes de destruction massive, nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, qui soit dotée d’un système de vérification mutuelle efficace ». Elles « s’abstiendront de développer une capacité militaire qui aille au-delà de leurs besoins légitimes de défense ». Les parties « favoriseront les conditions susceptibles de permettre l’établissement de relations de bon voisinage entre elles et soutiendront les processus visant la stabilité, la sécurité et la prospérité ».
Démocratie et droits de l’homme: « Les chefs d’Etat et de gouvernement soulignent qu’ils sont déterminés à renforcer la démocratie et le pluralisme politique par le développement de la participation à la vie politique et l’adhésion à l’ensemble des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».
Processus de paix israelo-palestinien: « Les chefs d’Etat ou de gouvernement réaffirment leur soutien au processus de paix israélo-palestinien, comme mentionné lors de la réunion ministérielle euro-méditerranéenne tenue à Lisbonne en novembre 2007, et conformément au processus d’Annapolis ». « Ils rappellent que la paix au Proche-Orient requiert une solution globale et se réjouissent, à ce égard, de l’annonce selon laquelle la Syrie et Israël ont engagé des pourparlers de paix indirects sous les auspices de la Turquie ».
Terrorisme: Les parties « réaffirment leur condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, ainsi que leur détermination à l’éradiquer et à lutter contre ceux qui le soutiennent ». « Ils confirment qu’ils sont résolus à tout mettre en œuvre pour résoudre les conflits, mettre fin aux occupations, lutter contre l’oppression, réduire la pauvreté, promouvoir les droits de l’homme et la bonne gestion des affaires publiques, améliorer la compréhension interculturelle et garantir le respect de toutes les religions et croyances ».
Processus de Barcelone: « Les chefs d’Etat et de gouvernement soulignent l’importance du rôle joué depuis 1995 par le processus de Barcelone, qui constitue l’instrument central des relations euro-méditerranéennes ». « Afin de tirer parti des possibilités offertes par un cadre renforcé de coopération multilatérale, les chefs d’Etat ou de gouvernement décident de lancer un partenariat renforcé – le processus de Barcelone, une Union pour la Méditerranée ».
Les six « projets régionaux concrets »: L’UPM veut « traduire » ses objectifs en « projets régionaux concrets ». Les participants ont donné dimanche la priorité à six de ces « initiatives clés ».
1) La dépollution de la Méditerranée : la Commission européenne a déjà présenté en mars des projets concrets qui visent à éliminer 80% des sources de pollution d’ici à 2020 et devraient coûter au moins 2 milliards d’euros.
2) La construction d’autoroutes maritimes et terrestres pour améliorer la fluidité du commerce entre les deux rives de la Méditerranée.
3) Le renforcement de la protection civile, d’autant plus importante que le bassin méditerranéen est exposé à un risque grandissant de catastrophes naturelles, lié au réchauffement climatique.
4) La création d’un plan solaire méditerranéen.
5) Le développement d’une université euroméditerranéenne, déjà inaugurée en juin à Portoroz (Slovénie).
6) Une initiative pour aider au développement des PME.
L’organisation: Les participants sont d’accord pour organiser un sommet tous les deux ans, alternativement dans l’UE et dans un des autres pays partenaires.
L’UPM bénéficiera d’une coprésidence, qui sera assurée au Sud pour deux ans non renouvelables par un pays choisi par concensus par les pays du Sud. Pour le Nord, les règles devront respecter les traités européens, mais les détails ont été reporté à novembre. L’Egypte et la France seront les deux premières coprésidentes.
Un secrétariat général sera chargé de lever les fonds et de mener à bien les projets choisis au cours des sommets. Mais le choix du lieu et les détails de fonctionnement de ce secrétariat ont été remis à novembre.
Ces nouvelles structures devraient être opérationnelles « avant la fin de 2008″.
L’UPM pourra financer ses projets par diverses sources : participation du secteur privé, budget européen, contribution de tous les Etats participants ou d’autres pays tiers, Banque européenne d’investissement…
Sources: Agence France Presse et le Nouvel Observateur