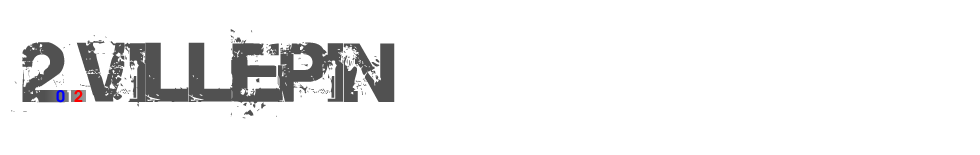Trois ans presque jour pour jour après le Non français à la Constitution Européenne, l’Irlande a rejeté hier le Traité de Lisbonne, plongeant l’Europe dans une nouvelle crise.
Alors que l’Europe leur apparaît de plus en plus comme une construction lointaine et abstraite, les citoyens européens recherchent au contraire un leadership politique qui les protège face aux bouleversements du monde.
« Le fossé va croissant entre la stratégie européenne et les préoccupations à court terme des citoyens »: ce n’est pas un eurosceptique qui parle, mais un Européen convaincu, le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes Jean-Pierre Jouyet.
Son constat rejoint celui de l’entrepreneur irlandais qui a mené une très active campagne pour le « non », Declan Ganley, qui a dénoncé vendredi les « bureaucrates de Bruxelles » éloignés des préoccupations des citoyens.
Pour M. Jouyet, cette « dichotomie », qui explique en partie la victoire du « non » en Irlande, n’a jamais été aussi flagrante que ces dernières semaines avec l’emballement des prix du pétrole et la grogne des pêcheurs et routiers.
Trois semaines durant, la Commission européenne est restée de marbre, rappelant simplement qu’elle avait une stratégie pour adapter l’économie européenne à l’ère post-pétrole. Le 11 juin seulement, l’exécutif européen infléchissait son discours, se déclarant pour des aides ciblées aux plus démunis et aux professions les plus touchées.
« Tant que l’Europe ne sera pas plus réactive à répondre à des problèmes à court terme, il y aura toujours une certaine méfiance à l’égard de la construction européenne« , estime M. Jouyet.
« Nombreux sont ceux parmi nos concitoyens qui n’arrivent pas à assimiler tout ce que nous devons faire et tout ce que nous faisons en Europe », reconnaissait lui aussi cette semaine le Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker, doyen des dirigeants de l’UE.
« Nous utilisons un vocabulaire qui n’est plus compris. Nous devrions nous appliquer à parler la langue de ceux que nous gouvernons« , a-t-il ajouté.
Après le camouflet en 2005 des « non » français et néerlandais à la Constitution, les dirigeants européens « en sont revenus à la vieille méthode technocratique de faire les choses », explique l’analyste Goran von Sydow, de l’institut suédois d’études des politiques européennes à Stockholm.
Le traité de Lisbonne, version allégée de la Constitution négociée à huis clos, est ainsi devenu 300 pages de jargon incompréhensible aux non-juristes. Et les dirigeants européens se sont mis d’accord pour éviter au maximum de le soumettre à des référendums nationaux imprévisibles – une insulte à la démocratie pour beaucoup.
Depuis la fin 2005, la Commission s’est néanmoins efforcée de communiquer vers les Européens de base, en vantant systématiquement les avantages pour le « citoyen » ou le « consommateur » de ses initiatives.
Mais la Commission fait « de la négociation politique et de la mise en oeuvre des traités, alors que les gens cherchent du leadership politique » qui les protège face aux bouleversements du monde, estime Pierre Defraigne, directeur de l’antenne bruxelloise de l’Institut français des relations internationales.
Le président de la Commission José Manuel Barroso a cependant réfuté ces critiques vendredi: il serait « injuste » et « malhonnête » de faire de la Commission « un bouc émissaire », a-t-il indiqué.
Beaucoup espèrent que le « non » irlandais convaincra les dirigeants européens de retourner à la volonté de démocratie affichée en 2001, avant le début des travaux de la Constitution. Ce n’est pas le chemin que semblent emprunter les dirigeants européens. Tout en assurant « respecter la volonté » des Irlandais, ils ont très majoritairement plaidé vendredi pour la poursuite de la ratification du traité.
La presse européenne partagée sur le non irlandais
Les titres de la presse allemande, anglaise, française, espagnole et italienne, étaient très partagés sur le non de 53,4% des Irlandais vendredi soir au référendum devant ratifier le traité simplifié sur les institutions de l’Union européenne (UE).
Pour Die Welt, « les Irlandais ont rejeté la réforme de l’UE et c’est très bien comme ça. Pourquoi auraient-ils dû approuver un Traité dont nul ne leur a expliqué l’utilité? ».
Sous le titre « Cauchemar européen », le Süddeutsche Zeitung (centre-gauche) déplore lui « le plus gros accident de la politique » et redoute une « paralysie interne » de l’UE. Le non irlandais « est un affront et la preuve que l’Union européenne part à la dérive », écrit le quotidien bavarois, pour qui « le prestige de l’UE en a pris un coup ».
Pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ, conservateur), « l’UE se retrouve dans la situation de crise dont elle s’était tirée l’an dernier ». Le non irlandais est « regrettable » mais ce n’est toutefois pas « la fin du monde », nuance le journal.
Le Tagesspiegel (centre-gauche) estime pour sa part que « l’Europe est menacée de connaître le sort de nombre d’entreprises familiales: la première génération a posé les fondations, la deuxième a construit par-dessus, la troisième est sur le point de dilapider l’héritage ».
Pour le Berliner Zeitung (gauche), l’UE « semble avoir finalement perdu sa capacité de réforme », le « Traité simplifié de Lisbonne est fini » et « il s’avère une nouvelle fois que la cohésion de l’UE est fragile et que la volonté de rénovation est épuisée ».
À Londres, le grand quotidien The Times estime que le non irlandais a gagné contre un projet qui était « jusqu’à présent nappé d’un jargon incompréhensible et impulsé par des fonctionnaires qui l’avaient inventé ».
Le journal économique Financial Times, propose une analyse similaire, en estimant que le vote non des Irlandais a rassemblé « un fatras de raisons différentes auxquelles il n’y a pas de réponses claires », ajoutant qu’un éventuel deuxième référendum en Irlande serait « destiné au même échec ».
Le quotidien populaire The Sun titre sur « le courage des Irlandais », estimant que la victoire du non est « mortelle ». L’Irlande a prouvé que « beaucoup de gens n’aiment pas le chemin que prend l’Europe », ajoute-t-il.
Selon le quotidien parisien Le Figaro, « les dirigeants européens n’ont guère appris la leçon de la crise ouverte il y a trois ans par les référendums en France et aux Pays-Bas ».
Pour sa part, Libération estime que l’Europe « a besoin de démocratie, de pédagogie. Elle doit associer les peuples de l’Europe à sa construction ». « Au rendez-vous de la démocratie, (l’Europe) n’est jamais là », dénonce aussi L’Humanité.
À Madrid, le quotidien El Pais (centre-gauche) estime que « l’Irlande a tourné le dos à l’UE » et provoque le chaos dans l’Union, la « bloquant une fois de plus dans une nouvelle crise, pour laquelle on disait jusqu’à hier qu’elle n’avait pas d’issue ».
Une longue série de crises
Le rejet du traité de Lisbonne par les Irlandais s’ajoute à une longue liste de crises depuis les origines de l’Europe .
30 août 1954: Le projet de Communauté européenne de défense (CED) échoue, la France ne ratifiant pas le traité signé en mai 1952. C’est la première crise européenne.
14 janvier 1963: Le général de Gaulle met son veto à l’adhésion du Royaume Uni. Il le répétera le 27 novembre 1967 et le Royaume-Uni n adhérera qu’en 1973.
1er juillet 1965: La France provoque la crise de la « chaise vide » après un affrontement autour du financement de la politique agricole commune.
30 novembre 1979: « I want my money back ». Le Premier ministre britannique Margaret Thatcher insiste pour obtenir un rabais de la contribution britannique au budget européen. Après près de cinq ans de crise, « Maggie » obtient une victoire totale le 26 juin 1984.
2 juin 1992: Le traité de Maastricht est rejeté par référendum par les Danois.
8 juin 2001: Les Irlandais rejettent à 54 % le traité de Nice. Ils finiront par l’adopter en octobre 2002 lors d ’ un deuxième référendum.
Début 2003: Divisions de l’Europe sur la crise irakienne.
29 mai 2005: Après neuf ratifications sans heurts, la France rejette le projet de Constitution européenne. Le 1er juin,
les Néerlandais font de même.
Sources: Agence France Presse et Le Télégramme