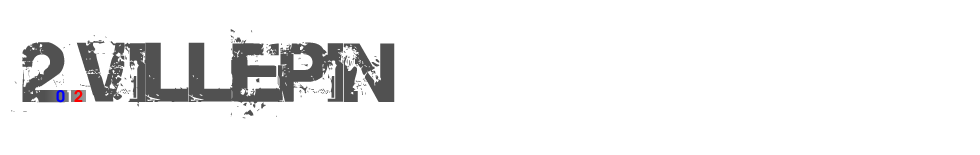Interrogé sur Europe 1 à l’annonce de la disparition d’Aimé Césaire, Dominique de Villepin a déclaré: « On perd un grand homme. On perd une conscience, une conscience qui est celle de la négritude mais qui est aussi de tout homme qui souffre et on perd en même temps un très très grand poète de l’Universel.
Je crois que tout Césaire est dans cet affirmation qui était la sienne: « Il n’y a pas dans le monde un pauvre type lynché, un pauvre homme torturé en qui je ne sois assassiné et humilié ».
C’est la conscience que dans toute douleur, il y a un élément à comprendre, à partager et je crois que c’est vraiment l’homme de ce témoignage au coeur du 20ème siècle souffrant ».
« A la Martinique et en Guadeloupe, dans ces îles de mon enfance, je revois les quartiers de couleurs. Mon corps n’a jamais tout à fait déshabité ces terres si attachantes ni oublié les rencontres magiques.
A chacune de mes entrevues avec Césaire, dans son petit bureau de l’ancienne mairie de Fort-de-France, où il se rend quotidiennement depuis des décennies, j’ai été touché par la douceur et l’exquise gentillesse de l’homme. Mais très vite, quand l’oeil s’allume à l’évocation de son île, on retrouve la passion et l’indignation.
La brûlure de l’esclavage ranime la douleur de destins écartelés, entre un peuple et ses origines africaines perdues, entre Noirs et Blancs, entre Caribéens et métropolitains. Les coeurs sont à vif, blessés dans l’écheveau des querelles d’identité. Face à la nécessité d’une égale reconnaissance de toutes les souffrances germent la compétition des mémoires, la surenchère entre les victimes.
Plongeons en 1939, à la charnière de ce siècle. Cette année-là, Césaire quittait Paris pour regagner son île natale, la Martinique. Un peu plus tard, l’amiral Robert y établissait sa tyrannie. C’est ainsi que ce jeune homme de vingt-six ans s’éloignait d’une Europe peureuse, sur le point de s’embraser, pour affronter la faillite de sa civilisation.
Né à Basse-Pointe dans une famille de sept enfants, Aimé Césaire fait ses études secondaires au lycé de Fort-de-France. Bachelier, il quitte alors la Martinique pour entrer au lycée Louis-le-Grand à Paris avant de réussir le concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure. Les humanités classiques ne l’éloignent pas de ce qui est déjà sa préoccupation principale, la conscience noire pour laquelle il forge le nom de négritude. Car c’est bien lui qui est l’inventeur du concept. Après sa licence de lettres classiques à la Sorbonne, il prépare un mémoire sur les poètes noirs des Etats-Unis. Les débats suscités par l’Exposition coloniale, vivement contestée en particulier par les surréalistes, le mettent en état d’alerte: présenter dans des pavillons les civilisations indigènes, n’est-ce pas montrer dans des cages sans barreaux des fauves bien ou mal apprivoisés? N’est-ce pas les afficher comme différentes dans un monde cassé qui est celui de la colonisation?
Ses dernières années parisiennes sont des années de repli sur soi, alors que s’opère en lui un retour intérieur, nécessaire prélude au retour définitif dans son île. Car une vie s’enrichit moins des ruptures que des enchaînements. Marié avec une étudiante martiniquaise, Suzanne Roussi, il ralentit sa participation aux réunions et aux discussions politiques pour lire davantage, pour écrire. Rimbaud joue pour lui un rôle, sinon de médiateur, du moins de révélateur. Le carnet de damné n’est pas étranger au manifeste pétique qu’il médite déjà.
Césaire, marqué par cette oeuvre violente, est désormais persuadé que la culture antillaise est d’abord d’ascendance africaine. Dans le cadre de la lutte contre le fascisme, il participer à l’élan unitaire de la mobilisation en faveur de l’Ethiopie que veut conquérir l’Italie de Mussolini. L’inaction de la Société des Nations, le laisser-faire de Laval et des Anglais sont autant de causes de scandale, lorsque l’Italie fasciste se sasisit du seul empire indépendant africain au moyen de chars et d’avions modernes. La chute d’Addis-Abeba sonne le glas de la résistance du Négus. Césaire repousse alors ceux que Malraux, dans son premier roman, avait appelés Les Conquérants. Pour lui, antifascisme et anti-impérialisme vont de pair.
Devant la montée des périls, devant le sentiment de perdre en Europe ses repères, il décide donc de quitter la France après la signature du pacte germano-soviétique et la publication à Paris d’un Cahier d’un retour au pays natal. Il s’embarque avec sa famille à bord du paquebot Bretagne pour atteindre Fort-de-France, alors que la guerre vient d’être déclarée.
Ce retour au pays natal devait mettre fin à l’angoisse. Mais Césaire découvre dans son royaume l’abandon, les vilenies et les laideurs, dont parents et ancêtres ne sont pas parvenus à se dégager. De nouvelles plaies se sont ouvertes.
Le prologue ajouté au Cahier évoque au passé non pas le bout de la nuit, mais le bout du petit matin. Et cette formule, vingt fois répétée, n’est pas une simple variante du titre de Céline. A son retour dans l’île, l’enfant prodigue a l’impression que les maisons se ferment sur son passage. Le poète attend une aurore, il ne trouve que les ombres: une ville inerte, une foule opprimée, et la peur. La menace du volcan est loin d’être la pire. La nuit ne parvient pas à chasser la touffeur du jour et l’oppression de l’Histoire. Pourtant l’admirable paysage est là, et le natif de la Martinique s’enorgueillit de cette faune et de cette flore à la fois réelles et mythiques. Le poète hésite entre deux vocations, celle de la destruction ou celle du renouveau. La lumière l’emporte finalement sur les ténèbres. L’attente confiante sur les résidus de la peur. »
Source: Hôtel de l’Insomnie, par Dominique de Villepin (Plon)