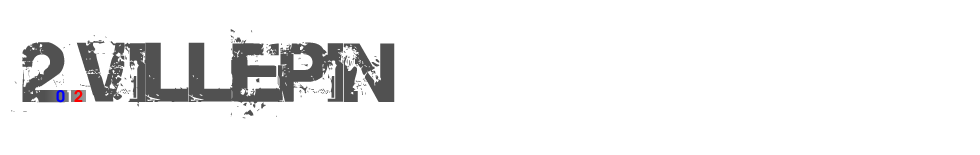Premier ministre de Jacques Chirac, « serviteur de l’Etat », diplomate, Dominique de Villepin entretient des rapports cordiaux avec la Suisse qu’il a accompagnée sur les fonts baptismaux de l’ONU.
Interview à l’occasion de son passage à Genève, dans laquelle l’ancien chef du gouvernement évoque l’actualité et son avenir personnel.
L’inquiétude grandit autour d’Ingrid Betancourt. En juillet 2003, l’opération de récupération que vous aviez lancée a échoué. Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle?
Les FARC ne ressemblent à aucune autre guérilla. Au fil des années, nous avons dans la plus grande discrétion envoyé des dizaines de missions en Colombie et dans la jungle pour nouer un dialogue. Aucune de ces tentatives n’a pu aboutir. A l’époque, j’ai travaillé avec Micheline Calmy-Rey: la Suisse n’a jamais cessé d’apporter son soutien.
Aujourd’hui tout est plus médiatique. En Colombie, la situation a évolué, et c’est une chance que de pouvoir bénéficier de la mobilisation du président Uribe, comme de celle d’acteurs régionaux – le président vénézuélien Chavez ou Cristina Kirchner, la présidente de l’Argentine.
Le président colombien se dit prêt à effectuer des libérations. Encore faut-il que les FARC répondent. En 2003, nous avons monté une opération de sauvetage d’Ingrid Betancourt. C’est la famille, informée par le président Uribe, qui nous l’avait demandé – ce qui n’a pas été assez rappelé dans la polémique qui s’est ensuite nouée.
Il fallait réagir rapidement. Nous avons dans les conditions les plus discrètes envoyé un avion, non sans hésiter sur le lieu d’atterrissage. On a évoqué les Antilles et la Guyane. Les services de renseignements ont finalement préféré le Brésil car il semblait y avoir urgence humanitaire. Puis l’affaire a été révélée, ce qui a provoqué une polémique regrettable. Il n’y avait dans notre démarche qu’une préoccupation humanitaire.
La mobilisation doit maintenant se poursuivre. Il faut avec le plus grand pragmatisme faire appel à toutes les bonnes volontés, en évitant de froisser les susceptibilités. La situation exige à la fois pragmatisme, solidarité, et action collective.
De nombreux observateurs dénoncent l’intransigeance du gouvernement colombien…
Je ne peux donner aucune leçon à quiconque. La position du gouvernement colombien n’est pas facile. Pendant de trop nombreuses années, il a connu la guérilla, la violence, les prises d’otages. Il entend ne pas transiger avec des mouvements qui utilisent de telles méthodes. Et en même temps, il se montre aujourd’hui disposé à faire des gestes. Dès lors qu’il accepte de rentrer dans une logique de dialogue, il faut l’accompagner, en souhaitant que les FARC répondront dans le même esprit. Au-delà des gestes qui pourraient conduire à la libération d’Ingrid Betancourt, je veux espérer qu’une nouvelle page pourra s’écrire dans l’histoire de la Colombie. Car cette violence ne mène qu’à l’impasse, à la souffrance des uns et des autres. Essayer de trouver une solution humanitaire qui puisse déboucher à terme sur une solution politique, voilà qui me paraît être la juste voie.
Faut-il envisager des sanctions à l’encontre de la politique de Pékin au Tibet? Que pensez-vous d’un boycottage de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques?
Il faut être exigeant. L’esprit olympique suppose la paix, la tolérance, l’ouverture aux autres.
Il faut en même temps éviter de tomber dans des pièges. Le risque est de voir les positions se raidir. Nous avons un problème, nous les Occidentaux, et la Chine également. Comment faire pour avancer les uns et les autres vers une solution?
Il faut distinguer le court et le moyen terme. A court terme, le problème est celui de la cérémonie d’ouverture. Car personne ne songe à remettre en cause les Jeux olympiques eux-mêmes: on ne prend pas le sport en otage. Les Jeux sont une chance d’ouverture pour tous les peuples du monde, et en l’occurrence pour les Chinois.
Quant à la cérémonie d’ouverture. elle ne dépend pas de la simple volonté des Etats. Pour éviter qu’elle soit perturbée par des athlètes, par des spectateurs ou par les téléspectateurs qui ne seront pas au rendez-vous, il faut être en initiative. Je souhaite que se poursuive le dialogue. Que par tous les moyens, y compris les plus discrets, nous puissions faire comprendre à la Chine qu’il faut alléger la souffrance du peuple tibétain.
Reste le problème de fond. La question du Tibet, c’est aussi la place des Tibétains dans l’économie de la province, et celle du Tibet dans l’ensemble chinois. Il faut donc plus d’autonomie pour les Tibétains et plus de participation à la réussite économique du Tibet. Lorsque les Jeux seront finis, cette réalité-là ne devra pas être oubliée. Il importe de s’atteler à ce travail en liaison avec les Chinois, dans un esprit responsable et constructif.
Quelle leçon tirez-vous des déboires de la Société générale? Comment expliquez-vous les pertes extraordinaires enregistrées pas la banque française à la suite des opérations du trader Jérôme Kerviel?
Il faut à l’évidence constater un dysfonctionnement dans les banques, et de manière générale, dans l’ensemble des entreprises. Le système financier doit être repensé dans un esprit de plus grande transparence, de plus de responsabilité et de plus de justice aussi.
Le travail doit être fait par les acteurs eux-mêmes, par les banques et les compagnies d’assurances, par l’ensemble du système financier. Mais la collectivité internationale, les Etats et les organisations internationales doivent prendre également la mesure de leur responsabilité. Cette crise financière démontre qu’une partie des problèmes du monde n’est traitée par personne. Il faut donc plus de gouvernance mondiale, plus de cohérence et de coordination dans l’action des Etats. Pour éviter la multiplication des bulles immobilières ou des bulles spéculatives, nous devons repenser l’ensemble du système.
La crise des subprimes remet-elle en cause l’évolution des économies libérales?
Nous devons constater que la simple régulation par le marché ne peut être la réponse aux problèmes du monde aujourd’hui. Sans un système d’action très volontaire, nous n’arriverons pas à passer le cap des difficultés. Le fait que le Sud soit capable d’affirmer sa place, à travers les grandes économies de la Chine, de l’Inde ou du Brésil, doit également constituer pour nous un avertissement très puissant.
Le risque, c’est de voir des pays s’enrichir de plus en plus, et d’autres s’appauvrir. En outre, ce qui est vrai à l’intérieur du système mondial et à l’échelle des Etats, l’est aussi à l’intérieur de nos propres économies. Il faut une prise de conscience à l’intérieur des pays, des outils de régulation nationaux. Et des outils à l’échelle de la planète.
Prenons les fonds souverains, ces acteurs essentiels du jeu économique, industriel et financier. Ils se développent dans les pays du Sud. Quelle sera la réponse du Nord? Comment faire en sorte que ce nouvel équilibre financier se réalise au bénéfice d’un intérêt général? Voilà autant de questions sur la table.
Avec d’autres personnalités, vous avez signé le 14 février un appel à une « vigilance républicaine ». Six semaines plus tard, êtes-vous plus rassuré?
Il y a dans la vie démocratique un travail de conscience qui doit être fait. Sans aucune arrière-pensée partisane ni polémique. Cette vigilance républicaine, je l’ai évoqué depuis de longs mois. Les sujets me tiennent à cœur, qu’il s’agisse de l’équilibre des pouvoirs, de l’indépendance nationale, ou de la laïcité.
Il est bon de temps en temps de dire les choses. Même un peu brutalement ou maladroitement. La responsabilité des décideurs, c’est de les écouter. Que ce message ait pu être entendu, que des actions, des positions aient pu être corrigées, c’est tout l’intérêt d’une démocratie.
Une démocratie est toujours beaucoup plus forte quand elle a une opposition forte. Il y aussi une responsabilité des citoyens. Cette pétition exprime tout simplement ma volonté de ne pas me dérober devant mes responsabilités.
Avez-vous le sentiment d’avoir été entendu?
Je crois que le message a été entendu. Il reste qu’entre le diagnostic, la compréhension et l’action politique, le passage est toujours difficile. Cela se juge dans la durée.
Ce qui me paraît important, c’est de pouvoir dire les choses, même si c’est parfois douloureux. Et le dire quel que soit l’horizon où on se situe. J’ai vécu dans un gouvernement entre 2005 et 2007 où il y avait une formidable diversité. On est toujours servi quand des voix fortes s’expriment. Cette diversité, cette exigence permet de faire vivre la démocratie.
Où en est l’affaire Clearstream, dans laquelle vous êtes mis en examen pour « complicité de dénonciation calomnieuse »?
Premier ministre, je n’ai pas voulu répondre aux accusations lancées contre moi. Cette affaire n’a pas de réalité politique. L’instruction est close. Les reproches qui ont pu m’être faits se révèlent sans fondement. On a été jusqu’au bout des rumeurs et des soupçons. Il faudra essayer de comprendre comment mon nom a pu être jeté en pâture.
Vous ne détenez pas de mandat électif. Songez-vous à vous présenter un jour devant les électeurs?
Je suis au départ un serviteur de l’Etat. J’ai été amené à la politique car on m’a confié des missions. C’est dans cet esprit de mission que j’ai voulu relever le défi de la politique. Que dans d’autres circonstances de la vie, l’élection s’impose à moi, bien sûr: je n’ai jamais rejeté l’élection. Si l’occasion se présente, je ne me déroberai pas.
Quelle image gardez-vous de Mai 68?
J’étais le seul gréviste au lycée français de Caracas. J’étais loin de la France. J’apercevais un tournant dans les relations entre le pouvoir et la société, l’affirmation d’une jeunesse, d’un autre regard porté sur le monde, d’un idéal à défendre.
Vous admirez Napoléon. Connaissez-vous aujourd’hui un homme d’Etat qui puisse lui être comparé?
Le drame d’aujourd’hui, c’est peut-être l’insuffisance de leadership national et international. Les hommes devraient moins avoir le regard porté sur les baromètres de la communication. C’est en s’allégeant de ses propres intérêts personnels que l’on peut le mieux servir son pays et le monde.
Source: Denis Etienne et Jean-François Verdonnet (La Tribune de Genève)