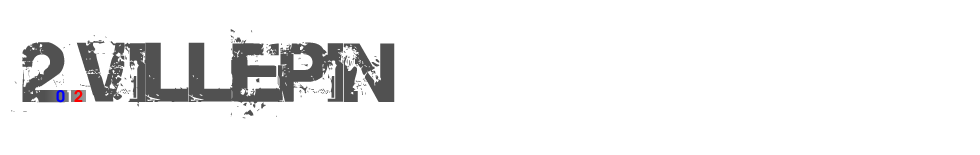Le Conseil constitutionnel a validé, jeudi 16 août, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « paquet fiscal », censurant toutefois une des dispositions phares du texte.
La décision des Sages, qui concerne le dispositif permettant aux Français ayant souscrit avant le vote de la loi un emprunt immobilier de bénéficier d’exonérations fiscales, met le gouvernement dans l’embarras.
François Fillon a immédiatement affirmé que le gouvernement allait proposer sous peu un nouveau dispositif. « Le gouvernement tiendra les promesses du projet présidentiel en matière d’accès des Français à la propriété », a souligné le premier ministre, qui dit se réjouir que le Conseil ait « validé l’essentiel ».
La loi prévoyait un crédit d’impôt égal à 20% des intérêts des emprunts immobiliers payés au titre des cinq premières années de remboursement pour l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à l’habitation principale, dans la limite de 7.500 euros pour un couple (soit 1.500 euros par an).
La mesure devait bénéficier à ceux qui achèteront un logement après l’entrée en vigueur de la loi, mais aussi à ceux qui avaient acquis leur habitation principale depuis moins de cinq ans.
Pour distinguer les prêts, la date de l’acte de vente sera déterminante, indique-t-on de bonne source. C’est donc la rétroactivité de la mesure gouvernementale que les Sages n’ont pas validée : ils ont estimé qu’elle serait créatrice d’une « rupture d’égalité » entre contribuables et ont jugé son coût trop élevé.
« Le Conseil constitutionnel a jugé que cet avantage, qui est précisément encadré, répond pour les prêts futurs à un objectif d’intérêt général qui est de favoriser l’accession à la propriété », selon un communiqué officiel. « Il n’en va pas de même pour les prêts déjà accordés, car, par définition, pour ceux-ci, le contribuable est déjà propriétaire de son habitation principale », selon le Conseil.
Le coût de la mesure, « 7,7 milliards d’euros, fait supporter à l’Etat des charges manifestement hors de proportion avec l’effet incitatif attendu », a par ailleurs estimé la haute juridiction.
Ce dossier avait suscité des divergences entre le président Nicolas Sarkozy et le ministre du budget et des comptes publics, Eric Woerth. Le premier avait publiquement désavoué en mai le second qui souhaitait limiter la mesure aux emprunts souscrits après le 6 mai. Nicolas Sarkozy avait alors souligné qu’il avait promis durant sa campagne de satisfaire tous les emprunteurs.
« Toutes les promesses que j’ai faites, je les ai faites en toute connaissance de cause. (…) Je ne laisserai personne dénaturer le projet que j’ai porté tout au long de la campagne présidentielle. Je ne laisserai personne renier mes engagements », avait-il dit.
Les Sages s’étaient eux-mêmes saisis de l’article 5 de la loi, finalement invalidé. Les parlementaires socialistes avaient pour leur part déposé un recours sur les articles 1 (heures supplémentaires), 11 (bouclier fiscal) et 16 (exonérations d’ISF pour les investissements dans les PME). Le Conseil a jugé ces articles conformes à la Constitution.
Les Sages ont aussi donné leur aval à l’ensemble de la loi sur le service minimum dans les transports terrestres.
Cette loi, a jugé le Conseil, ne porte pas atteinte à l’exercice du droit de grève.
A propos de l’obligation de déclaration préalable 48 heures avant le début de toute grève, il a souligné qu’ »elle ne saurait être étendue à l’ensemble des salariés » et « ne concerne que les salariés dont la présence détermine directement l’offre de service ».
Cette obligation, qui « a vocation à faciliter la réaffectation des personnels disponibles en cas de grève », « ne porte pas atteinte à l’exercice du droit de grève », a-t-il jugé.
Elle « ne s’oppose pas à ce qu’un salarié rejoigne un mouvement de grève déjà engagé », à condition, précise la décision du Conseil, « qu’il en informe son employeur au plus tard 48 heures à l’avance ».
Le Conseil a également jugé que « la possibilité d’organiser une consultation sur la poursuite de la grève huit jours après le début de celle-ci ne porte pas atteinte au droit de grève ».
Un service minimum dans les transports terrestres réguliers de voyageurs sera donc mis en place au 1er janvier 2008, sur le modèle de ce qui existe déjà chez plusieurs de nos partenaires européens, s’est félicité M. Fillon.
Sources: Le Monde et AFP