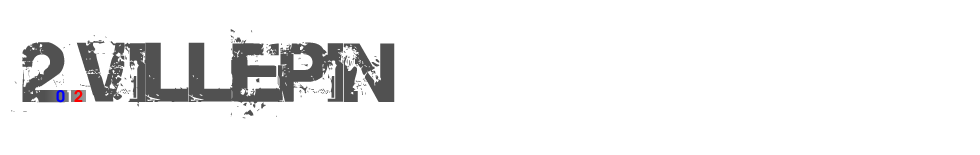Voici le texte intégral de l’intervention du Premier Ministre Dominique de Villepin à la Kennedy School of Government, vendredi 16 mars.
Avant toute chose, permettez-moi de remercier l’Université de Harvard, la « Kennedy School of Government » et le « Minda de Gunsburg Center for European Studies » pour leur accueil aujourd’hui. Tout à l’heure, j’ai eu le plaisir de m’entretenir avec le doyen ELLWOOD et le professeur Joe NYE. Je voudrais également remercier Mary Jo BANE, doyenne de la Kennedy School.
Je tiens aussi à saluer très chaleureusement les directeurs du « Center for European Studies » et bien sûr, son fondateur, mon très bon ami le Professeur Stanley HOFFMANN que je remercie pour ses propos amicaux. Et je dois dire que l’un de mes vœux les plus chers serait de rester quelques semaines de plus afin d’être sûr de pouvoir assister à ses cours sur CAMUS, l’un de mes auteurs favoris. Vous ne mesurez pas la chance que vous avez : soyez sûrs d’aller l’écouter.
Je voudrais aussi rendre hommage aux professeurs de Harvard qui sont parmi nous aujourd’hui et aux étudiants à qui ce Forum est destiné.
Tous ici, nous savons que nous sommes à un tournant majeur dans l’évolution de notre planète. - En quelques années, nous avons changé de monde. La mondialisation a profondément bouleversé les grands équilibres internationaux. C’est pour nous tous un formidable défi : c’est un risque mais aussi une opportunité. - Si nous voulons garder la maîtrise de ces changements, nous devons mieux les analyser, mieux les comprendre ensemble. C’est ce que je vous propose aujourd’hui : laissons de côté nos certitudes, regardons le monde tel qu’il est, et avançons ensemble vers plus de justice et de paix.
Au cours de moments difficiles, quand on ne sait pas où aller, je pense qu’il est très important de prendre du recul et de regarder les choses avec une perspective différente. Je me souviens quand j’avais l’âge de la plupart d’entre vous, un peu plus de vingt ans, en 1975, je venais de terminer mes études en sciences politiques à Paris, et j’étais hésitant sur la voie à choisir. J’ai alors demandé à mon père, et il m’a dit : « Je pense que la meilleure chose que tu puisses faire est d’aller à Harvard » rires, puis il ajouta quelque chose. Il m’a dit : « voici un billet. Tu es intéressé par les relations internationales. Va en Asie du Sud ».
C’était la fin de la guerre du Vietnam, c’était le retrait des soldats américains du Vietnam, et il m’a dit : « Vas-y, découvre les pays, rencontre les gens, tu auras une meilleure idée de ce qu’est le monde. » Donc j’y suis allé et j’ai découvert que très peu de gens savaient que De Gaulle avait prononcé un discours en 1966, le discours de Phnom Penh. Tout le monde avait oublié ce qu’il avait dit à cette époque. Et vingt ans après nous, les Américains faisaient exactement la même erreur que celle que nous avions commise, exactement la même. Je me suis alors dit : « je vais devenir diplomate de carrière ». Je ne suis donc jamais venu ici. C’est donc pour moi un très, très grand plaisir d’être ici aujourd’hui, parce que je pense que, peut-être, ensemble, nous ne ferons pas deux fois la même erreur.
1. L’absence d’ordre mondial, voilà la vraie menace.
Il ne faut pas seulement prendre en considération les crises du monde, qui sont certes nombreuses, mais il faut aussi s’intéresser au système international et mondial, car il est plus facile de changer le système que de changer le comportement de chacun des acteurs du système. Hier nous avions deux grands blocs d’influence, l’Ouest et l’Est. Nous avions deux superpuissances, les Etats-Unis et l’Union Soviétique. Le point d’équilibre des rapports de force pouvait être instable et dangereux, mais il existait. Aujourd’hui ce point d’équilibre n’existe plus. Le centre a disparu.
Ø Dans le monde actuel, rien n’organise le désordre de la planète. - Certes, il existe des institutions multilatérales. Mais elles ne parviennent pas à jouer leur rôle pour la mise en place d’une véritable gouvernance mondiale. L’engagement des Etats dans ces institutions n’est pas toujours à la hauteur des enjeux. Les décisions unilatérales remettent en cause leur légitimité. Pourtant, ne nous y trompons pas, la somme des intérêts particuliers ne fait pas l’intérêt général. La légitimité du multilatéralisme se construira par les Etats, au nom de valeurs qui nous dépassent. - C’est vrai, certains pays ont plus d’influence que d’autres. Mais aucun ne peut aujourd’hui imposer seul un nouvel ordre mondial. § Est-ce que les Etats-Unis ne peuvent pas malgré tout jouer ce rôle ? Ils restent effectivement la première puissance, ils sont seuls à en posséder tous les attributs : la force militaire, la puissance économique, la capacité d’innovation technologique, la force d’attraction de leur mode vie. Ils ont su aussi, tout au long du XXème siècle, construire un modèle économique et culturel, bâtir un idéal de modernité qui a forcé l’admiration de tous les autres peuples. Vous avez été pour nous le camp de la liberté. Vous avez été les garants du respect de l’homme. Et à titre personnel, je veux vous dire, moi qui ai habité aux Etats-Unis, moi qui aime votre pays, l’Amérique reste un rêve pour beaucoup de peuples dans le monde. § Maintenant, regardons les chose lucidement : la guerre en Irak a marqué un tournant. Elle a brisé l’image de l’Amérique. Elle a détérioré celle de l’Occident tout entier. Il est temps aujourd’hui que les Etats-Unis et l’Europe regagnent ensemble le respect et l’admiration des autres peuples.
Ø Le désordre mondial est aggravé par un sentiment d’injustice profond.
Notre monde connaît des progrès techniques sans précédent. Il crée toujours plus de richesses. Il offre plus d’opportunités que jamais. C’est une chance pour tous ceux, pays, peuples, entreprises, individus, qui ont les atouts nécessaires pour tirer profit de ces bouleversements.
Mais pour beaucoup d’autres, cette évolution veut dire inégalités croissantes, nouveaux risques et peurs accrues. - Ces peurs, elles existent en Europe, et notamment en France, où certains redoutent une remise en cause de notre modèle de justice sociale. § En matière de droits sociaux, en matière de normes juridiques, la mondialisation n’a pas engendré de rapprochement des règles : la concurrence se fait à l’échelle mondiale, mais à armes inégales. Les nouveaux équilibres commerciaux engendrent des délocalisations et mettent en danger les acquis sociaux des pays développés. § Ces risques frappent d’abord les plus faibles, ceux qui n’ont pas d’éducation, pas de qualification, ceux qui n’ont aucun accès à la culture du monde. Je veux le dire devant vous qui êtes l’élite de l’éducation mondiale. Vous avez une responsabilité envers tous ceux qui n’ont pas eu votre chance. Harvard fait rêver. Et je sais que Harvard fait de son mieux aider et s’engager pour remédier aux désordres du monde. § Mais ces risques commencent à toucher également les classes moyennes qui se sentent fragilisées, et pour certaines paupérisées. Si la mondialisation doit se solder par la disparition des classes moyennes ou par l’affrontement entre les plus pauvres et la minorité des plus riches, alors il est temps de réagir. Une société vit dans la diversité. Une société vit dans l’équilibre. Aucun peuple ne supporte durablement les inégalités croissantes. - Ce qui est vrai à l’échelle d’un peuple est vrai à l’échelle de la planète. La mondialisation déstabilise certains pays en voie de développement. Elle fragilise leur économie. Elle avive par conséquent les revendications identitaires et religieuses. Elle menace les ressources naturelles et l’équilibre de la planète.
Ø Voici le monde dans lequel nous vivons : un monde plus complexe et plus ins
table que jamais. Ce désordre mondial n’est ni superficiel, ni temporaire. Il entretient des déséquilibres profonds.
Déséquilibres économiques et démographiques, d’abord, qui provoquent des flux migratoires de plus en plus massifs. C’est un défi majeur, non seulement pour les pays développés, mais aussi pour les pays du sud eux-mêmes, confrontés au risque de perdre une part importante de leur jeunesse, parfois la plus qualifiée, ou menacés d’instabilité par le passage d’immigrés de plus en plus nombreux. C’est pourquoi il est si important de construire avec ces pays des partenariats permettant de mieux contrôler les flux migratoires en promouvant activement le co-développement. Ne négligeons pas non plus l’importance de nouveaux enjeux stratégiques comme la lutte contre les pandémies, la protection des biens publics mondiaux, la sécurité énergétique, l’accès aux ressources naturelles, en particulier l’eau.
Le désordre mondial engendre ensuite des déséquilibres de sécurité. L’aggravation des crises nourrit le terrorisme : l’attentat du 11 septembre a marqué l’entrée dans cette ère nouvelle de l’hyper-terrorisme. La résolution des crises régionales est indispensable à notre sécurité. Nous savons qu’elles nourrissent de manière directe ou indirecte la menace terroriste, comme c’est le cas avec l’Iraq, mais également avec le conflit israélo-palestinien.
Enfin, le désordre mondial provoque des déséquilibres de puissance qui remettent en cause le régime de prolifération. - Aujourd’hui, la prolifération nucléaire menace de franchir un nouveau seuil. Les tentations sont nombreuses : elles sont stratégiques, pour des Etats qui cherchent à sanctuariser leur territoire ; elles sont politiques, car acquérir la bombe reste perçu comme un élément de statut sur la scène internationale ; elles sont économiques, pour les réseaux qui en tirent des profits importants. - Face à cette situation, les instruments internationaux sont aujourd’hui insuffisants. Ils restent des piliers essentiels de la paix et la sécurité collective dans le monde. Mais ils se heurtent aussi à la difficulté des contrôles et à l’insuffisance même des normes. Nous devons les préserver et les renforcer. La pérennité du système international de non-prolifération et de sécurité repose sur sa crédibilité : ceci suppose une capacité d’adaptation permanente face aux défis auxquels nous sommes confrontés.
Face à ce désordre mondial, nous avons le choix : soit nous entretenons la concurrence entre nos Etats, soit nous nous engageons résolument sur le chemin de la coopération. La concurrence entre nos Etats n’est dans l’intérêt de personne. La seule voie possible, c’est la coopération.
2. Dans cette marche vers un nouvel ordre mondial, les Etats-Unis, la France et l’Europe ont plus de devoirs que les autres.
Pourquoi ? Parce que nous sommes des démocraties porteuses d’universalisme. Parce que nous sommes des pays riches. Mais aussi parce que nous avons des intérêts communs : faire avancer la société internationale, partager notre engagement avec toujours davantage de pays.
Ø Nous avons d’abord le devoir de travailler ensemble.
Car nos destins sont liés, notre amitié est profonde. - Nos histoires s’enchevêtrent, de Yorktown à Omaha Beach, de Rochambeau et Lafayette défendant l’indépendance américaine, au plan Marshall permettant à l’Europe libérée de renouer avec la prospérité et la démocratie. Aujourd’hui nous sommes de nouveau réunis pour défendre nos valeurs et notre mode de vie, en particulier face à la menace terroriste. - L’Europe est le seul allié global des Etats-Unis. § C’est vrai sur le plan politique. Ce qui nous rapproche est plus fort que ce qui nous divise. Nous partageons les valeurs fondamentales : la démocratie, les droits de l’homme, une même conception de la place de l’individu dans la société. § C’est vrai sur le plan économique : l’Europe est la première destination des investissements américains et le premier investisseur aux Etats-Unis. § C’est vrai aussi dans le domaine de la sécurité : notre coopération dans le domaine du renseignement est aujourd’hui exemplaire.
A nous de construire un partenariat d’égal à égal. L’intérêt de l’Europe, ce sont des Etats-Unis puissants mais ouverts. L’intérêt des Etats-Unis ce n’est pas une Europe soumise, c’est une Europe forte, plus responsable. Elle est pour eux un partenaire et non un rival. C’est lorsque nous agissons ensemble que nous sommes efficaces. Nous le voyons sur le dossier libanais : de l’adoption de la résolution 1559 à la résolution de la crise de l’été dernier, c’est bien notre action conjointe qui a été au cœur des solutions.
Pour y parvenir, chacun a un effort à faire. - Aujourd’hui, l’Europe n’assume pas toute sa responsabilité politique. Je vois aujourd’hui deux exigences absolues pour l’Europe : § La première, c’est de rétablir un véritable projet commun et d’adopter un nouveau texte fondateur. § La deuxième exigence pour l’Europe, c’est d’assumer son rôle de puissance militaire. Autant la force seule est désastreuse, autant la politique sans la force est vaine. L’Europe de la défense n’est pas un substitut à l’OTAN. En la renforçant, nous renforçons les capacités de l’Europe à contribuer à la sécurité du monde et à prendre sa part du fardeau : nous l’avons vu en République démocratique du Congo, l’année dernière, quand l’Europe a assuré la sécurité des élections et contribué ainsi à la stabilité de ce pays-clé du continent. Inversement, l’ajustement du rôle de l’OTAN, indispensable depuis la disparition de l’Union soviétique, doit laisser toute sa place à l’affirmation de la défense européenne. - L’Amérique, pour sa part, doit mieux prendre en compte la réalité du monde. § Les dernières grandes crises nous l’ont montré : dans un monde où les conflits sont asymétriques, quelques mois de campagne militaire peuvent être suivis d’interminables années de crise. L’outil militaire doit plus que jamais s’inscrire dans une stratégie de paix avant tout politique, bien entendu. Nous ne croyons pas que la démocratie puisse s’imposer par la force. § La vraie force des Etats-Unis, ce n’est donc pas son armée. C’est sa capacité à incarner le progrès et la modernité, c’est sa maîtrise des technologies de pointe, c’est l’attractivité de son territoire et de sa culture aux yeux du reste du monde. Ce doit être, plus encore, sur le plan diplomatique, une capacité d’influence renouvelée, pour partager avec toujours plus de pays son exigence démocratique. C’est en construisant un consensus par le dialogue, c’est en faisant accepter par le plus grand nombre d’Etats nos choix politiques que les chances de succès sont les plus grandes. Oui, la forme moderne de la puissance, c’est à la fois l’influence et la capacité de faire ensemble. Entraînons les autres. Montrons que nous pouvons être force de proposition et de conviction. Il n’y a plus de puissance en soi. Il n’y a de puissance qu’organisée et partagée.
Ø Pour être efficace, notre coopération doit être au service d’une gouvernance mondiale qui donne sa place à chacun.
Nous sommes deux nations qui partageons des valeurs humanistes et une même aspiration à l’universel. Nous devons être exemplaires. Soyons les pionniers d’une nouvelle éthique internationale, défendons des principes forts : - Tout d’abord, le respect du droit, y compris dans la lutte contre le terrorisme car la sécurité est inséparable, dans la durée, de la justice. Les frustrations et les inégalités nourrissent les conflits : la meilleure réponse des démocraties au terrorisme est dans la fidélité à leurs valeurs. - Deuxième principe : le resp
ect des identités. Elles sont au cœur de toutes les crispations. Leur meilleure prise en compte est une condition morale mais aussi de notre sécurité. - Enfin, troisième principe : l’exigence de l’encadrement de la force par le droit et le primat de la sécurité collective. C’est à cette condition seulement que la légitimité de l’action peut être assurée et qu’une solution durable aux crises peut être envisagée. Nous venons de le voir au Liban : c’est en s’appuyant sur une résolution des Nations unies, avec l’accord des parties et l’appui de l’ensemble des membres du conseil de sécurité, que la FINUL renforcée a pu engager une présence efficace au Liban.
C’est forts de ces principes que nous pourrons refonder une gouvernance internationale plus efficace, à travers un multilatéralisme rénové. C’est vrai dans le domaine politique : - Cela implique des organes de décision plus représentatifs. Je reste convaincu, en particulier, que l’élargissement du Conseil de sécurité est indispensable au renforcement de sa légitimité : mieux prendre en compte le poids du Japon, de l’Allemagne, des grands pays émergents, de l’Afrique, c’est une garantie que nos décisions collectives seront mieux acceptées de tous. - Cela implique aussi des organes de décision plus mobilisés dans la gestion de crise. Je pense qu’il serait utile d’avoir au niveau ministériel une réunion mensuelle des membres du conseil de sécurité pour apporter des réponses aux crises actuelles. - Nous devons, plus largement, disposer d’instruments à la hauteur des enjeux : § Les Nations unies ont besoin d’un véritable bras armé pour le maintien de la paix : près de 100 000 casques bleus sont déployés aujourd’hui à travers le monde. Il faut que le secrétariat des Nations Unies, comme pour toutes les armées du monde, dispose d’un Etat-major permanent. A terme, nous devons avoir pour objectif une véritable armée des Nations unies. § C’est ainsi que la communauté internationale pourra assumer pleinement les responsabilités collectives qui s’imposent à elles. Pour prévenir les drames humanitaires et faire face à l’urgence, nous devons mettre en œuvre la « responsabilité de protéger » que la France a fait consacrer aux Nations Unies. Je pense en particulier à la tragédie du Darfour qui menace aujourd’hui d’emporter toute l’Afrique de l’Est, et peut-être au-delà, dans un conflit destructeur et dangereux.
Ces principes, nous devons également les appliquer au domaine de l’économie et du développement afin d’humaniser la mondialisation : - Au niveau mondial : c’est en ce sens que j’ai proposé la création d’un Conseil économique mondial, afin de mieux organiser le dialogue entre les grandes instances économiques internationales afin d’y mettre de la cohérence et une ambition commune : celle d’un système d’échanges plus équitable. Pour tenir les objectifs du Millénaire, dans les domaines de la santé, de l’eau, de l’éducation, des infrastructures, nous devrons aussi aller beaucoup plus loin dans la mise en place de financements innovants qui, seuls, permettront de procurer les ressources que nous n’obtiendrons jamais des budgets des Etats. C’est ce que la France a fait avec la contribution de solidarité sur les billets d’avion, dont elle souhaite faire un exemple et un précédent. Cette expérience pilote mérite d’être étendue. C’est une question de respect, de dignité et de justice. - Au niveau européen : l’Europe est aujourd’hui le premier pourvoyeur d’aide. C’est elle qui dispose de la plus longue expérience de coopération en particulier en Afrique. Nous voulons aujourd’hui aller plus loin. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, qui sont le préalable au développement, l’Europe a mis en place une facilité européenne pour la paix, qui lui permet notamment d’être le premier contributeur pour le financement de la force de l’Union africaine (AMIS) au Darfour. Dans le domaine commercial, la France souhaite que les nouveaux accords de partenariat économique entre l’Europe et les pays en développement, en Afrique en particulier, servent bien leurs intérêts. A nous de tenir compte des spécificités des pays concernés. A nous de les aider à se rapprocher des règles de l’OMC.
3. Il y a une urgence absolue dont dépend l’équilibre mondial, c’est un règlement collectif des crises au Moyen-Orient.
Le Moyen-Orient est aujourd’hui traversé par un ensemble de crises et de lignes de fractures qui menacent de se rejoindre. Elles allient tous les facteurs d’instabilité : guerres civiles et régionales, terrorisme, risque de prolifération, déplacement de populations réfugiées. Construire une paix durable dans cette région, cela doit être notre première priorité.
Ne nous trompons pas : les différentes crises qui se jouent au Moyen-Orient ont leur logique propre mais elle sont liées. Parce qu’elles ont leur logique propre, nous devons les traiter séparément. Parce qu’elles sont liées et pourraient l’être plus encore, nous devons les traiter simultanément. Le risque est en effet que ceux qui n’ont pas intérêt à la paix les instrumentalisent, établissent de nouveaux liens entre elles et les rendent encore plus dangereuses pour la communauté internationale.
C’est pourquoi je voudrais vous faire part ici de quelques pistes de réflexion, en commençant par le conflit israélo-palestinien. Dans ce conflit, les principes et les éléments d’une solution sont clairs : le renoncement à la violence, la création de deux Etats vivant en paix et en sécurité sont et resteront le point de départ de toute démarche viable. Mais pour avancer, nous devons aller plus loin sur trois éléments : - Le premier, c’est l’indispensable réengagement international dans un cadre précis. Car les parties n’y parviendront pas seules. Qu’il s’agisse des Etats-Unis ou de l’Europe, nous ne faisons pas assez. § Gardons le format du Quartet mais donnons-lui une vraie force d’initiative : nous avons besoin le plus rapidement possible d’une conférence internationale qui fixerait avec les parties le cadre d’un règlement, et à laquelle doivent être associés les Etats arabes modérés de la région, en particulier l’Arabie Saoudite, l’Egypte, la Jordanie. § Rétablissons pleinement notre aide aux Palestiniens. Ce que l’Europe fait actuellement avec le mécanisme international temporaire ne peut être une solution durable. Nous devons reprendre l’assistance directe au gouvernement palestinien d’union nationale dès que celui-ci sera investi. Nous devons reprendre également l’aide à des projets de coopération, afin de recréer les conditions d’un véritable développement. § Fixons également un calendrier. Ce dernier doit inclure des éléments de court terme, pour permettre de rétablir la confiance en montrant la bonne foi de chacun : libération du caporal Shalit, rétablissement des reversements de taxes par Israël au profit des Palestiniens, arrêt des tirs de roquettes. Il doit également fixer un cap pour le moyen terme : proposons ensemble aux Palestiniens et aux Israéliens un horizon fixe pour la création de l’Etat palestinien. C’est autour de cette date, qui doit être assez rapprochée, que se mettra ainsi en place une vraie dynamique politique. La communauté internationale pourrait apporter des garanties pour la sécurité d’Israël, avec une force internationale en échange du retrait israélien de Cisjordanie. - Le deuxième élément, c’est la nécessité de mieux prendre en compte les réalités du terrain : il faut aider Mahmoud Abbas et donner une chance aux partisans de la paix en facilitant les évolutions au sein du Hamas. C’est pour cela, par exemple, que la France soutient l’accord de la Mecque sur un gouvernement palestinien d’union nationale. J’avais, parmi les premiers, rapp
elé les trois principes du Quartet après les élections palestiniennes de 2006 et nous resterons vigilants sur la composition et l’action de ce gouvernement. Mais l’essentiel est bien de lancer et de faire vivre un processus qui fasse évoluer le Hamas et le conduise à accepter ces trois principes. - Le troisième élément, c’est la création d’une dynamique régionale. Cela suppose la stabilisation de l’environnement immédiat d’Israël et de la Palestine, c’est-à-dire des avancées avec le Liban et la Syrie. Un Liban souverain, aux frontières stables et contrôlées, est une garantie de sécurité pour toute la région. La Syrie doit prendre ses responsabilités et faire les gestes nécessaires envers la communauté internationale. A nous de lui donner alors toute sa place, notamment dans le cadre du partenariat rénové avec l’Europe. Un règlement global et durable devra par ailleurs inclure le volet israélo-syrien du conflit, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité.
En Iraq, la situation est trop dégradée pour espérer une issue immédiate. Mais il serait encore plus dangereux de ne pas se fixer, là encore, un cadre de sortie de crise. Pour ma part, ce cadre doit comprendre deux volets : - Tout d’abord, nous devons être clairs sur un calendrier de retrait des troupes étrangères. Celui-ci devrait intervenir, à mon sens, d’ici un an, pendant l’année 2008. C’est la condition pour que les Iraquiens sentent que leur avenir est entre leurs mains et s’engagent sur la voie d’un retour à la souveraineté nationale. Pour enrayer la spirale de l’échec, il faut commencer par rétablir une vraie perspective politique. - Le deuxième volet, c’est une triple mobilisation pour faire aboutir cette perspective politique : une mobilisation des Iraquiens eux-mêmes, d’abord, qui doivent engager l’indispensable réconciliation nationale, notamment en proposant à tous ceux qui renoncent à la violence de participer au pouvoir et en menant à son terme le processus de réforme constitutionnelle. Une mobilisation des Etats de la région, de la Turquie à l’Iran, de la Syrie aux Etats du Golfe, en soutien de ce processus et afin de veiller au maintien de l’intégrité territoriale de l’Iraq. Une mobilisation internationale, enfin, avec le moment venu, une conférence internationale. Les Etats-Unis devront y jouer un rôle central, bien sûr. Mais l’Europe devra également prendre alors ses responsabilités.
Enfin, la vision d’ensemble qu’exige cette région demande une pleine prise en compte de l’enjeu iranien, qui n’est pas que de prolifération. - Un Iran doté d’une capacité nucléaire militaire est inacceptable. Mais cette crise trouve aussi ses racines dans la volonté iranienne d’affirmer sa puissance régionale, sa fierté nationale et son souci de sécurité : c’est pourquoi la solution ne peut être militaire. Elle passe au contraire par la reconnaissance du rôle de l’Iran dans la région et par la mise en place entre tous les pays de la zone d’un processus de stabilité qui permette le dialogue et garantisse la paix et le développement économique. - C’est pourquoi la démarche dont nous avons pris l’initiative est politique, en alliant le dialogue et la fermeté. C’est le sens de la résolution 1737, adoptée fin décembre aux Nations unies, à l’unanimité : les sanctions décidées répondent au refus iranien de suspendre ses activités nucléaires sensibles. Si l’Iran fait le geste de suspendre l’enrichissement, le Conseil pourra suspendre les sanctions. La voie du dialogue reste ouverte et, pour nous, la priorité. - Dans cette nouvelle phase, le maintien de l’unité de la communauté internationale est essentiel : c’est un acquis du travail engagé depuis quatre ans par les Européens. C’est plus que jamais la condition de la légitimité de notre action et donc de son efficacité à long terme. Les Etats-Unis ont un rôle majeur à jouer pour sortir de la crise. Ma conviction est que cela passera, le moment venu, par l’engagement d’un vrai dialogue bilatéral avec Téhéran. Mesdames, Messieurs,
Dans le monde profondément nouveau qui est en train de se dessiner, nous avons besoin d’une diplomatie résolument nouvelle. - Jamais l’instabilité n’a été aussi grande. Jamais les menaces n’ont été aussi fortes. Mais jamais peut-être les solutions n’ont été aussi proches. - Aujourd’hui, la diplomatie doit donc être une diplomatie d’action et de résultats. La diplomatie ne peut plus être fondée seulement sur le « hard power » et sur la force. Elle ne peut pas non plus être fondée seulement sur le « soft power », le pouvoir d’influencer et de convaincre. La diplomatie doit désormais s’appuyer sur le « building power » : la bonne volonté, l’imagination, et la solidarité. - Oui, les Etats-Unis et l’Europe ont une responsabilité particulière pour construire des solutions durables aux défis de notre temps. Appuyons-nous sur les liens d’amitié entre nos deux nations pour apporter des réponses attendues par les peuples. Plaçons la relation transatlantique au service d’un nouvel ordre mondial qui donne sa place à chacun. Faisons ensemble œuvre de bâtisseurs pour avancer vers plus de paix et vers plus de justice.
Je vous remercie.