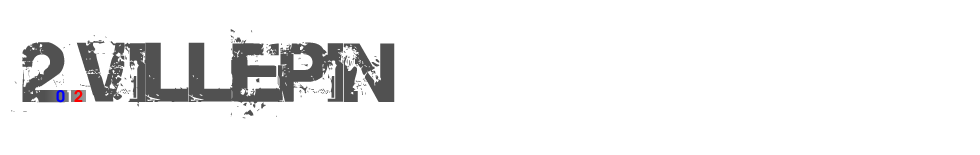Clip République Solidaire Conseil National
Réuni ce samedi Porte Maillot à Paris, le Conseil National de République Solidaire a approuvé à l’unanimité une motion politique intitulée « Pour la vérité et pour l’espoir ».
Le Conseil national du parti de Dominique de Villepin, « République Solidaire », a adopté samedi à Paris une motion politique « pour la vérité et pour l’espoir », fixant les grandes lignes idéologiques du mouvement dans la perspective de 2012.
Mettre les institutions au service des Français
– Le président de la République doit reprendre de la hauteur et le Premier ministre conduire au quotidien la politique de la Nation
– Le recours au referendum doit être plus fréquent
– Un décalage de temps doit être rétabli entre présidentielle et législatives afin que l’Assemblée nationale ne soit plus dans la dépendance de l’exécutif
– Une dose de proportionnelle doit être introduite aux législatives et la proportionnelle devenir le principe général des sénatoriales
– Interdiction du cumul des mandats
– Indépendance de la justice: une réforme constitutionnelle devra consacrer la rupture du lien hiérarchique entre exécutif et parquet
Pas de croissance sans effort
– Pas de remise en question de la tendance séculaire à la réduction du temps de travail mais meilleur partage entre temps de travail et temps de retraite
– L’élaboration d’une charte des salaires fixera l’écart compatible entre le salaire moyen et le plus élevé dans chaque entreprise
– Pour ne pas sacrifier la croissance, reprise en main réaliste des déficits sur dix ans par des économies mais aussi par une augmentation des prélèvements
– Réforme fiscale: suppression du bouclier, création d’une nouvelle tranche à 45% de l’IR, hausse de l’imposition des grosses successions en contrepartie de la suppression de l’ISF et surcote de 10 à 15% de l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises épargnées par la crise
– Compromis sur les retraites: maintien de la barre des 62 ans mais sauvegarde de celle des 65 ans (au lieu de 67) pour une pension sans décote
Partager la République
– Instauration d’un droit individuel à l’éducation prioritaire pour chaque élève, donnant droit à des accompagnements de soutien et des activités culturelles
– Réforme du collège unique pour qu’il garde sa vocation universelle mais sache répondre à la diversité des aptitudes des élèves
– Porter à 18 ans l’âge de la formation obligatoire assurée en établissement ou en alternance
– Création d’une Agence de développement économique des quartiers sensibles
Etre acteur de l’Europe et du monde
– Le partenariat franco-allemand doit retrouver son rôle moteur avec une mise à plat commune des positions sur tous les sujets
– Sans renier l’Alliance atlantique, sortie de l’Otan, modernisation de la force nucléaire et travail à une défense européenne
Source: Agence France Presse
Le texte de la motion politique: « Pour la vérité et pour l’espoir »
« Notre premier devoir est de dire la vérité aux Français.
Nous n’avons pas suffisamment pris la mesure des bouleversements qui remodèlent de fond en comble le monde dans lequel nous vivons. Nous nous laissons trop facilement persuader d’ignorer les retards et les handicaps que la France a elle-même accumulés, particulièrement ces trois dernières années.
Lorsque nous parlons de la mondialisation, nous pensons que le péril majeur –et de fait, très réel pour notre industrie et pour notre agriculture- réside dans les délocalisations et dans l’anarchie d’une concurrence où les coûts et les règles échappent à tout contrôle. Mais le basculement de l’économie et de la puissance mondiale, des pays occidentaux vers l’Asie et les pays émergents, résulte de plus en plus de la diffusion généralisée des savoirs et des compétences. Entre la Chine et l’Europe, entre l’Inde et l’Europe, le déséquilibre dans la formation des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens devient de plus en plus abyssal.
Lorsque nous évoquons la crise financière, nous nous réfugions trop vite dans l’illusion, entretenue par des tribuns opportunistes, d’un retour rapide aux facilités d’avant la crise (« business as usual »). Et les mobilisations spectaculaires du G20 ne débouchent, au mieux, que sur des régulations hâtives et superficielles.
Or, l’ampleur des déséquilibres est considérable entre engagements réels et transactions financières. L’opacité des marchés financiers, qui facilite le blanchiment d’argent et qui permet aux grands opérateurs de jouer de gré à gré sur des masses incontrôlées de produits dérivés, encourage les attaques répétées de la spéculation. L’optique purement financière de trop de fonds d’investissement dénature la finalité des entreprises et la relation entre les hommes à l’intérieur de celles-ci. L’accumulation des déficits –ceux des Etats-Unis et, désormais, les nôtres- nous place dans une situation de dépendance croissante à l’égard de nouvelles puissances, détentrices de formidables réserves de change et, demain, seules capables à travers leurs fonds souverains, de financer les grands investissements porteurs d’avenir.
Nous prétendons mettre l’écologie au service d’un nouvel art de vivre. Mais que sont nos initiatives au regard d’un monde où s’affrontent les aspirations légitimes au développement de milliards d’êtres humains et les enjeux d’un environnement dangereusement fragilisé ? Qu’il s’agisse de réchauffement planétaire, de production, de transport et de consommation d’énergie, d’autosuffisance alimentaire, de sauvegarde de l’eau, de l’air ou des métaux rares, on ne peut plus agir qu’à l’échelle de grands ensembles, et si possible, à l’échelle planétaire.
Enfin, parce que nous n’avons pas su apporter de solutions à des conflits que nous avons laissé s’enliser depuis des décennies –au Proche-Orient comme en Afghanistan-, parce que la démarche unilatérale de l’administration Bush a fait de l’Iraq le théâtre permanent d’une guerre civile aux acteurs insaisissables, parce que nous n’avons pas compris que l’humiliation des peuples était le plus redoutable foyer du terrorisme, nous sommes entrés dans un monde d’affrontement, de violence et de peur.
A l’échelle de la France, malgré tous nos atouts, nous subissons les conséquences de ces bouleversements.
Des pans entiers de notre économie sont aujourd’hui détruits ou fragilisés. Nous avons su longtemps compenser le déclin de nos activités traditionnelles par des programmes volontaristes –espace, aéronautique, énergie, transports- et par la puissance de notre industrie automobile. Mais ils ne suffisent plus aujourd’hui à enrayer la dégradation de notre commerce extérieur.
Depuis les années soixante, le taux de croissance de notre économie n’a cessé de décroître d’une décennie sur l’autre.
Nous en subissons aujourd’hui, toutes les conséquences : la montée brutale de déficits qui fragilisent notre pacte social et qui pourraient aller, si rien de sérieux n’est entrepris, jusqu’à menacer le crédit de l’Etat ; la persistance d’un chômage qui depuis un an, s’est fortement aggravé et qui touche en priorité les jeunes et les séniors.
Inégalement ressentie dans une société où les écarts de situation et de revenus n’ont cessé de se distendre, la crise touche certaines parties de notre territoire plus durement que d’autres. C’est le cas particulièrement des banlieues, des territoires ruraux, des régions à tradition industrielle.
Le sentiment d’appartenance, le sentiment de partager dans la nation une même communauté de destin s’en trouvent gravement affaiblis. Comme dans les années 30, la tentation du repli sur soi, du rejet de
tout ce qui est étranger à soi, devient chaque jour plus forte.
C’est devant une telle situation que l’action politique devrait retrouver toute son ambition et s’affirmer autour de principes clairs : assumer la réalité des faits, écarter les dérives qui menacent la République, renouer les dialogues qui permettent les mobilisations, prendre à bras le corps les problèmes qui minent notre nation.
Or, la politique conduite depuis trois ans dans notre pays n’est pas à la hauteur de ces enjeux.
D’abord, parce que cette politique n’a su trouver ni la hauteur, ni l’adhésion nécessaire de la part des Français.
L’équilibre de nos institutions a été rompu par une présidence bavarde, autoritaire et tatillonne à force d’omniprésence. Le Premier Ministre a été réduit au rôle complaisant de contrepoids médiatique. Les débats parlementaires étroitement encadrés depuis la réforme de 2008, ne permettent plus ni amendement, ni approfondissement.
La concomitance des mandats du Président et de l’Assemblée Nationale et le séquençage élection présidentielle-élection législative ont achevé de bâillonner la majorité présidentielle. L’antagonisme entre parti majoritaire et parti socialiste s’est exacerbé dans un affrontement de blocs qui ne permet plus jamais la recherche du consensus. Aucune réforme durable ne peut plus être votée. La communication permanente du pouvoir lui a peu à peu retiré toute lisibilité et toute crédibilité. Le doute et la désaffection des citoyens à l’égard de la chose publique n’ont cessé de s’aggraver.
Le mépris témoigné aux serviteurs de l’Etat –préfets, magistrats, fonctionnaires-, la réforme des collectivités territoriales, insuffisamment concertée et trop largement inspirée par des considérations politiciennes, ont transporté à tous les niveaux de la vie administrative et de la vie locale cette véritable crise de régime. La volonté de recentralisation s’est révélée aussi démobilisatrice qu’inefficace, notamment dans des domaines aussi vitaux que la politique de la Ville.
Parce que les réformes, qui sont certes indispensables, n’ont pas été engagées dans l’esprit de justice et d’équité qui aurait permis de leur donner toute la profondeur nécessaire.
Avec la loi TEPA, l’incitation à l’effort s’est trop largement confondue avec le renforcement des avantages qui profitaient aux plus favorisés.
Alors que la montée des déficits aurait dû exiger la mobilisation de tous les Français, le pouvoir s’est enfermé dans la logique aveugle du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux qui ampute chaque année les services les plus essentiels : sécurité, école, santé. Enfermé dans le cadre étriqué du bouclier fiscal et du nouveau dogme de non augmentation des prélèvements, refusant d’engager l’indispensable débat sur la répartition des prélèvements, il se refuse aux augmentations d’impôts et de cotisations, pourtant devenues incontournables.
La réforme des retraites, sur laquelle un compromis était possible entre le nécessaire aménagement démographique et les mesures d’équité pour les femmes, les chômeurs, les carrières longues ou pénibles, laisse, par-delà son adoption, une fracture profonde dans l’esprit des Français.
Face à la montée du chômage, et singulièrement du chômage des jeunes, aucune action significative n’a été engagée.
Parce que l’angoisse de laisser s’échapper certains électorats, imprévisibles et instables, conduit le pouvoir dans une surenchère sécuritaire qui menace les libertés et ternit l’image que nous nous faisons de la République. Parce que la banalisation des compromissions de tous ordres avec les intérêts et avec le monde de l’argent jette le discrédit sur les acteurs de la vie publique et finit par mettre en danger les institutions elles-mêmes.
Rarement la Justice, et au premier rang, le parquet, n’auront subi à ce point la pression du pouvoir. Jamais le nombre des gardes à vue, dont les modalités sont condamnées par l’Europe, n’aura été aussi élevé. Rarement, l’instrumentalisation, celle de l’identité nationale au début de l’année, celle de la burqa au printemps, celle des Roms, cet été, n’aura été pratiquée de manière aussi cynique, en direction des publics les plus tentés par le repli sur soi.
Parce que le manque d’indépendance et de vigueur de notre politique n’ont cessé d’affaiblir notre crédit sur la scène européenne et sur la scène internationale.
Le traité de Lisbonne et le rôle tenu par la France dans la crise financière de 2008 constituaient certes des avancées positives. Mais l’ambition pour l’Europe a rapidement tourné court. Le partenariat franco-allemand est souvent apparu moins comme un moteur que comme un frein à la construction européenne, et nous avons montré –notamment, avec l’accord de Deauville- notre dépendance nouvelle à l’égard de l’Allemagne.
Dans les périodes de tension et dans la gestion des conflits, nous sommes plus souvent apparus comme des nostalgiques de la ligne Bush que comme de possibles partenaires du Président Obama.
Le retour dans l’OTAN n’a fait en rien progresser l’Europe de la Défense. Il a conduit au contraire à notre alignement rapide dans le projet transatlantique de défense anti-missiles, pourtant peu compatible avec notre force nucléaire stratégique et contribué à notre enlisement, aux côtés des Américains, dans le conflit afghan.
Aujourd’hui, la France attend une autre politique. C’est cette alternative que nous voulons construire avec Dominique de Villepin. En créant République Solidaire, en s’engageant dans l’esprit de mission et de service de la République qui l’a toujours animé, Dominique de Villepin veut permettre à la France de trouver les équilibres institutionnels qui garantissent la démocratie et la liberté, de rassembler les Français dans une vision commune de l’effort et de la solidarité, de se faire entendre de nouveau sur la scène européenne et sur la scène internationale.
METTRE LES INSTITUTIONS AU SERVICE DES FRANÇAIS :
Le service de la France et des Français, c’est l’esprit même des institutions de la Vème République, fondées sur la primauté du suffrage universel et conçues tout entières comme des institutions de mission, au service de la grandeur de la France et du bonheur des Français.
Le Président doit reprendre de la hauteur, fixant les grandes lignes de l’action, sur la scène nationale comme sur les scènes européenne et internationale, et veillant en permanence à la continuité et à la cohérence de notre politique.
Le Premier Ministre doit conduire au quotidien la politique de la nation. Le Parlement doit retrouver le temps et l’espace nécessaires pour légiférer dans la sérénité, pour développer son pouvoir de contrôle et pour s’associer le plus en amont possible aux processus de décision de l’Union européenne.
Le suffrage universel doit être consulté chaque fois que l’ampleur des enjeux l’exige. Le recours au referendum doit être plus fréquent. Un décalage de temps doit être rétabli entre élection présidentielle et élections législatives, afin que l’Assemblée Nationale ne soit plus dans la dépendance de l’exécutif.
Pour sortir de l’affrontement stérile des blocs et pour permettre une expression plus ouverte des différents courants d’opinion, une dose de proportionnelle doit être introduite aux élections législatives. Pour mieux assurer cette diversité et rendre effective la parité, la proportionnelle doit devenir le principe général des élections sénatoriales.
Le Conseil économique et social doit être associé plus étroitement et plus systématiquement au travail de législation et de contrôle. Sa composition doit privilégier des acteurs et représentants q
ui soient engagés de façon réelle et actuelle dans l’exercice de leurs responsabilités associatives, syndicales ou professionnelles.
La clarification des responsabilités et le renouvellement nécessaire du monde politique doivent conduire à l’interdiction du cumul des mandats. L’une des conséquences est que, dans la vie locale, le rôle des parlementaires, qui votent le budget de l’Etat et qui ont la responsabilité de contrôler ses services, soit plus clairement affirmé.
Dans la lutte contre les conflits d’intérêt, la présomption de conflit –pour le responsable politique comme pour son entourage- doit être la règle et les exceptions doivent être strictement définies.
L’indépendance de la Justice, régulièrement proclamée mais, dans les faits, toujours reportée, doit être une fois pour toutes, clairement instituée. Une réforme constitutionnelle devra consacrer la rupture du lien hiérarchique entre l’exécutif et le parquet.
La garde à vue et les garanties qui doivent l’encadrer, en droit et en fait, devront s’inscrire dans les normes européennes.
Les tribunaux –recrutement des magistrats, renforcement des greffes- et l’administration pénitentiaire –encellulement individuel, traitement des personnes souffrant de troubles psychiques- recevront une priorité budgétaire durable.
Une magistrature économique et sociale sera instituée pour conforter le rôle des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce.
Le principe d’autonomie des collectivités territoriales devra retrouver toute sa portée.
Une loi organique déterminera les conditions d’évolution et de répartition des ressources des collectivités territoriales. L’autonomie d’évolution de ces ressources et leur péréquation selon des critères nationaux parfaitement lisibles seront les principes essentiels de cette loi.
Les charges qui relèvent de la solidarité nationale –notamment, le RSA et la dépendance- ne devront plus peser sur ces collectivités. Leurs nouvelles conditions de financement –notamment, l’institution d’une cinquième branche pour la dépendance- n’excluront pas que les départements soient associés à leur gestion.
Une plus grande différenciation des collectivités et de leur organisation permettra de mieux prendre en considération les besoins spécifiques des grandes agglomérations, d’un côté, des territoires ruraux et des villes moyennes de l’autre. L’élection des exécutifs au suffrage universel direct deviendra la règle pour les groupements de communes dépassant un certain seuil démographique.
L’aménagement du territoire retrouvera toute sa vocation de rétablissement des équilibres et de vecteur de développement. Les régions –éventuellement regroupées sur une base volontaire- seront le lieu privilégié de mise en œuvre de cette politique, dans le cadre d’une contractualisation avec l’Etat, et si possible, avec l’Europe.
TROUVER LES VOIES D’UNE CROISSANCE SOLIDAIRE :
Réduire les déficits, faire reculer le chômage, rendre une marge d’action et d’espoir aux acteurs publics comme aux acteurs privés, rien ne sera possible si nous ne retrouvons pas les voies de la croissance.
Certes, l’environnement international est, en ce domaine, une variable d’une influence considérable. Mais il n’y aura pas de croissance, s’il n’y a pas d’effort. Il n’y aura pas de croissance, s’il n’y a pas de consensus.
PAS DE CROISSANCE SANS EFFORT
Nous devons retrouver le sens de l’effort :
1° Cela est vrai du travail.
Nous ne remettons pas en question la tendance séculaire à la réduction du temps de travail qui fut l’acquis réaliste du gaullisme –la quatrième semaine de congés payés- tout autant que celui, souvent moins réaliste, de la gauche.
Mais, même si nous profitons d’une forte productivité du temps de travail, nous vivons dans un monde où la compétition exige que nous retrouvions plus de réactivité. Et l’allongement de la durée de la vie –même si les extrapolations doivent rester prudentes- exige un meilleur partage entre temps de travail et temps de retraite.
C’est la raison pour laquelle nous proposerons une grande négociation des partenaires sociaux sur le temps de travail et sur les conditions de travail, pour respecter la diversité des situations et des besoins et soutenir la liberté de choix dans sa vie professionnelle.
Il s’agira de tenir compte des contraintes spécifiques de pénibilité de chaque secteur, et inscrire cette négociation dans le cadre d’une refondation du dialogue social portant notamment sur trois enjeux essentiels.
La formation permanente, qui est tout à la fois un facteur de compétitivité pour l’entreprise et pour l’économie, un capital d’autonomie pour chaque travailleur, un instrument privilégié dans la sécurisation des parcours professionnels. Elle devra être régulièrement inscrite dans les rendez-vous avec les partenaires sociaux. Pleinement mutualisée,elle devra concerner aussi bien les salariés des TPE et des PME que ceux des grands groupes, aussi bien les demandeurs d’emploi que ceux qui sont dans l’activité. Même si elle demeure compétence des régions, elle devra être mieux concertée et mieux coordonnée à l’échelle de toute la nation.
Les taux d’activité qui doivent être renforcés aussi bien pour les jeunes que pour les seniors. Toutes les propositions, faites en ce domaine –par exemple, le tutorat entre les aînés et les plus jeunes au sein de l’entreprise- devront être expérimentées et chaque fois que cela paraîtra souhaitable, systématisées. Des engagements devront permettre d’atteindre un pourcentage minimum de jeunes de moins de 25 ans au travail, dans chaque entreprise de plus de 500 salariés.
La gouvernance de l’entreprise qui doit être le lieu d’une association plus forte aux stratégies et aux résultats. Dans un monde plus mobile, où la part activités de services devient prépondérante, il nous appartient certes de repenser la participation, mais non d’y renoncer.
L’établissement d’une relation plus responsable devra favoriser la parité entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la rémunération –y compris, à travers des sanctions fiscales. L’élaboration d’une charte des salaires fixera l’écart compatible entre le salaire moyen et le salaire le plus élevé au sein de chaque entreprise.
2° C’est vrai lorsqu’il s’agit de notre capacité d’innover et d’investir :
Depuis quelques années, la France a mené un effort soutenu pour stabiliser les moyens consacrés à la recherche –même si le crédit d’impôt-recherche, insuffisamment différencié, y tient une large part-, pour moderniser les instruments –notamment, entre 2005 et 2007, avec l’Agence nationale pour la Recherche (ANR) et les pôles de compétitivité-, pour réformer l’enseignement supérieur.
Mais, aujourd’hui, cet effort doit être amplifié. Dans les grands secteurs porteurs d’avenir, nous avons besoin de projets mobilisateurs : à l’échelle de l’Europe (par exemple, dans l’espace civil et dans l’espace militaire), dans un cadre intergouvernemental (la réactivation de l’AII pourrait s’inscrire dans des partenariats européens), par des stratégies de filières soutenues par des synergies plus fortes entre pôles de compétitivité (par exemple, sur l’axe industrie-énergie-environnement, sur la chimie verte, sur les nanotechnologies).
Dans la diffusion de l’innovation, nous devons nous appuyer beaucoup plus largement sur le réseau des PME : par l’instauration d’un taux réduit de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis dans l’entreprise, par l’orientation d’une part des ressources de l