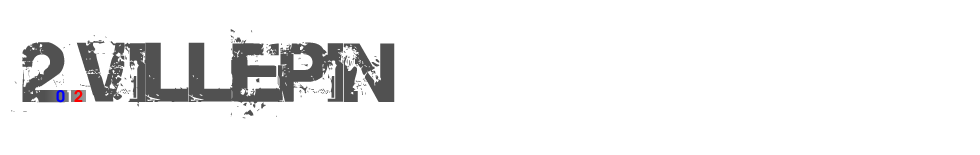Claude Allègre ministre de l’Education nationale ? Raymond Barre maire de Lyon ? C’était il n’y a pas si longtemps : dix ans. La France entre dans l’an 2000 avec à sa tête le duo Chirac-Jospin. La police de Jean-Pierre Chevènement patrouille lors de la Saint-Sylvestre. Dominique Voynet, ministre de l’Environnement, rentre tout juste des côtes de l’Atlantique, où sévit la marée noire de l’Erika. Depuis, la France aura connu deux présidents, quatre Premiers ministres et 17 soirées électorales, dont deux référendums.
Surtout, la période marque l’ascension de Nicolas Sarkozy, qui rassemble autour de lui une droite décomplexée. La gauche, en revanche, se trouve brutalement décapitée par l’élimination de Lionel Jospin au premier tour de la présidentielle de 2002. Elle s’enfonce dans une lente décomposition, entre guerre des chefs et interrogations sur le modèle social-démocrate.
Lionel Jospin, de Matignon au 21 avril 2002
Pourtant, le 1er janvier 2000, la « gauche plurielle » est en pleine forme. Socialistes, communistes, Verts, radicaux et chevènementistes sont réunis dans le gouvernement de Lionel Jospin. Les lois de Martine Aubry sur les 35h entrent en application le 1er février, tandis que le dispositif des emplois jeunes tourne à plein. Les couples homosexuels peuvent signer leurs premiers PACS. La Garde des Sceaux Elisabeth Guigou fait voter la loi sur la présomption d’innocence. C’est aussi l’année de la loi SRU, qui impose un quota de 20% de logements sociaux par commune.
Les principales réformes de la gauche plurielle sont ainsi sur les rails. Du coup, le gouvernement cherche son second souffle. Lionel Jospin procède à un remaniement d’ampleur, avec notamment le retour de Laurent Fabius et de Jack Lang. Mais déjà, la gauche plurielle s’effrite. Au cours de l’été, Jean-Pierre Chevènement démissionne du ministère de l’Intérieur pour marquer son désaccord sur le dossier Corse. C’est la première étape de la désunion à gauche.
Le PS remporte lors des municipales de 2001 deux succès symboliques. Bertrand Delanoë est élu à Paris, et Gérard Collomb à Lyon. Des victoires qui profitent surtout des divisions à droite: Philippe Séguin face à Jean Tiberi à Paris, Michel Mercier contre Charles Millon à Lyon. Et qui cachent une forêt de défaites. La gauche perd Strasbourg, Orléans, Nîmes, Rouen, Roanne, Quimper, Evreux, Beauvais, Chartres, Drancy, Aix-en-Provence… Jack Lang est lui aussi battu à Blois.
Les réformes de fin de législature (loi sur la sécurité quotidienne, police de proximité, prime pour l’emploi, congé paternité, allocation d’autonomie pour les personnes âgées) ne suffisent pas à mobiliser l’électorat lors de la présidentielle de 2002. D’autant plus que la gauche concourt divisée. Pas moins de huit candidats ! Outre Arlette Laguiller, Olivier Besancenot et Daniel Glusckstein à l’extrême-gauche, chaque composante de la gauche plurielle est présente: les Verts (Noël Mamère), le Parti communiste (Robert Hue) et le Parti radical (Christiane Taubira), tandis que Jean-Pierre Chevènement prend ses distances en critiquant violemment Lionel Jospin. Et c’est le coup de tonnerre. Avec seulement 16,2 % des voix, Lionel Jospin arrive troisième, derrière le candidat d’extrême-droite Jean-Marie Le Pen. Eliminé dès le premier tour, il annonce son retrait de la vie politique.
Jacques Chirac est donc reconduit pour un second mandat, malgré un score au premier tour inférieur à 20%. En 2000, éclate l’affaire de la cassette Mery et les révélations sur des versements en liquide du temps de la mairie de Paris. « Abracadabrantesque », commente Chirac. Un an plus tard, nouvelle mise en cause pour des billets d’avion payés en liquide, et nouvelle formule de Jacques Chirac: ces accusations font « pschitt ».
Pour sa campagne de 2002, Jacques Chirac place la lutte contre l’insécurité au rang de priorité numéro 1. Il prend aussi soin de rassembler la droite. Une fois réélu (82,2% des voix face à Jean-Marie Le Pen au second tour), il organise la fusion du RPR, de Démocratie libérale et d’une partie de l’UDF au sein de l’Union pour la majorité présidentielle, l’UMP, qui remporte les élections législatives. Rebaptisée Union pour un mouvement populaire, la formation porte à sa tête Alain Juppé, dauphin de Jacques Chirac.
L’ascension de Nicolas Sarkozy
Jean-Pierre Raffarin est nommé Premier ministre. Aux Affaires sociales, François Fillon assouplit la législation sur les 35 heures et réforme le régime général des retraites. Le ministère de l’Intérieur revient à Nicolas Sarkozy, qui a su se rendre indispensable lors de la campagne présidentielle. Il y impose un nouveau style, à la fois volontariste et sans états d’âmes. Le nouveau ministre ferme le centre de la Croix-Rouge à Sangatte (Pas-de-Calais). Il fait voter la Loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (Lopsi), qui lui confère autorité sur la gendarmerie. Puis la Loi sur la sécurité intérieure (Loi Sarkozy II), qui créé de nouveaux délits : racolage passif, mendicité agressive, squat dans les immeubles, outrage au drapeau tricolore ou à l’hymne national… Les allocations familiales peuvent être suspendues, la procédure de garde à vue est réformée, le fichage génétique est élargit aux simples suspects et à de nouveaux crimes et délits. Nicolas Sarkozy fait également un bref passage au ministère de l’Economie. Il réduit la part de l’Etat dans le capital de France Télécom et organise le changement de statut de Gaz de France.
Très vite, le ministre ne cache plus son ambition : succéder à Jacques Chirac à l’Elysée. Il est aidé en cela par les déboires judiciaires d’Alain Juppé. En 2004, le patron de l’UMP est condamné en appel à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité dans l’affaire des emplois fictifs de la ville de Paris.
La droite perd les cantonales et les régionales de mars 2004 (l’UMP ne conserve que 2 régions de métropole sur 22) ainsi que les européennes trois mois plus tard. Nicolas Sarkozy en profite pour s’emparer du parti fin 2004… et doit donc quitter le gouvernement, comme l’avait exigé Jacques Chirac lors de l’interview du 14 juillet. « Je décide, il exécute », avait lancé le président pour recadrer son ministre.
Dominique de Villepin à Matignon
Le 29 mai 2005, le référendum sur le Traité constitutionnel européen, aboutit à un rejet du texte par le peuple français. Le président de la République, Jacques Chirac, change alors de Premier ministre. Il nomme à Matignon Dominique de Villepin qui, comme ministre des Affaires étrangères, a incarné le refus de la guerre en Irak lors d’un brillant discours à l’ONU. Jacques Chirac doit également se résoudre à rappeler Nicolas Sarkozy qui reprend le ministère de l’Intérieur, sans abandonner pour autant la présidence de l’UMP.
C’est à ce moment que les commentateurs forgent le néologisme « villepinisme » pour désigner le discours, la pratique politique et l’influence au sein de l’UMP du nouveau Premier ministre.
Dominique de Villepin se donne « cent jours » pour redonner confiance aux Français, entamant un duel policé avec Nicolas Sarkozy. Alors que cette période s’achève, il exerce l’intérim à la tête de l’État lorsqu’il préside le conseil des ministres le 7 septembre 2005 en remplacement de Jacques Chirac, admis au Val de Grâce à cause d’un accident vasculaire cérébral. Il remplace toujours Jacques Chirac lors de la 60e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.
En septembre 2005, une grève à la SNCM éclate : le gouvernement souhaite privatiser l’entreprise au bord du dépôt de bilan. Des affrontements ont lieu à Marseille et un navire est « détourné » par les grévistes. Dominique de Villepin fait intervenir le GIGN, brandit la menace du dépôt de bilan imminent et propose une part de l’État et des employés plus importante dans l’entreprise. Les grévistes (en particulier le syndicat des travailleurs corses et la CGT) cèdent.
De retour place Beauvau, Nicolas Sarkozy fait, lui, le choix d’un discours musclé, rompant avec la retenue caractérisant habituellement un ministre de la République. En juin, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), il parle de « nettoyer » la cité des 4.000 « au karcher ». En octobre, il remet le couvert en promettant de débarrasser Argenteuil de la « racaille ».
En novembre éclatent les émeutes dans les banlieues. 5 000 voitures sont brûlées en moins de deux semaines. Dominique de Villepin décrète alors l’état d’urgence, prolongé de trois mois quelques jours plus tard par un vote au Parlement, afin de permettre aux préfets de décréter le couvre-feu.
Nicolas Sarkozy incarne désormais une droite sans aucun complexe face à la délinquance et à l’immigration
clandestine. Qui pourra encore l’empêcher d’être le candidat de son camp à la présidentielle de 2007 ?
Pas Dominique de Villepin. Alors qu’il surprend jusque-là (les sondages lui donnent un capital de sympathie important, y compris à gauche) et que le contrat nouvelles embauches (CNE) n’a pas suscité de mouvement d’opposition massif, Dominique de Villepin décide de lancer au printemps 2006 un contrat presque équivalent pour les jeunes, le contrat première embauche (CPE). Présenté par les syndicalistes comme étant une menace contre le code du travail et le CDI, ce projet rencontre l’opposition franche de la gauche, et suscite d’importantes manifestations et grèves d’étudiants.
Après des semaines de manifestations et de blocage d’université par les syndicats, Jacques Chirac est forcé d’intervenir et de réclamer la non application du texte de loi. Le 10 avril, après de multiples tentatives pour calmer la protestation (dont la promulgation de la loi par le Président), Dominique de Villepin annonce le remplacement rapide du CPE par une autre mesure, ce qui revient à son abrogation.
Les deux années de présence de Dominique de Villepin à Matignon sont caractérisées par la réduction marquée des déficits publics, la diminution continue du chômage, la hausse du SMIC et la revalorisation de la Prime pour l’Emploi, la mise en place d’une politique volontariste de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité des chances, la baisse de l’impôt sur le revenu, le patriotisme économique ainsi que l’interdiction du tabac dans les lieux publics.
La présidentielle de 2007
Alors que se profile l’élection de 2007, la gauche n’est toujours pas parvenue à combler le vide laissé par Lionel Jospin. Elle n’a pas de leader. Elle n’a pas non plus de stratégie de rassemblement pour construire une majorité. Au Parti socialiste, François Hollande tient toujours la boutique. Il engrange les victoires aux élections intermédiaires, mais n’est pas perçu par l’opinion publique comme un présidentiable. En outre, le référendum européen divise profondément le parti.
C’est dans ce contexte qu’émerge Ségolène Royal. Triomphante lors des élections régionales en Poitou-Charentes, la terre de Jean-Pierre Raffarin, elle se démarque habilement par des positions singulières: ordre juste, suppression de la carte scolaire, démocratie participative… Sa popularité croît. Les sondages la désignent comme la plus à même de battre Nicolas Sarkozy. Lors de la primaire organisée en novembre 2006, les militants socialistes la choisissent très largement (60%) devant Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn.
Cependant la campagne présidentielle réussit mieux à Nicolas Sarkozy. Tandis que Ségolène Royal semble isolée au sein de son propre parti, le candidat UMP parvient à séduire les électeurs du Front national. Outre le slogan « travailler plus pour gagner plus », il insiste sur la défense de l’identité nationale et promet une « immigration choisie ». « La France, on l’aime ou on la quitte », avait-il déjà lancé l’année précédente. L’association Act Up réagit en publiant une affiche sur laquelle figure Nicolas Sarkozy accompagné de l’inscription : « Votez Le Pen ! »
Les Français tranchent : Nicolas Sarkozy recueille 31,2% des voix au premier tour et est élu au second (53,1%). Ségolène Royal passe le premier tour sans encombre (25,8%) mais l’ensemble de la gauche est au plus bas : 36% des voix au total.
S’impose alors la question de l’alliance au centre. Car avec 18,5%, François Bayrou est devenu incontournable. Ségolène Royal laisse entendre qu’elle pourrait faire du leader de l’UDF son Premier ministre. Un débat plutôt amical a lieu sur le plateau de BFM TV. Finalement, François Bayrou ne soutient pas explicitement la candidate PS, mais il précise qu’il ne votera pas pour Nicolas Sarkozy.
Source: Baptiste Legrand (nouvelobs.com) et Wikipedia